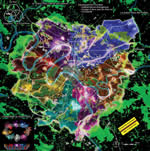| Le conseil scientifique de l’AIGP / Publications / Systèmes métropolitains | ||
Gouverner le Grand Paris - ATELIER ROLAND CASTRO, SOPHIE DENISSOF ET ASSOCIÉS / SILVIA CASI
GRAND PARIS, MÉTROPOLE MONDIALELe bilan des différents processus engagés pour « faire » le Grand Paris démontre la difficulté des décideurs à penser l’espace métropolitain dans sa dimension politique. Il témoigne également de l’incapacité des architectes-urbanistes à proposer des grilles d’analyses spatiales pertinentes et saisissables par les politiques, tandis que les opérateurs peinent à élaborer des projets répondant aux lourdes contradictions d’un système territorial en crise. En témoignent l’impact relatif de la consultation internationale, le pouvoir très illusoire du Grand Paris Express à être le projet unifiant pour la métropole ou les derniers épisodes chaotiques sur l’évolution institutionnelle. Notre hypothèse est que les désordres dans le gouvernement métropolitain sont un obstacle majeur à la constitution d’une action publique cohérente. Mais une réforme profonde du gouvernement métropolitain engage nécessairement des changements profonds de l’État. En 2007 déjà, les crises sociales, urbaines, du logement, des transports, s’accumulaient et constituaient la raison d’être d’une consultation qui devait explorer toutes les pistes de sortie de ces crises imbriquées et constituer une boîte à idées pour les pouvoirs publics. Si le message n’a pas été fondamentalement entendu, six ans plus tard, c’est la crise de régime politique – jusque-là sous-jacente – qui éclate au grand jour avec les épisodes successifs de la loi en discussion au Parlement à l’été 2013. LES FONDAMENTAUX DU CHANTIER INITIAL DE LA CONSULTATIONIl existe un socle commun de travail à même de constituer un point de départ pour éclairer la décision publique, qui s’incarne dans une culture urbaine du recyclage et de l’adaptabilité et comprend :
LA MÉTROPOLE PARISIENNE : LA RÉPUBLIQUE AUX PIEDS D’ARGILELa métropole parisienne, globalement riche mais avec des inégalités sociales et territoriales croissantes et de grands déséquilibres en matière d’habitat et de transports, est confrontée à des défis majeurs qui, dans les vingt dernières années, n’ont pas trouvé de réponses adaptées et opérationnelles. L’État doit, en coopération avec les institutions locales, définir des stratégies et les mettre en oeuvre :
LE SYNDROME DE L’INGOUVERNABILITÉNous sommes confrontés à un cadre décisionnel extrêmement complexe, imbriquant de multiples légitimités politiques, du local au national, des procédures aux principes divergents, du schéma directeur de la région Île-de-France (Sdrif) aux contrats de développement territorial (CDT), des logiques de fragmentation puissantes qui pèsent sur la capacité à décider et à mettre en oeuvre de véritables stratégies de territoires à l’échelle métropolitaine. Si Paris Métropole constitue un incontestable lieu de réflexion et de dialogue entre élus, il n’a pu, faute de statut, de compétences claires et d’impératif de consensus, jouer un rôle majeur dans la reconfiguration du gouvernement métropolitain. Parallèlement, les batailles de leadership entre l’État, la Région et la Ville de Paris, les logiques extrêmement concurrentielles entre les territoires pour attirer les dynamiques urbaines, le jeu des grands opérateurs urbains pour capter la rente foncière, la puissance des mouvements économiques ont continué de creuser de grands déséquilibres en matière notamment de transport, de logement et de ségrégation sociale. Si la consultation de 2008 n’a pas produit les effets espérés, c’est aussi sans doute en raison de la concurrence d’un très puissant et attractif élément de diversion, le réseau de transport du Grand Paris, qui a joué jusqu’à présent un rôle de projet fédérateur sans pourtant proposer de stratégies territoriales réelles. Les contrats de développement territorial qui devaient être une mise en cohérence raisonnée des démarches de développement sont devenus le miroir des concurrences locales, sous l’égide d’un État impécunieux dont la principale motivation était de reprendre le leadership à la Région Île-de-France. Nous pensons que l’absence d’une culture commune et d’une vision partagée découle d’un ethnocentrisme exacerbé de chaque institution, de chaque collectivité, de chaque acteur et qu’elle rend quasiment impossible la construction d’un outil adapté aux défis du Grand Paris. Et le projet actuel, une vision hyper politiste arasant toutes les réalités spatiales contemporaines de l’Île-de-France, est le symptôme de cette incapacité collective des acteurs de progresser dans l’identification des fonctionnements territoriaux réels à l’oeuvre dans le Grand Paris. À LA RECHERCHE DU GOUVERNEMENT DU GRAND PARISLa superposition, l’enchevêtrement des instances de pouvoir aboutissent à un quasi-immobilisme. Il nous faut donc inventer une méthode destinée à rendre possible ce projet. Nous pourrions appliquer ce que l’on appelle la logique floue, qui consiste à remplacer la logique booléenne (100 % de A implique forcément 0 % de non-A) par une logique qui consiste à dire que A et non-A peuvent être vrais en même temps. Prenons un exemple crucial dans le cas du Grand Paris. Deux analyses s’opposent radicalement quant aux instances de prises de décision à promouvoir : pour les uns, le despotisme est la seule façon d’avancer, pour d’autres, au contraire, nous sommes désormais entrés dans l’ère de la proximité, et il est impossible de revenir en arrière. Rien ne se fera sans l’accord des citoyens, au niveau local, qu’ils soient représentés par leurs élus territoriaux ou par des associations ad hoc. Appréhendons les choses autrement en cherchant à accepter les deux logiques à la fois. Cela pourrait passer par une forme de régulation dans laquelle on liste les dix ou quinze champs de décision fondamentaux liés à l’aménagement d’un territoire, puis où l’on formalise préalablement pour chacun d’eux si les décisions qui le concernent seront prises par un délégué de l’État ou au contraire par les décideurs locaux. En contrepartie d’un champ de contraintes très fort imposé par l’État – au nom de la réalisation du Grand Paris – sur certains aspects, il y aurait en revanche sur d’autres aspects un abandon complet de la décision aux seuls acteurs locaux. Afin de sortir de ces deux schémas, on pourrait imaginer que la métropole du Grand Paris se charge d’abord d’élaborer le plan stratégique métropolitain. Les communautés d’agglomération seraient, elles, responsables de la mise en place des plans territoriaux métropolitains, tandis que les communes délivreraient les permis de construire instruits par les agglomérations pour les projets d’envergure métropolitaine. Les limites de la métropoleLa question des limites de la métropole est déterminante, car il est important de savoir sur quel territoire va s’exercer le gouvernement du Grand Paris, et en même temps il serait sans doute pertinent d’accepter le fait que le périmètre ne soit pas figé et qu’il soit amené à évoluer dans le temps. Nous avons raconté comment la géographie dessine des entités cohérentes avec les bassins d’emploi et de vie, c’est-à-dire avec les usages métropolitains d’ores et déjà en place. La pertinence du territoire que nous défendons pour le Grand Paris transcende la géographie politique institutionnelle en place aujourd’hui. Il en résulte notamment une réduction de Paris à l’enceinte historique des Fermiers généraux et un redécoupage des arrondissements périphériques en cohérence géographique avec les communes qui les bordent. C’est de cette manière qu’un redécoupage institutionnel des communautés d’agglomération serait pertinent. Elles rassemblent pas moins de 500 000 habitants et se limitent à dix ou quinze grands rassemblements de communes. Si nous acceptons que Paris Métropole (153 communes et 45 intercommunalités, 8 départements et la Région) est un dispositif représentatif des volontés actuelles, son périmètre pourrait alors constituer la base en y ajoutant un critère de cohérence territoriale. Quel gouvernement pour le Grand Paris ?Si, comme nous le pensons, le Grand Paris est un projet éminemment politique, il doit alors être soumis aux électeurs dans un grand débat à intervalles réguliers et sanctionné par l’instauration de l’élection au suffrage universel des représentants de l’institution métropolitaine. Une assemblée du Grand Paris composée de 150 à 200 élus répartis en deux collèges pourrait voir le jour. Le premier collège représenterait les agglomérations à travers les diverses communautés, géographiquement identifiables et non pas organisées en petites entités selon des connivences politiques. Le second collège représenterait les communes. L’assemblée contrôlerait l’exécutif et validerait les politiques du logement, de l’emploi et des transports. Le pouvoir exécutif – tel un gouvernement de la métropole – se composerait d’un maire du Grand Paris et des dix à quinze présidents de communauté d’agglomération. L’élection au suffrage universel de la tête de l’exécutif métropolitain nous semble indispensable afin d’asseoir la légitimité de la nouvelle institution et de favoriser l’appropriation des enjeux métropolitains par les citoyens. Cet exécutif aurait dans son champ de compétences le logement, l’emploi et les transports et par conséquent il élaborerait le plan local de l’habitat (PLH), le schéma directeur et le plan de déplacement du Grand Paris, qui formeraient le plan stratégique métropolitain. Celui-ci s’imposerait aux communautés et aux villes après avoir été voté par l’assemblée. L’exécutif serait à même de proposer un taux unique en matière de fiscalité et l’instauration d’un tarif de transport unique sur le territoire du Grand Paris. Cette institution assumerait le destin d’une métropole mondiale, avec le monde entier à domicile. Le destin d’une capitale de la République métissée à construire. Les décisions régaliennes se prennent avec l’État. Cette échelle est la seule dans laquelle la multipolarité du Grand Paris peut se construire, dans laquelle les grandes décisions régaliennes peuvent être prises. Le temps du consensus mou et des négociations qui font perdre de vue l’essence même du projet et l’efficacité des structures doit laisser place au courage politique et aux ententes transpartisanes honorables. Ce projet pourrait être simple, il mérite d’être soumis aux citoyens. MÉTHODE BARCELONAISE : LE FUTUR C’EST L’EURORÉGIONNous avons choisi de prendre comme ligne principale de notre analyse sur les systèmes métropolitains l’exemple de Barcelone à travers ses projets les plus récents, les uns presque finis, d’autres en cours. Tous ont en commun de pouvoir être qualifiés de producteurs de nouvelles centralités et d’avoir une vocation métropolitaine. Dans l’agglomération de Barcelone, il manque cependant une structure métropolitaine capable de prendre en charge un développement cohérent de l’agglomération et, à plus forte raison, de la région. Si les villes de l’aire métropolitaine multiplient les initiatives, souvent ambitieuses, elles ne sont toujours que des initiatives locales. La ville de Barcelone maintient quant à elle sont dynamisme : le privé investit un espace très valorisé par les projets urbains issus notamment de la dynamique impulsée par les Jeux olympiques de 1992, tandis que la politique urbaine reprend les objectifs et les projets structurants en tenant compte de la nouvelle situation. La coopération du public avec le privé devient la règle. On peut cependant regretter que les nouvelles centralités se limitent à la ville centrale. LES ANNÉES 1990, NOUVELLE ÉTAPE ET NOUVELLE ÉCHELLE DE L’URBANISMEOn perçoit dans les milieux politiques et techniques de la ville de Barcelone une volonté légitime et bien intentionnée de donner la priorité aux habitants en même temps qu’on laisse faire les dynamiques de construction des promoteurs privés et les dynamiques économiques orientées vers les services et le tourisme. Si l’urbanisme de proximité est une dimension essentielle de l’urbanisme, une grande ville dépérit si elle en fait son programme principal. L’urbanisme de Barcelone ne peut alors se cantonner à la ville, à ses quartiers et à ses habitants. Il lui faut un urbanisme opérant à au moins trois échelles supra-municipales. La première est l’agglomération, qui est la ville réelle depuis une cinquantaine d’années, équivalant (en surface et en habitants) à peu près à Madrid : la ville de 500 km2 et plus de 3 millions d’habitants. La deuxième échelle, la région métropolitaine, de géométrie variable selon les projets, est aujourd’hui un territoire stratégique où des autorités de différents niveaux se rencontrent et se confrontent. La région doit être le cadre de coopération entre la Generalitat (gouvernement catalan, qui a la compétence principale en aménagement, urbanisme et logement) et les pouvoirs locaux (agglomérations urbaines et métropolitaines selon la terminologie française). La région métropolitaine est le niveau efficient de la planification territoriale, pour promouvoir les grands projets et pour la gestion de certains services et infrastructures d’échelle régionale (par exemple communications et transports). Une troisième dimension reste à inventer : l’eurorégion. La grande région européenne à l’intérieur de laquelle Barcelone est et doit devenir un des principaux centres. C’est un territoire polycentrique qui va de Valencia et Zaragoza à Montpellier et à Toulouse. LE GRAND PARIS DOIT ÊTRE L’EURORÉGIONC’est à l’échelle de l’eurorégion que se joue l’avenir de nos villes, de nos territoires et de nos sociétés. L’autre option est plus conservatrice, plus spéculative aussi, et consiste à considérer les villes comme des îlots qui cultivent le passé (ville musée et gentrification généralisée) tandis que se développent des axes urbanisés sans ville, un urbanisme postmoderne sans citoyenneté, où l’alliance impie entre promoteurs privés, architectes mégalomanes et pouvoirs politiques fragmentés crée des espaces destructeurs de la démocratie citoyenne. La ville est notre avenir, l’enfermer sur elle-même, c’est signer son acte de décès. Le pari réside alors dans la construction d’un territoire articulé par des villes compactes. Avec la démocratie, Barcelone est redevenue une ville. Il faut espérer qu’elle est prête à assumer ce nouveau défi : participer à un leadership partagé et à la construction de cette « eurorégion de villes ». BARCELONE : UNE MÉTHODE, PAS UN MODÈLESi le modèle barcelonais existe, il ne peut être formel – une image finale de la ville, une grille (malgré l’importance de l’Eixample de Cerdà) qu’on développerait systématiquement. Le mot modèle n’est pas le plus adéquat mais, si on l’utilise, on doit se référer aux formes de l’action et au résultat obtenu. Il y a une méthode urbanistique qui répond à une volonté politique et à une pratique collective. La méthode urbanistique à promouvoir pour faire métropole implique un renversement de la formule peu dialectique plan/ programme/ projet. Le programme devient le développement de certaines idées, priorités et décisions sur la ville. C’est la définition des objectifs, du type d’actions à mener et des contenus concrets de ces actions. Le projet vient ensuite et propose une première formalisation urbaine et architecturale. Le plan ou l’instrument légal à utiliser vient après : modification du plan métropolitain, plan spécial, coopération avec le privé, etc. Il y a bien sûr un cadre légal (législation, plan général, plan d’action municipal) qui rend possible l’intervention publique mais la priorité réside dans les idées ou les valeurs qui orientent le programme, la décision politique qui permet de passer à l’action en définissant les contenus et en mobilisant les moyens, la qualité formelle du projet qui rendra l’action exécutable et visible, et la dialectique avec les acteurs sociaux au cours de tout le processus, de l’élaboration du projet à son évaluation a posteriori. C’est un urbanisme réflexif, qui donne la priorité à l’action politique sur la norme. Il se développe en tenant compte des effets ou des réactions suscités par l’action préalable. Cette méthode a donné une place toute particulière aussi à ce qu’on appelle l’urbanisme social de proximité, qui consiste à faire des résidents installés les interlocuteurs privilégiés de la gestion urbaine locale. La décentralisation, le dialogue avec les associations capables d’exprimer des positions propres sur les plans d’équipement, les nouveaux projets urbains ou les programmes de logement social sont oubliés au profit de négociations sur le bruit, les petits travaux publics, ou la sécurité, le civisme, voire la prostitution ou les immigrés. Souvent, l’objet de la participation se fonde plutôt sur l’opposition aux changements ou sur le maintien de certains avantages de position. Et même lorsque les demandes sont très légitimes comme la dénonciation du manque de certains équipements ou services, la situation des personnes dépendantes ou la pauvreté cachée. La politique de proximité reste toutefois une manifestation secondaire, et non essentielle, de la relance de la dynamique urbaine. DU GRAND PARIS À L’EUROPE DES MÉTROPOLESQuel est le lieu où peut se construire un projet sinon le lieu dont la seule légitimité est la mémoire apaisée d’un continent qui connut des guerres sans fin jusqu’aux deux dites mondiales : l’Europe donc ? Si l’on imagine de bâtir cet espace sur des idées connues, sur l’idée de droits certes mais aussi de devoirs, sur la défense des services publics existants certes mais aussi dans la création de nouveaux services, philosophiquement légitimes… Si l’on imagine cet espace prenant au sérieux la politique et s’organisant pour combattre les désastres du monde et participer à son apaisement… Si l’on imagine que cet espace non seulement prenne sens à travers la question de la mémoire mais s’appuie aussi sur des idées plutôt que sur l’économie… On peut tenter d’en observer la fabrication avant même d’ailleurs d’en proposer l’unification ; il serait judicieux d’en faire le tour pour en saisir le plus vif. Beaucoup de débats paralysent l’Europe. Europe des nations, disent les souverainistes pas si fous. Europe des régions, disent les économistes gentillets ou les babas du terroir et du vélo. Europe des chrétiens, demande la pince vaticane, une branche à Madrid, une branche à Varsovie et l’axe à Rome. Les nations, ça ne se balaye pas d’un revers de main. Jaurès disait de la nation qu’elle était le seul bien des pauvres – Jaurès dont on ne saura jamais si sa force messianique aurait pu modifier le cours inexorable de la guerre. Les régions, c’est de la proximité, ce qui n’est pas faux, mais c’est une proximité qui peut s’opposer à l’idée de l’universel, et faire l’éloge des identités de repli. Il y a un au-delà des nations et des régions. Il y a en Europe de grandes métropoles qui concentrent sur des territoires limités des citoyens venus du monde entier. Le monde peut prendre forme dans les territoires de petite taille, concentrés de l’histoire du monde. Le Grand Paris métropolitain, beau et solidaire, pourrait être un modèle mondial et le modèle du métissage républicain pour l’Europe et ainsi annoncer le destin de la Confédération européenne à construire, le chaînage des métropoles européennes pourrait contribuer à inventer le transnational. Le Grand Paris est un projet politique qui peut avoir, bien que petit à l’échelle du monde, un destin d’exemple car on y trouve la concrétude du monde entier, le Pakistan à la gare de l’Est, le Mali à Montreuil, le Val d’Aoste à Asnières, l’Arménie à Alfortville et la Russie à Sainte-Geneviève-des-Bois. On peut y construire l’égalité apparente de destin pour tous : le droit à l’urbanité, qui s’ajouterait au droit pour tous de 1789, à l’école de l’égalité des chances pour tous de la fin du XIXe siècle et au droit aux soins universel de 1945 (la sécu). Donc le lieu où le lien se voit : agréable à chacun, rassembleur pour tous et nomade sur place pour tous (tous les lieux de voyage métropolitain). L’Europe des métropoles serait le lieu préexistant à la construction politique, indispensable, de la création de cette Europe qui devrait, grâce à sa longue histoire de protection sociale, contribuer à civiliser la mondialisation. Le Grand Paris a une vocation économique, sociale, sociétale, d’attractivité et d’exemplarité à l’échelle du monde. Seuls les intérêts de boutiques ou de bureaux le bloquent. Il faut que les citoyens sachent tout cela, il est inouï d’absurdité que la carrière de quelques milliers de bureaucrates, leurs petits territoires, leurs petits plans entravent une histoire formidable que dix équipes d’architectes et d’intellectuels s’étaient mis à écrire. Avec solennité, je voudrais que des bureaucrates de la rue Saint-Guillaume, de la rue de Solferino et de la rue de Vaugirard entendent ceci : Vous confisquez, vous empêchez, vous entravez, vous bloquez une immense occasion mondiale de refaire entendre la voix de la France, comme nation, et surtout comme idée. Votre agrippement à vos territoires, à vos avantages et à vos carrières déshonore l’idée d’intérêt général, que vous bradez pour vos passions boutiquières. Il n’empêchera pas que nous soyons de plus en plus nombreux à vouloir un Grand Paris magnifique, solidaire et entreprenant. Nous nous adresserons de plus en plus fort au souverain qui, depuis 1989, est le peuple, et il aidera à cette grande idée. Nos grands dessins construiront un grand dessein. Le destin de l’ensemble des réflexions et des postures que nous avons prises n’est pas valable uniquement à Paris. Les grandes métropoles régionales pourraient en bénéficier aussi : mettre de l’intérêt public partout, remodeler et dézoner, créer des lieux symboliques nouveaux, promouvoir une approche sensible de la ville, quitter l’accablement patrimonial… Tout ce qui nous semble une manière de concevoir la ville hors d’une pensée purement technique pourrait se diffuser sur tout le territoire. Et le monde aussi pourrait en profiter. ATELIER ROLAND CASTRO, SOPHIE DENISSOF ET ASSOCIÉS / SILVIA CASI, Membre du Conseil scientifique de l’Atelier International du Grand Paris
|
||
L'AIGP
Actualités / Agenda
Événements
Grand Paris en projet
12 clés pour inventer le projet métropolitain du Grand Paris
Carte des projets d'aménagement du Grand Paris
Carte de la métropole du Grand Paris
Projets emblématiques du Grand Paris
La carte des CDT et les avis de l'AIGP sur les CDT
Contribution de l'AIGP au SDRIF
12 clés pour inventer le projet métropolitain du Grand Paris
Carte des projets d'aménagement du Grand Paris
Carte de la métropole du Grand Paris
Projets emblématiques du Grand Paris
La carte des CDT et les avis de l'AIGP sur les CDT
Contribution de l'AIGP au SDRIF