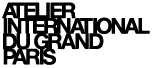| Le conseil scientifique de l’AIGP / Publications / Systèmes métropolitains | ||
Vers l’université libre du Grand Paris - AGENCE FRANÇOIS LECLERCQ / ATELIERS LION & ASSOCIÉS / AGENCE MARC MIMRAM
La métropole francilienne a atteint aujourd’hui le seuil la conduisant à une définition légale, débattue dans les hémicycles de la République, puis frappée du sceau de la constitutionnalité. Le Grand Paris n’en demeure pas moins façonné par ses habitants qui, de par leurs pratiques, bousculent quotidiennement les limites métropolitaines. Aujourd’hui, la poursuite des débats sur la métropole appelle la mise en place d’un cadre démocratique à même de refléter ces multiples pratiques habitantes. Quel cadre pour une métropole sans limites ? Quelle structure pour prolonger les débats métropolitains en intégrant une dimension démocratique accrue ? LE PARADOXE MÉTROPOLITAIN FRANCILIEN : UN CADRE ÉTRIQUÉ POUR UNE FORME SANS LIMITESLe terme « métropole » se trouve ainsi borné législativement par la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles adoptée en décembre 2013. Le Grand Paris demeure une réalité mouvante constituée de territoires à géométrie variable : bassins de vie dont l’acception demeure débattue, périmètres administratifs ou territoires de projets de plus ou moins grande échelle. Le Grand Paris n’est pas la zone dense, encore moins les seuls départements de la première couronne, vocables que les pratiques des Franciliens ont depuis longtemps abolis. De surcroît, l’expression « Grand Paris » est bel et bien entrée dans le langage commun, dans la presse, la publicité, aux comptoirs des cafés… Relevant de conceptions variées mais d’une image mentale souvent univoque. En effet, si la forme de la métropole reste sans limites, son image se trouve aujourd’hui incarnée et réduite à un projet de transports dont la double boucle colorée a tendance à accaparer la perception d’un projet qui aurait dû être global. La loi a ainsi fait son travail de définition, issu du paradoxe absolu qui veut que la gouvernance appelle à une forme bornée tandis que la pensée la conçoit sans limites. Lorsque, en juin 2008, l’État a mobilisé, de manière inédite, dix équipes pluridisciplinaires pour réfléchir à une échelle métropolitaine, les résultats de la consultation ont permis de lever des non-dits, notamment d’admettre un certain retard de la région capitale au regard d’autres villes mondes. Ce constat a eu une traduction concrète : « Le Grand Paris est un projet urbain, social et économique d’intérêt national. » La loi sur le Grand Paris a été promulguée le 3 juin 2010, et suivie quelques mois plus tard de la signature par l’État et la Région du protocole d’accord marquant la naissance du Grand Paris Express. Une frustration est alors née, résultant du sentiment que le projet ne relevait « que » du grand métro ; puis elle a été renforcée par la conviction qu’en se lançant dans ce projet pharaonique on mettait de côté l’urgence du logement et des transports mise en avant de manière unanime lors de la consultation et que la réalité – du RER irrespirable au prix du mètre carré – ne cessait de nous rappeler. Pourtant, indéniablement, cette consultation a eu un effet : celui de mettre en branle un système qui verra son aboutissement concret lorsque la première rame du Grand Paris Express circulera. Par ailleurs, la consultation a accouché d’une structure inédite, observée avec curiosité par d’autres métropoles mondiales depuis : l’Atelier International du Grand Paris (AIGP), lieu d’émulation intellectuelle s’il en est, dont les travaux ont permis de produire une kyrielle de représentations de la métropole, sans cesse discutées et enrichies. Dans un contexte singulier – un projet de transport installé et des débats en cours, cristallisés autour de la question de la gouvernance à l’aube d’un troisième acte de décentralisation –, nous pensons que la vocation de l’Atelier International du Grand Paris doit évoluer pour suivre le rythme du projet métropolitain. Nous avons aujourd’hui l’impression que le temps où l’Atelier tenait sa force de ses activités d’agitation intellectuelle est révolu. Un paradoxe semble alors prégnant : tandis que les équipes pluridisciplinaires représentées en son sein appellent de leurs voeux la mise en action du processus du Grand Paris dans tous les domaines, les réflexions se poursuivent dans le même sens qu’en 2008 alors que plusieurs vagues de projets sont passées. Le temps politique s’est emballé et a abouti le 19 décembre 2013 au vote final d’un projet de loi tout aussi discret que crucial, créant une métropole aux contours arbitraires. Une fois de plus, les réflexions du conseil scientifique de l’Atelier semblent loin. De même, le point de vue des Franciliens a été tout simplement écarté de cette conception technocratique. Sans assise démocratique, comment imaginer que nos concitoyens se reconnaissent dans le Grand Paris de demain, d’autant que le périmètre de la métropole ne correspond à aucune réalité en termes de pratiques ? Tout au plus pouvons-nous espérer un rattrapage a minima, en 2020, si le suffrage universel direct remplit les sièges de l’hémicycle métropolitain. POURSUIVRE LES DÉBATS MÉTROPOLITAINS AU SEIN D’UNE STRUCTURE SANS LIMITESAinsi, nous pensons que la structure même AIGP doit évoluer, pour garder sa formidable propension à agiter des idées, mais en gagnant en capacité d’action. Ainsi, par la constitution d’une « université libre du Grand Paris » nous souhaitons affirmer notre désir de poursuivre les réflexions autour de la construction de la métropole tout en effectuant le rassemblement le plus large possible des forces en présence. Pourquoi se priver en particulier des entreprises d’Île-de-France, qui sont parties prenantes de la constitution d’un Grand Paris économique ? Comment intégrer les Franciliens au processus de transformation de leurs territoires ? Quel rôle les élus peuvent-il jouer dans les réflexions autour de la métropole ? Comment fédérer les recherches universitaires en cours sur les dynamiques métropolitaines ? En somme, comment rassembler les acteurs du Grand Paris afin d’éviter l’écueil du gaspillage d’énergies, d’idées, d’initiatives, alors que le temps presse ? Par cette proposition d’université libre, nous entendons ouvrir le débat sur les suites à donner aux travaux de l’AIGP, pour que la dynamique se poursuive, en se rapprochant des territoires, dans un processus au sein duquel les architectes-urbanistes pourraient mettre en oeuvre les idées développées lors des consultations successives. Mobiliser notre savoir-faire, tirer parti de nos expériences de terrain… Nous ressentons aujourd’hui le besoin d’effectuer ce travail de dialogue et d’échange dans un contexte plus ouvert. Après ces années d’études métropolitaines, l’envie de voir le Grand Paris basculer dans l’opérationnalité nous pousse à l’invention de cette structure. Par la création de l’université libre, nous l’affirmons : le Grand Paris est populaire ! En 2009, l’exposition Le Grand Pari(s) à la Cité de l’architecture et du patrimoine, qui présentait les scénarios d’aménagement de la métropole parisienne des dix équipes ayant participé à la consultation lancée début 2008, a connu un franc succès, attirant 220 000 visiteurs en quelques mois. La première consultation a de fait constitué un véritable déclencheur, et cette exposition a été un acte fondateur dans le dialogue avec les citoyens, les médias et en particulier la presse écrite – relais important dans la communication relative aux projets. La consultation a ainsi installé dans le débat public une question qui existait déjà mais n’était pas encore cristallisée. Mises sur la place publique, les problématiques du Grand Paris se sont cependant peu à peu focalisées sur des objets précis, vidant le débat public de son sens politique au profit de sujets techniques, de sorte qu’il n’y a pas pour le moment de débat politique et citoyen continu sur les enjeux et les stratégies métropolitaines. La mobilisation des Franciliens n’a été que ponctuelle, en particulier lors des rencontres organisées par le syndicat Paris Métropole, dont le grand mérite a été de montrer l’existence d’une représentation sociale du Grand Paris. Apportant une nouvelle hiérarchisation des enjeux, les enquêtes menées auprès des habitants et les rencontres publiques ont fait émerger plusieurs sujets, qui ont mis au premier plan l’articulation constante entre identité locale et conscience métropolitaine. METTRE EN ACTION LE PROCESSUS DU GRAND PARISPar la création de l’université libre du Grand Paris, nous entendons lancer le débat public pour une durée aussi indéterminée que le sont les limites de la métropole. Il s’agit d’instaurer un rite démocratique puissant, manquant aujourd’hui cruellement dans le processus de projet en cours. Cette structure innovante sera à même de rassembler l’ensemble des acteurs investis dans le Grand Paris, afin de poursuivre l’élaboration d’une stratégie urbaine ouverte : habitants, élus, acteurs publics et privés, entrepreneurs, chercheurs, étudiants, professionnels, etc. La méthode proposée met au coeur de la problématique de l’université libre la notion de décloisonnement, indispensable à la compréhension mutuelle de ces différents acteurs, chacun ayant son propre langage. Cela signifie par exemple socialiser la connaissance des « experts » (aménageurs, architectes, urbanistes, chercheurs…) pour en faire un enjeu populaire et permettre aux débats d’accompagner la transformation du territoire. Une écoute large et permanente des habitants fera naître une multitude de sujets : il s’agit en priorité de mener des consultations généralistes sur les orientations stratégiques de la métropole, pour rendre lisibles les valeurs qui vont présider à la transformation du territoire. De ces débats généralistes émergent des sujets plus thématiques et des controverses (ville et nature, compétitivité et solidarité…), dans une dialectique où la stratégie urbaine est toujours sous-jacente pour réévaluer les priorités au fil de l’évolution du projet de territoire. Inversement, les sujets particuliers alimentent la vision d’ensemble. Ils sont relayés et étayés par les experts, les professionnels, les chercheurs. La mise en action immédiate du processus du Grand Paris entrera en synergie avec la recherche patiente, nécessitant du temps, de l’expérimentation et de l’échange. Le croisement de deux échelles de temporalités de recherche s’avère essentiel à l’enrichissement des débats métropolitains. En somme, l’université libre sera le cadre démocratique nécessaire à la mise en dynamique productive des acteurs. Sa concrétisation sera à la fois physique et virtuelle : un objet forcément itinérant en Île-de-France, constitué d’une structure légère formant un espace public nomade dédié à l’agora permanente, complété par un espace virtuel prolongeant l’espace physique des débats grâce aux outils numériques. Il n’y a pas de métropole finie, et la métropole francilienne ne saurait correspondre aux limites que l’on lui prépare. Notre devoir est de continuer à donner vie à cette forme mouvante par le débat désormais démocratique. AGENCE FRANÇOIS LECLERCQ / ATELIERS LION & ASSOCIÉS / AGENCE MARC MIMRAM, Membre du Conseil scientifique de l’Atelier International du Grand Paris
|
||
| « Système ouvert, les nouveaux mondes du Grand Paris - TVK / ACADIE / GÜLLER GÜLLER / BAS SMETS |
| Cécile Duflot présente la feuille de route du Grand Paris du logement et de l’aménagement durables » |