La voie fluviale: Achères plateforme sur Seine / 22 novembre 2012
Sur la friche des anciens champs d’épandage de Paris, le projet d’un nouveau port à Achères, situé à la confluence de la Seine et de l’Oise, porte en germe la consolidation de la logistique fluviale dans le Grand Paris en conjonction avec le développement de la vallée de la Seine et de sa façade maritime.
Les intervenants
Antoine Grumbach, Architecte, Agence Antoine Grumbach, membre du Conseil scientifique de l’AIGP
François Decoster, Architecte, Agence AUC Architecture, membre du Conseil scientifique de l’AIGP (2010-2011)
Lydia Mykolenko, Responsable des études fret et logistique à l’IAU IDF
Francis Toqué, Adjoint au maire de Conflans-Sainte-Honorine (1989-2014)
Hugues Ribault, Maire d’Andrésy
Nicole Bineau, Adjointe au maire d’Achères, chargée de l’aménagement et de Paris Métropole (2007-2014)
David Morgant, Directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement - Mantois Seine Aval
Alexis Rouque, Directeur général de Ports de Paris
 Situation métabolique:
Situation métabolique:
Un nouveau port ouvert sur la plaine d’Achères
Le Port Seine Métropole c'est :
420 ha
d’aménagement en deux opérations ,
Le Port Seine Métropole Ouest c'est :
100 ha
et 15%
d’espaces publics ,
500 à 1000
emplois directs sont prévus ,
110 millions
d’euros d’investissement ,
Trafic de 1100
tonnes de granulats en 2025
 La logistique fluviale des ports de Paris
La logistique fluviale des ports de Paris
«La voie fluviale a des difficultés à se développer. Pour une entreprise, le plus simple reste le transport des conteneurs par camion. Pour faire du report modal, dans la logique du Grenelle, il faut des acteurs derrière pour proposer des infrastructures, de l’initiative, de l’ingénierie, de la recherche sur les solutions logistiques nouvelles. Port de Paris est à la fois un gestionnaire d’infrastructure et le porteur à l’échelle de l’Île-de-France du mode de transport fluvial.»
 Alexis Rouque
Alexis Rouque
Le développement et la modernisation, après-guerre, des infrastructures portuaires franciliennes ont sévèrement touché le secteur de la batellerie artisanale dont le port de Conflans était un haut lieu. Il constitue aujourd’hui une des mailles du grand réseau géré par l’établissement public d’État Ports de Paris. 70 plateformes réparties le long de la Seine, de la Marne et de l’Oise, permettent le transport de 14 millions de tonnes de produits par an, dont 60 % de matériaux de construction et de déchets de chantier, mais aussi principalement des céréales et du mâchefer. Depuis les années 2000, l’essor du trafic de conteneur a permis de diversifier les produits. 17% des 1 300 000 d’EVP qui entrent et sortent d’Île-de-France transitent ainsi par voie fluviale.
Le réseau portuaire francilien prend appui sur les 6 grandes plateformes multimodales de Gennevilliers, Bonneuil-sur-Marne, Limay, Evry, Bruyères-sur-Oise et Montereau, où sont massifiés les flux de marchandises principalement à destination ou en provenance de Rouen et du Havre. Les quais de déchargement des 64 « ports urbains » complètent le réseau et offrent des possibilités de desserte plus fine de l’agglomération. Ces ports sont essentiellement utilisés par le secteur de la construction afin d’apporter les matériaux et de se débarrasser des déchets au plus près possible des chantiers. Cependant, la chaîne de distribution Franprix a récemment mis en place un système pour livrer 80 de ses magasins par voie d’eau, de Bonneuil-sur-Marne au port de la Bourdonnais au pied de la tour Eiffel. La réussite d’une telle initiative ouvre des perspectives pour développer le mode fluvial comme un des maillons de la logistique urbaine pour le transport de biens de consommation ou des déchets.
 Le Port Seine Métropole au sein des dynamiques fluviales mondialisées
Le Port Seine Métropole au sein des dynamiques fluviales mondialisées
«Aujourd’hui, le port de Paris c’est quand même Anvers. On ne peut plus imaginer une mégapole si elle n’a pas un rapport à la mer. Toutes les grandes métropoles s’articulent sur des fondamentaux géographiques, des côtes ou des fleuves.»
 Antoine Grumbach
Antoine Grumbach
Deux projets d’infrastructures d’envergure nationale pourraient faire augmenter significativement le transport fluvial de conteneurs. Port 2000, le développement d’un grand terminal pour les porte-conteneurs au Havre, et le canal Seine-Nord Europe qui reliera l’hinterland des ports d’Anvers, Zeebrugge et Rotterdam à celui des ports du Havre, et de Rouen, faisant de la métropole parisienne non plus un terminus mais un nœud du réseau de logistique fluviale européen.
Lors de la consultation internationale « le Grand pari de l’agglomération parisienne », Antoine Grumbach a développé la vision d’une métropole se développant le long de la vallée de la Seine jusqu’au Havre. Il a proposé la construction d’un nouveau grand port sur les communes d’Achères, Andrésy et Conflans-Sainte-Honorine, à la confluence Seine-Oise où se croiseront les flux de l’axe Seine et ceux provenant du canal Seine-Nord Europe. Cette hypothèse a depuis fait son chemin auprès des acteurs économiques et politiques. La réalisation, à l’ouest de la RN184, d’une première darse nécessaire à l’échelle régionale pour soulager le réseau portuaire saturé, est d’ores et déjà au stade de l’enquête publique. Il s’agit de permettre l’exploitation des granulats de la plaine d’Achères et de répondre aux besoins dans le domaine des travaux publics. Un quai à usages partagés offrira également un service de transbordement de matériaux et de marchandises aux entreprises locales. La construction d’une seconde darse dédiée au transport de conteneurs, à l’est de la RN 184, est pour l’instant conditionnée à la réalisation du canal Seine Nord Europe et au renforcement de la desserte routière par le prolongement de l’A104. Cette nouvelle plateforme portuaire pourrait s’appuyer sur la réactivation de la gare de triage du Grand Cormier, et permetre un rééquilibrage du fret ferroviaire vers l’ouest de l’Île-de-France.
 Port - ville : une relation à (ré)inventer
Port - ville : une relation à (ré)inventer
«Quand vous implantez une infrastructure comme celle-là, pour la ville d’Achères qui est mitoyenne du port, ça veut dire que d’une certaine façon vous l’invitez à se réinventer. Ça va poser toute une série de questions en termes de circulation, d’articulation entre la ville et le port, et soulever des problèmes de logement, d’accueil des entreprises.»
 Alexis Roucque
Alexis Roucque
La logistique fluviale est souvent qualifiée de mode doux car elle permet de réduire significativement les nuisances dues au trafic routier, notamment dans les zones d’extraction de granulats comme celle de la plaine d’Achères. Néanmoins, les plateformes multimodales portuaires comme celles de Gennevilliers ou Bonneuil-sur-Marne constituent de très grandes infrastructures, dont la logique de productivité s’accorde difficilement avec les logiques urbaines et environnementales. Ces grandes emprises fermées créent des coupures dans le paysage et la continuité des berges. Leur modèle actuel de construction implique une forte artificialisation des sols qui perturbe l’écosystème fluvial et renforce les risques en cas d’inondation. Le futur port d’Achères s’inscrit dans un environnement très préservé de l’agglomération parisienne, en bordure de la forêt de Saint-Germain-en-Laye et faisant face au paysage au caractère rural de la colline de l’Hautil et de la boucle de Chanteloup.
Un port est une opportunité pour des petites communes comme celles d’Achères, Andrésy ou Conflans, 500 à 1000 emplois directs sont prévus. Cependant, en termes de qualité urbaine, les ports contemporains n’apportent pas beaucoup aux lieux où ils sont implantés et constituent souvent l’arrière de la ville. L’image du quartier de port, mixte, dense et animé s’est perdue au profit de grandes zones clôturées et dédiées exclusivement à la logistique. La constitution d’une grande interconnexion en transports en commun avec les mises en service du RER Eole, de la Tangentielle ouest et de la ligne à grande vitesse Paris Normandie obligent à penser le port comme un lieu métropolitain et à y réinventer les rapports entre infrastructure, nature et ville.
 Un “port paysage”
Un “port paysage”
«On a toujours pensé que les ports ou l’urbanisation allaient contre la nature. Aujourd’hui, que ce soit l’urbanisation ou les grandes implantations industrielles, elles doivent avoir une espèce de culture écologique et environnementale qui était souvent négligée précédemment.»
 Antoine Grumbach
Antoine Grumbach
L’établissement public Ports de Paris a confié les études de conception du port d’Achères à une équipe pluridisciplinaire ayant pour mandataire Antoine Grumbach et composée d’Egis, Thierry Laverne paysagiste, et du bureau d’étude environnement Space.
Un premier enjeu a été d’imaginer un « vrai travail de transformation du territoire pour ne pas impacter les grandes crues et les laisser s’essuyer et traverser l’ensemble de la plaine et des futures installations portuaires ». Celles-ci s’organiseront donc en plateformes successives parallèles au courant du fleuve, mises hors-d’eau grâce aux remblais liés à l’excavation de la darse et séparées par de grandes traversées paysagères inondables.
Un aspect important du Port Seine-Métropole Ouest, première phase du projet, concerne son inscription dans le paysage et ses pratiques. Le choix de créer une darse plutôt qu’un quai directement au bord du fleuve, permettra de préserver et de renaturer les berges de Seine et de conserver une continuité pour les circulations douces le long de la Seine. Plus de 15% de l’emprise totale du projet a été réservée pour des espaces publics fortement plantés afin de rendre traversante la plateforme et relier la ville au fleuve. Ces espaces étant pensés en complémentarités des deux parcs urbains prévus autour du projet portuaire. L’ambition est de requalifier globalement les panoramas depuis les coteaux de Conflans, d’Andrésy et de la colline de l’Hautil.
La question de l’urbanité reste ouverte, notamment pour la réalisation de la deuxième phase du port. Au-delà de la construction de lieux de vie liés à l’activité du site, il serait possible de faire cohabiter les installations portuaires avec de grands équipements métropolitains comme l’a proposé l’agence l’AUC dans leur étude plus large sur le contrat de développement territorial de la Confluence.
 Port Seine Métropole - 2011-2014Mission : assistance pour la préparation et le suivi du débat public menée par la CNDP
Port Seine Métropole - 2011-2014Mission : assistance pour la préparation et le suivi du débat public menée par la CNDP
Maîtrise d’ouvrage : Haropa - Ports de Paris / Région Île-de-France / Union européenne
Maîtrise d'oeuvre : Antoine Grumbach et associés (mandataire) + Agence Laverne paysagistes + Theorit consultancy + Egis France + S'pace
 Territoires d'échanges :
Territoires d'échanges :
<
La Confluence Seine-Oise : une polarité composée
CDT - la Confluence Seine-Oise
255 km²
29 communes
416 000 habitants
170 000
emplois – taux d’emploi de 0,8
72 000 m²
de parc d’entrepôts industriels et logistiques, en grande partie à Saint-Ouen-l’Aumône
 Les “réseaux de valeur” du port
Les “réseaux de valeur” du port
«La plateforme est un enjeu métropolitain, mais il est important pour les élus de voir ce qu’ils peuvent en retirer pour le développement territorial. Nous avons travaillé avec l’appui de la DATAR pour voir ce qu’on pouvait faire sur la chaîne de transports, la logistique du dernier kilomètre.»
 David Morgant
David Morgant
Le projet du port d’Achères découle d’une stratégie nationale visant à dynamiser le transport fluvial. Au-delà de cette volonté de capter des flux logistique à très grande échelle, les acteurs économiques et politiques locaux se sont mobilisés pour réfléchir aux incidences territoriales possibles de cette grande infrastructure. Comment faire pour que le port ne soit pas uniquement un lieu de transit de produits mais qu’il interagisse avec les filières économiques locales ?
Le territoire de la confluence de la Seine et de l’Oise n’a pas été identifié dans la première cartographie des clusters du Grand Paris en 2008, mais d’autres outils comme ceux développés par la DATAR sur les « réseaux de valeur » ont accompagné la territorialisation du projet du port d’Achères. Cette méthode expérimentale de développement économique repose sur l’identification dans un territoire des acteurs pionniers complémentaires, du fournisseur de matière première au client, qui, en se regroupant, seraient susceptibles de capter ensemble de nouveaux marchés.
Un travail a ainsi été mené par l’EPAMSA sur les réseaux de valeurs de la logistique innovante. Il a mis en évidence les complémentarités possibles entre le futur port et les entreprises innovantes et centres de recherche et de formation présents à Cergy-Pontoise. En lien avec les pôles de compétitivité Nov@log et Mov’eo, il est ainsi prévu de développer des projets de recherche et des brevets dans le secteur de la batellerie et des véhicules destinés au transport du dernier kilomètre, et de travailler à la création d’entrepôts innovants et de nouvelles solutions logistiques avec les filières industrielles existantes comme l’automobile ou le textile.
Une société de co-développement devrait être créée prochainement pour animer ces réseaux. Un enjeu majeur pour elle sera d’œuvrer à ce que les innovations développées puissent diffuser dans toute la métropole et accompagner la transformation de toute la chaîne logistique.
 Un «multi-pôle» qui tente de se fédérer
Un «multi-pôle» qui tente de se fédérer
«L’opportunité de réindustrialisation de la vallée de la Seine est un enjeu extrêmement important pour nous. Depuis les années 70-80 l’industrie a nettement diminué. Il s’agit de lui redonner une dynamique. Je pense qu’à travers le port il y a des opportunités extrêmement intéressantes.»
 Hugues Ribault
Hugues Ribault
Le territoire de la Confluence Seine-Oise est un ensemble plutôt hétérogène de 29 communes rassemblant 416 000 habitants et 170 000 emplois. Trois pôles urbains qui se sont développés selon des logiques singulières, concentrent la majeure partie de la population et des emplois. Les villes du bord de Seine, qui ont subi une désindustrialisation partielle, mais restent des pôles d’emplois importants, notamment Poissy avec 25 000 emplois. La ville nouvelle de Cergy-Pontoise, polarité mixte concentrant 53% des emplois du territoire et mêlant centre administratif et universitaire, activités industrielles et de logistique. Et la ville historique de Saint-Germain-en-Laye très résidentielle mais comptant tout de même 21 000 emplois principalement dans le secteur tertiaire. Le reste du territoire est occupé par des communes à caractère rural et dominé par les activités agricoles et de loisirs.
Ce vaste ensemble connaît aujourd’hui une perte d’attractivité démographique et continue d’être touché par la crise industrielle. Le taux de chômage atteint ainsi 16% dans certaines communes. Le port d’Achères et les réseaux de valeur de la logistique et de l’éco-mobilité doivent participer à relancer la dynamique du territoire. Mais les acteurs locaux misent également, avec l’EPAMSA, pour le développement du secteur des éco-industries et de l’éco-construction notamment dans la boucle de Chanteloup.
La réalisation de plusieurs grands projets infrastructurels dans les prochaines années, comme le RER Eole, la Tangentielle Ouest, la LNPN ou le prolongement de l’A104, devrait renforcer considérablement le maillage du territoire et appuyer ces nouvelles dynamiques économiques.
 Un urbanisme en filament
Un urbanisme en filament
«Nous avons toujours prisle contrepied des actes planificateurs à 100%. La planification est indispensable, mais nous pensons qu’il est aussi possible de faire naître les projets plutôt de l’intérieur. J’ai interprété la commande qui nous était faite comme une espèce de plateforme pour mettre les gens autour de la table et réfléchir au devenir d’un territoire au-delà d’un projet de port. Comment ça pouvait faire métropole localement et finalement intéresser les gens.»
 François Decoster
François Decoster
D’importantes études menées dans le cadre de l’OIN Seine-Aval, par Antoine Grumbach ou l’agence LIN, ont permis de développer une lecture à grande échelle de l’urbanisation de la vallée de la Seine. En 2010, L’AUC a ensuite été chargée par l’EPAMSA de la maîtrise d’œuvre d’une étude préparatoire à l’élaboration du CDT Confluence Seine-Oise. Un travail réalisé avec un groupement pluridisciplinaire autour de trois thématiques : mobilité / développement économique / urbanisme, planification, paysage, développement durable.
Comment dépasser le côté “un peu violent” des grands projets infrastructurels définis par la planification et arriver à mettre en route un projet ce vaste territoire très hétérogène ? En lien avec le principe des réseaux de valeurs développé par les économistes du groupement, L’AUC a développé un “urbanisme en filament”qui s’appuie sur les projets locaux engagés ou en réflexion. Les architectes urbanistes ont ainsi identifié 5 filaments, c’est-à-dire des problématiques que certaines communes partageaient les unes avec les autres, pas forcément toutes ensemble. Comme l’a expliqué François Decoster, cela a permis aux acteurs du territoire de parler d’une question ou d’un potentiel qu’ils avaient en commun, sans pour autant mettre en partage la totalité de leur devenir. L’agence a expérimenté une forme de pédagogie pour illustrer ce “tissage des potentialités du territoire”, en racontant des histoires en rapport avec chaque filament, à partir de personnages fictifs qui venaient pratiquer le territoire. De là, il a alors été possible de déterminer un certain nombre de secteurs de projet qui “combinés les uns avec les autres pouvaient donner une forme de ville spécifique pour cette partie de l’ouest parisien. ”
 Étude préparatoire à l’élaboration du CDT Confluence Seine-Oise - 2010-2011Mission : Assistance à la maïtrise d'ouvrage(AMO)
Étude préparatoire à l’élaboration du CDT Confluence Seine-Oise - 2010-2011Mission : Assistance à la maïtrise d'ouvrage(AMO)
Maîtrise d’ouvrage : EPAMSA
Maîtrise d'oeuvre : l’AUC - l’AUC as + MSC + d’ici là + Franck Boutté Consultants SYSTRA
+ TRANSITEC CMI + Frédéric Gilli (agence Campana Eleb Sablic)
 Des coopération territoriales récentes
Des coopération territoriales récentes
«Il y a quelques années, chacun était dans sa petite ville avec ses projets, un peu concurrents de ceux du voisin. Le port d’Achères, le canal Seine-Nord-Europe, plus les dispositifs de l’OIN et du CDT, toutes ces mécaniques qui ont vu le jour ces dernières années ont permis aux élus d’échanger sur des projets qui dépassent le périmètre de leur commune. Nous nous sommes aperçus que nous avions en commun un territoire de projet.»
 Francis Toqué
Francis Toqué
Hormis la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, qui a connu un développement intercommunal intégré et constitue depuis 2004 une communauté d’agglomération, le territoire s’est urbanisé essentiellement à l’échelle communale, dans le cadre de la planification régionale. C’est à partir du milieu des années 2000 que des logiques de coopération entre communes ont été mises en place avec la création de la communauté d’agglomération des deux rives de Seine, et la mise en place de l’opération d’intérêt national Seine Aval. Elle rassemble 51 communes riveraines de la Seine, touchées par la désindustrialisation depuis les années 70. Une agence d’urbanisme, l’AUDAS, a été créée en 2006 pour accompagner la mise en œuvre de cette OIN de troisième génération où il ne s’agit plus d’inventer une “nouvelle ville” mais de ré-inventer un territoire déjà structuré en le rassemblant autour d’un projet fédérateur.
Le projet du Grand Paris et la démarche autour de l’axe Seine, ont poussé les élus de 28 communes du territoire à se regrouper pour créer l’association Confluence-Seine-Oise en 2011, afin de pouvoir peser dans ces deux grands projets. Associé avec la ville de Saint-Germain-en-Laye, ce grand territoire devient la 4ème polarité urbaine de l’axe Seine. De quoi établir le dialogue avec l’Etat et travailler à l’élaboration d’un contrat de développement territorial. Une étude préparatoire a été menée par l’EPAMSA en collaboration avec les communes en 2010-2011 et a permis d’aboutir à la signature d’un accord cadre en 2013, mais le projet n'a finalement pas abouti faute de volonté des élus. Comme l’a rappelé Francis Toqué, tous ces enjeux communs ont néanmoins permis à l’établissement public de coopération intercommunal Poissy-Achères Conflans de voir le jour en 2014.
 Achères dans le Grand Paris
Achères dans le Grand Paris
La vision d'Antoine Grumbach
«
Seine Métropole: le grands principes du projet
[...] Dans la concurrence entre les grandes aires métropolitaines de la mondialisation, on doit s’interroger aujourd’hui – en France et en Europe – sur le lieu et l’existence de ces entités urbaines. Le Havre, port de Paris et de l’Europe, au transit accru vers les nouveaux venus de l’Union européenne, doit s’ouvrir. Fernand Braudel et Jacques Attali ont tous deux démontré que toute grande métropole a un port et que Paris souffre d’être trop continentale.
La Seine, fleuve chargé d’histoire, dont l’identité géographique peut être partagée par tous, définit « Seine Métropole », une réponse à la perte d’identité de l’agglomération parisienne. Le développement radioconcentrique de Paris et des communes qui l’entourent s’est étendu jusqu’à dissoudre la représentation collective partagée par les habitants jusqu’à la fin du 19e siècle. La vallée de la Seine offre l’opportunité d’un développement métropolitain linéaire et multipolaire, associé à des espaces naturels d’une qualité exceptionnelle. L’opposition ville nature est en passe d’y être révolue. L’agriculture urbaine devient l’un des enjeux de l’après-Kyoto, pour des raisons de sécurité alimentaire et d’économie – dans la perspective d’une taxation carbone des produits lointains. La solidarité entre l’urbain et le rural, entre l’intensité et l’urbanisme diffus, est dorénavant indispensable pour penser la forme des métropoles contemporaines. [...]»
La grande échelle
Seine Métropole représente le cadre idéal pour aborder l’après-Kyoto en ce qu’il a été montré que seule la grande échelle permet de régler les effets négatifs conjugués de l’agriculture, de l’industrie, des déplacements et des constructions. La vallée de la Seine offre en outre le cadre d’une économie circulaire, permettant le recyclage de tous les déchets.
Cette opportunité écologique ne doit pas occulter que la prise en compte de la grande échelle dans la réponse à la question posée sur le Grand Pari de l’agglomération parisienne répond à une autre question : celle de savoir quelle métropole européenne peut accrocher l’Europe à sa façade atlantique. Seine Métropole, avec son réseau de villes, ses activités économiques et industrielles, son port et sa dimension culturelle, répond parfaitement à cette question.
La grande échelle correspond par ailleurs à la dimension des planifications des métropoles mondiales. A Shanghai, l’échelle de réflexion correspond à l’ensemble Paris, Londres, Randstad ; la Côte Est des états-Unis élabore une planification qui englobe Boston, New York et Washington. Ces dispositifs correspondent à l’évolution des transports ferrés à grande vitesse où le train s’est substitué à l’avion pour toutes les destinations à moins d’une heure de vol.» La future ligne à grande vitesse inscrit le port du Havre dans une position analogue à celle d’Orléans, R eims ou Amiens, villes à une heure de Paris. La grande échelle est indissociable d’une stratégie de déplacements et d’une offre résidentielle diversifiée entre l’intensité urbaine et l’urbanisme diffus, réalisant ainsi la fin de l’opposition entre monde Urbain et monde Naturel.
 Antoine Grumbach
Antoine Grumbach
 La carte interactive
La carte interactive
 Pour aller plus loin...
Pour aller plus loin...
- Le port Seine Métropole et le Canal Seine Nord Europe
 Port-Seine Métropole Ouest, Dossier du maître d’ouvrage pour le débat public, 2014
Port-Seine Métropole Ouest, Dossier du maître d’ouvrage pour le débat public, 2014 Schéma de services portuaires d’Île-de-France, une vision partagée à l’horizon 2020-2025, Ports-de-paris, 2013
Schéma de services portuaires d’Île-de-France, une vision partagée à l’horizon 2020-2025, Ports-de-paris, 2013 Le site du débat public, Commission nationale du débat public
Le site du débat public, Commission nationale du débat public Site dédié de Voies navigables de France (VNF)
Site dédié de Voies navigables de France (VNF)
- Logistique innovante
 La filière logistique en Seine Aval, Agence d’urbanisme et de développement Seine Aval, AUDAS, 2011
La filière logistique en Seine Aval, Agence d’urbanisme et de développement Seine Aval, AUDAS, 2011 Renouveau du fluvial et dynamiques métropolitaines, Le cas des ports fluviaux franciliens (1980-2010), Elsa Paffoni, thèse de doctorat à l’IFSTTAR, 2013
Renouveau du fluvial et dynamiques métropolitaines, Le cas des ports fluviaux franciliens (1980-2010), Elsa Paffoni, thèse de doctorat à l’IFSTTAR, 2013 L’Etude-action Territoires et innovation lancée par la DATAR en 2009
L’Etude-action Territoires et innovation lancée par la DATAR en 2009
- Confluence Seine-Oise
 Protocole d’accord préalable à l’élaboration du CDT de la Confluence
Protocole d’accord préalable à l’élaboration du CDT de la Confluence Fiche CDT, Confluence Seine-Oise, IAU, 2013
Fiche CDT, Confluence Seine-Oise, IAU, 2013 Portrait de territoire : Confluence Seine-Oise, DRIEA, 2013
Portrait de territoire : Confluence Seine-Oise, DRIEA, 2013 Consultation Plaine d’Achères-Grande Arche – Synthèse, APUR, 2011
Consultation Plaine d’Achères-Grande Arche – Synthèse, APUR, 2011
- Seine Aval
 La démarche Seine Park, EPAMSA
La démarche Seine Park, EPAMSA Protocole de l’opération d’intérêt national Seine Aval, EPAMSA, 2008
Protocole de l’opération d’intérêt national Seine Aval, EPAMSA, 2008 Etude de la composition urbaine et paysagère de la Seine Aval, Antoine Grumbach et associés, 2008
Etude de la composition urbaine et paysagère de la Seine Aval, Antoine Grumbach et associés, 2008
- L'axe Seine
 Le rapport Seine Gateway, Agence d’urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire de la Seine (AURH), 2012
Le rapport Seine Gateway, Agence d’urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire de la Seine (AURH), 2012 Pour une stratégie de développement économique de l’Axe Seine, de Paris à la Mer - Préconisations des entreprises et des CCI, 2011
Pour une stratégie de développement économique de l’Axe Seine, de Paris à la Mer - Préconisations des entreprises et des CCI, 2011 Le Grand Paris et l’axe Seine - L’aménagement métropolitain à l’âge de la concurrence néolibérale, Brennetot Arnaud, Michel Bussiet, Yves Guermond, 2013
Le Grand Paris et l’axe Seine - L’aménagement métropolitain à l’âge de la concurrence néolibérale, Brennetot Arnaud, Michel Bussiet, Yves Guermond, 2013 Seine Métropole, Paris Rouen Havre, le diagnostic prospectif de l’agglomération parisienne, Antoine Grumbach& Associés, Archibooks, 2009
Seine Métropole, Paris Rouen Havre, le diagnostic prospectif de l’agglomération parisienne, Antoine Grumbach& Associés, Archibooks, 2009



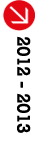
 Situation Métabolique
Situation Métabolique Antoine Grumbach, Architecte, Agence Antoine Grumbach, membre du Conseil scientifique de l’AIGP
Antoine Grumbach, Architecte, Agence Antoine Grumbach, membre du Conseil scientifique de l’AIGP Lydia Mykolenko, Responsable des études fret et logistique à l’IAU IDF
Lydia Mykolenko, Responsable des études fret et logistique à l’IAU IDF Francis Toqué, Adjoint au maire de Conflans-Sainte-Honorine (1989-2014)
Francis Toqué, Adjoint au maire de Conflans-Sainte-Honorine (1989-2014) David Morgant, Directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement - Mantois Seine Aval
David Morgant, Directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement - Mantois Seine Aval Alexis Rouque, Directeur général de Ports de Paris
Alexis Rouque, Directeur général de Ports de Paris La logistique fluviale des ports de Paris
La logistique fluviale des ports de Paris Le Port Seine Métropole au sein des dynamiques fluviales mondialisées
Le Port Seine Métropole au sein des dynamiques fluviales mondialisées Port - ville : une relation à (ré)inventer
Port - ville : une relation à (ré)inventer Un “port paysage”
Un “port paysage” Port Seine Métropole - 2011-2014
Port Seine Métropole - 2011-2014 Les “réseaux de valeur” du port
Les “réseaux de valeur” du port Un «multi-pôle» qui tente de se fédérer
Un «multi-pôle» qui tente de se fédérer Un urbanisme en filament
Un urbanisme en filament Des coopération territoriales récentes
Des coopération territoriales récentes

