La voie des airs : Roissy, hub mondial / 11 octobre 2012
Alors que la fonction de hub multimodal de Roissy est en train de se renforcer avec le développement d’un réseau de fret TGV européen, se développe autour des pistes et des plateformes logistiques une vaste ville aéroportuaire, agrégeant centres d’affaires, espaces de bureaux et de services, centres commerciaux, hôtellerie et restauration, espaces culturels et de loisirs.
Les intervenants
Mathis Güller, Architecte, Agence Güller Güller membre du Conseil scientifique de l’AIGP
Daniel Behar, Professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris, consultant à la coopérative Acadie, membre du conseil scientifique de l’AIGP.
Nathalie Roseau, Ingénieure, architecte et docteur en urbanisme, Maître de conférences à l’École des Ponts ParisTech, membre du Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (Université Paris Est)
Jacques J.P. Martin, Premier vice-président de Paris Métropole (2010-2011), Maire de Nogent-sur-Marne
Didier Vaillant, Président de la Communauté d’Agglomération Val-de-France.
Yves Lochouarn, Directeur général des services de la Communauté de Roissy-Portes-de-France.
Damien Robert, Directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement - Plaine de France.
 Situation métabolique:
Situation métabolique:
De l’aéroport
à la “ville aéroportuaire”
L’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle c'est :
3200 ha
: ensemble des pistes, terminaux et entrepôts logistiques ,
90 000
emplois dont 15 000
dans la zone Cargo de CDG ,
7ème
rang mondial pour le transport de marchandises ,
3%
du volume de marchandises transportées à l’international ,
soit 2 100 000
tonnes de fret ,
2ème
aéroport européen pour le transport de passagers ,
500
destinations et plus de 60
millions de passagers
L’aéroport : flux logistiques et transports de passagers
«Il y a quelque chose de très attractif et de très sexy dans le trafic aérien, c’est l’idée du voyage. La notion de Hub, c’est aussi une notion de déplacement de l’homme. Il y a deux logiques économiques autour du fret et autour du transport de passagers. Cela alimente des activités économiques qui ont vocation à se concentrer autour de l’aéroport.»
 Mathis Güller
Mathis Güller
Le fret aérien représente aujourd’hui 47% en valeur du commerce international, mais seulement 3% du volume de marchandises transportées*. Il reste réservé aux produits à forte valeur intrinsèque ou qui nécessitent une expédition rapide comme le courrier ou les produits frais. Bien qu’il existe aujourd’hui des avions cargos gros porteurs dédiés spécifiquement au fret, il reste beaucoup plus rentable économiquement de charger celui-ci dans les soutes des avions de passager. Plus de la moitié des 2,1 millions de tonnes de fret aérien qui transitent à Roissy sont ainsi transportées dans les avions de ligne des quelques 150 compagnies aériennes présentes dans l’aéroport. C’est ce qui donne un côté « sexy», sinon humain, à ce grand hub mondial, où hommes et marchandises se croisent dans un univers de machines en mouvement incessant. La combinaison de ces deux dimensions est surtout un facteur d’attractivité majeur dans la compétition internationale qui se joue entre aéroports. Qui gagne des passagers, développe également son activité logistique. Avec plus de 60 millions de passagers, la plateforme aéroportuaire de Charles-de-Gaulle, exploitée depuis 2005 par la société anonyme Aéroports de Paris, se positionne ainsi aujourd’hui au 7ème rang mondial et au premier rang européen en termes de fret.
*chiffre TLF OAC - Syndicat national des Agents et Groupeurs de Fret aérien
 Une zone logistique en expansion
Une zone logistique en expansion
«Il y a une prise de conscience de l’interaction entre la logistique et les autres activités économiques.On ne fait plus seulement qu’entreposer et transporter, on assemble, on automatise on empaquette : la logistique en tant que telle monte en gamme et attire beaucoup de métiers connexes qui viennent changer les typologies d’emplois. La logistique occupe une place plus structurante puisqu’elle est à la croisée de toute l’activité économique.»
 Damien Robert
Damien Robert
Plusieurs projets visent à développer les activités logistiques de Roissy-Charles-de-Gaulle, dans l’optique d’un doublement à terme du tonnage opéré. Il s’agit pour cela de construire de nouveaux « bâtiments frontières », sortes de sas par lesquels les marchandises transitent pour aller de la zone réservée de l’aéroport à la zone publique où elles sont soit manipulées, soit expédiées dans les camions. Suite à plusieurs acquisitions foncières par ADP, l’actuelle zone cargo devrait s’étendre pour former une véritable ceinture au sud et à l’ouest de l’aéroport et créer plus de 2000 nouveaux emplois à l’horizon 2020.
Cette expansion prévue s’accompagne d’un renforcement de l’intermodalité du hub aéroportuaire. Le projet Cargo rail express (CAREX) vise à développer une plateforme en interconnexion avec les lignes TGV pour une charge de 700 000 tonnes/an de marchandises à terme. Elle constituera un des pôles du futur réseau européen de fret ferroviaire à grande vitesse qui permettra le report modal des camions et des vols courts et moyens courriers. Le renforcement des activités de fret passe également par l’accroissement en variété et en qualité des services offerts pour assurer la circulation de marchandises à plus forte valeur ajoutée. Ceci concerne les activités logistiques qui portent sur la gestion physique et informatique des flux et en assurent le dédouanement, l’entreposage, le reconditionnement et, de manière plus générale, la gestion dynamique.
 Organiser les lieux d'une “ville aéroportuaire”
Organiser les lieux d'une “ville aéroportuaire”
«On est dans le doublement de l’activité logistique, dans un emballement de la logistique généralisée, et tant qu’on sera là-dessus, la question de la montée en gamme des activités économique sera un doux rêve. Comment se poser la question de la maitrise du développement économique et de la sélectivité ?»
 Daniel Béhar
Daniel Béhar
Au-delà de l’emballement logistique qui consomme énormément d’espace, sans nécessairement beaucoup d’emplois à la clef, le transport de passagers ouvre la voie vers un concept de développement autrement plus porteur, celui d’« airport-city » ou de « ville aéroportuaire ». Un projet comme celui d’A-park, qui rassemble en un même espace à destination du commerce chinois, activités de logistique haute gamme, showrooms, hôtels, bureaux, recherche, centre commercial de gros, donne une bonne image de ce que pourraient être les composantes de cette ville aéroportuaire. Ce modèle de développement économique vise à conforter et renforcer l’attractivité des plateformes aéroportuaires en développant sur les emprises des aéroports, et à leur immédiate proximité, des services liés au commerce international, des fonctions métropolitaines, notamment en matière de congrès et salons, de la logistique à forte valeur ajoutée. Le centre de commerces et de services Aéroville, inauguré en octobre 2013 sur les terrains d’ADP au sud de l’aéroport, a ouvert la voie de cette grande transformation du paysage aéroportuaire. Mais pour passer de ce modèle économique à une véritable espace métropolitain, une certaine maîtrise du développement économique est nécessaire comme l’a rappelé Daniel Behar. Les travaux menés dans le cadre de l’élaboration du CDT Coeur économique Roissy Terres de France (CERTF) ont commencé à poser les conditions de cette urbanité nouvelle.
 Le corridor métropolitain : une mise en scène du développement économique
Le corridor métropolitain : une mise en scène du développement économique
« Ce plongeon dans la matérialité historique [étude du patrimoine aéroportuaire] nous montre que cette ville-aéroport n’a jamais cessé d’exister.»
 Nathalie Roseau
Nathalie Roseau
«Il faut capitaliser les atouts paysagers. Ces secteurs aéroportuaires sont souvent considérés comme des bassins de développement fonciers et on sous valorise complètement le fait qu’il y a un paysage existant identitaire qui peut renforcer la qualité de vie et qu’on n’intègre pas à la réflexion.»
 Mathis Güller
Mathis Güller
Les propos de Nathalie Roseau et Mathis Güller rappelent que la « ville aéroportuaire » ne surgira pas des champs. Il s’agit d’entreprendre la mutation d’un patrimoine et d’un paysage à l’identité très forte, même si la plupart des éléments qui le constituent semblent avoir été construits successivement au gré des opportunités sans une véritable logique d’ensemble autre que celle de l’accessibilité automobile.
Les notions de « corridor aéroportuaire » et de mise en réseau des parcs urbains, développées dans l’étude pour l’aménagement durable du territoire aéroportuaire du Grand Roissy, ont été approfondies dans le cadre du CDT CERTF, afin de définir une trame de continuités urbaines et paysagères. Le projet d’un corridor métropolitain reliant le PIEX de Villepinte à Roissypole, au cœur de la plateforme aéroportuaire est envisagé. Il s’agit de réduire l’effet de fragmentation de l’espace généré par les infrastructures, ainsi que de minimiser la sectorisation des fonctions entre les différents sites en créant entre eux une continuité urbaine et paysagère structurée par une ligne de bus à haut niveau de service, le CoMet. Cette corridor est destiné à être support de densification et à accueillir au fil du temps des activités et des équipements de vocation métropolitaine. On retrouve ici, à une échelle bien plus grande et distendue que celle des boulevards de la ville dense, la volonté de créer un espace public qui mette en scène et rende visible les dynamiques économique.
 Étude pour l’aménagement durable du territoire aéroportuaire Grand Roissy - 2010-2012Mission : Définition d'orientations et d'un schéma d'aménagement durable du grand territoire de Roissy
Étude pour l’aménagement durable du territoire aéroportuaire Grand Roissy - 2010-2012Mission : Définition d'orientations et d'un schéma d'aménagement durable du grand territoire de Roissy
Maîtrise d’ouvrage : DRIEA
Maîtrise d'oeuvre : Acadie (mandataire) / AECDP, Agence Elizabeth et Christian de Portzamparc + Agence Güller et Güller (co-traitants)
 Territoires d'échanges :
Territoires d'échanges :
Le coeur économique Roissy-Terres-de-France
Le coeur économique Roissy-Terres-de-France c'est :
6
communes, 109 000
habitants, 62,5
km² ,
50,8%
du territoire occupé par de l’urbain construit ,
130 000
emplois dont 36,9%
dans la logistique ,
taux d’emploi de 2,48
Le Grand Roissy c'est :
600 000 habitants ,
30%
de la logistique francilienne = 60 000
emplois ,
¼ des 250 000
emplois du territoire ,
+ 5%
par an de croissance économique
 Le cluster des échanges internationaux…
Le cluster des échanges internationaux…
«Pour moi le Grand Paris c’est un cluster, il n’y a pas dix clusters. La plateforme aéroportuaire, c’est le système aéroportuaire francilien. Nous avons donc réfléchi à la conjugaison des différentes plateformes, à UN hub francilien plutôt qu’à l’addition de plusieurs hubs. Nous avons également débattu d’une juste répartition des richesses fiscales générées par les aéroports. Tout ceci débouche sur la question de la gouvernance du système aéroportuaire.»
 Jacques J.P. Martin
Jacques J.P. Martin
La première version du projet du Grand Paris prévoyait autour des aéroports de Roissy et du Bourget un « cluster des échanges », mêlant activités de logistique, de services, et événementiel d’affaires, drainées par les flux de passagers et de marchandises. Une manière d’appuyer la constitution autour des pistes de cette fameuse « ville aéroportuaire » qui concentre déjà 125 000 emplois. Avec l’élaboration du CDT CERTF, les nombreux projets économiques du cluster ont pris forme dans un périmètre resserré autour de l’aéroport Charles de Gaulle. Les discussions ont fait émerger les besoins de se doter d’un observatoire dynamique du développement économique, pour améliorer la lisibilité et renforcer l’attractivité de ce « cœur économique » dans la compétition internationale.
Si l’aéroport de Roissy est aujourd’hui la porte principale du Grand Paris, les travaux menés à Paris Métropole sur la métropolisation des dynamiques aéroportuaires ont montré qu’il était indispensable de réfléchir à tout le système aéroportuaire et à des équilibres entre les différentes plateformes. Il en va de même en ce qui concerne les activités de l’événementiel et du tourisme d’affaire qui ne peuvent être pensées uniquement à l’aune de Roissy.
 … cœur économique du Grand Roissy
… cœur économique du Grand Roissy
«La plateforme aéroportuaire est mise en avant en tant qu’image de marque car elle rend visible le territoire, mais la réalité du développement économique réside dans le rapport de la métropole parisienne à l’Europe. Le vrai moteur de ce territoire c’est l’autoroute A1.»
«Roissy c’est un pôle, un pôle au niveau de la concentration de l’emploi, avec une croissance économique très au-dessus de la moyenne francilienne. On a un phénomène de dynamique, de concentration et de diffusion; le bassin domicile travail de Roissy est le plus diffus d’Île-de-France après Paris. On est donc vraiment dans un effet de pôle de ce point de vue-là. Seulement ce n’est pas une locomotive. Si l’on prend la part des cadres des fonctions métropolitaines dans l’emploi total, à chaque fois on est en-dessous de la moyenne régionale.»
 Daniel Béhar
Daniel Béhar
Entre l’échelle de la métropole et celle du CDT CERTF existe celle du Grand Roissy. C’est l’échelle mise en avant par les acteurs du développement et du marketting territorial comme Aérotropolis ou Hubstart Paris. Un territoire à 360° autour du cœur économique qui concentre activité et croissance économique mais les diffuse aussi dans un périmètre bien plus large.
Daniel Béhar a rappelé le rôle de moteur de l’autoroute A1 qui ouvre la métropole sur le nord-ouest européen. Cela est particulièrement vrai dans le secteur de la logistique dont les flux restent principalement routier. Le Grand Roissy regroupe ainsi déjà près de 30 % de la logistique francilienne, 60 000 emplois soit ¼ des 250 000 emplois du territoire. Et ce secteur se développe toujours fortement, même si une partie des entrepôts les plus anciens, proches de Paris, subit une reconversion tertiaire. Très présent dans le cœur économique, les services et activités liés au tourisme d’affaire participent depuis plusieurs années de la diversification et de la croissance économique à plus de 5%/an du Grand Roissy. Cependant, la part des cadres des fonctions métropolitaines reste inférieure à la moyenne francilienne et les inégalités sociales sont très fortes dans ce territoire.
 Une ville dont le centre serait l’aéroport ?
Une ville dont le centre serait l’aéroport ?
«On ne pense l’aéroport qu’en termes d’infrastructure et de volume de fret ou de passagers. Il a fallu 50 ans pour comprendre que l’infrastructure qui relie Paris au monde n’est pas en dehors de la ville. La ville court derrière Roissy.»
 Mathis Guller
Mathis Guller
«Pour faire ville, il y a un enjeu majeur c’est l’habitabilité du territoire. Et là on assiste à un effet inverse : aujourd’hui il y a une dynamique de l’emploi et une panne du secteur résidentiel en général. Le boom économique à complètement décroché de l’habitat.»
 Daniel Béhar
Daniel Béhar
Si le concept de « ville aéroportuaire » est utilisé pour décrire la densification et la diversification des activités qui gravitent autour des pistes de l’aéroport, cet espace reste cependant une vaste zone économique relativement autarcique. Le terme de ville est plus légitime à l’échelle du Grand Roissy, où se posent les véritables problèmes urbains, au premier chef ceux de l’habitabilité, de la mobilité et de l’accès à l’emploi.
La DRIEA a confié en 2010 une étude sur l’aménagement durable du territoire aéroportuaire du Grand Roissy au groupement Acadie - Atelier Christian de Portzamparc - Agence Güller et Güller. Une tentative d’envisager ce vaste territoire construit au fil de l’eau comme une « aerotropolis », selon le concept de l’économiste américain John Kasarda. Le pari d’une ville dont le centre ne serait plus au croisement des flux terrestres mais des flux aériens de l’aéroport. Un travail conséquent a été réalisé par le groupement pour réfléchir globalement à une maîtrise du développement économique, et stopper le mitage généré par des activités comme la logistique en les regroupant dans des plateformes. L’accent a été mis sur l’amélioration des conditions d’habitabilités de ce territoire marqué par de fortes nuisances mais disposant d’atouts paysagers importants. Un cercle vert reliant les parcs urbains du sud de la plateforme avec les grands espaces agricoles à préserver situés au nord a été notamment proposé.
 Étude pour l’aménagement durable du territoire aéroportuaire Grand Roissy - 2010-2012
Étude pour l’aménagement durable du territoire aéroportuaire Grand Roissy - 2010-2012Mission : Définition d'orientations et d'un schéma d'aménagement durable du grand territoire de Roissy
Maîtrise d’ouvrage : DRIEA
Maîtrise d'oeuvre : Acadie (mandataire) / AECDP, Agence Elizabeth et Christian de Portzamparc + Agence Güller et Güller (co-traitants)
Des coopérations à plusieurs échelles…
«Les élus de l’est du Val d’Oise ont commencé à coopérer depuis 1988. Nous avons mis en place un des premiers SCOT en Île-de-France. C’est cette capacité à travailler ensemble qui nous permet d’envisager la mise en place d’une plus grande structure avec le Grand Roissy. C’est une ambition forte, que nous ne pouvons mener seuls et donc avec l’EPA Plaine de France.»
 Yves Lochouarn
Yves Lochouarn
« On parle de populations équivalentes aux villes de Montpellier, Rennes, ou Lille. Dans ces villes un seul maire, sur notre territoire 24. Ou plutôt 25 avec ADP qui décide tout seul alors que les 24 se mettent d’accord.»
 Daniel Vaillant
Daniel Vaillant
Les acteurs économiques et notamment l’association Roissy-entreprises, créée en 1992, ont les premiers pris acte des nombreux freins au développement générés par l’absence d’une gouvernance et d’une vision spatiale à grande échelle. A commencer par les questions d’accessibilité de la plateforme aéroportuaire. La création de l'Établissement Public d'Aménagement Plaine de France en 2002 a posé les bases d'une démarche territoriale dans ce territoire très dynamique et paradoxalement très paupérisé. Lorsque le projet du Grand Paris a été lancé par l’Etat en 2008, ils ont poussé à la mise en place de la démarche du Grand Roissy, un espace de dialogue entre l’Etat, les collectivités, les entreprises et les associations. En 2011, les collectivités du Grand Roissy se sont regroupées pour former une association qui représente près de 600 000 habitants. L’étude de la DRIEA a participé à la création d’un cadre de coopération qui se traduit par l’organisation d’une conférence territoriale annuelle où sont débattus les sujets majeurs et devrait déboucher sur la définition d’un SCOT du Grand Roissy.
L’échelle de la mise en œuvre opérationnelle reste cependant plus restreinte. Trois contrats de développement territorial, entre l’Etat et les collectivités concernées par le futur réseau de transport du grand Paris, ont été mis en route dans le Grand Roissy, en collaboration étroite avec l’EPA Plaine de France, acteur majeur de l’aménagement du territoire.
 Roissy dans le Grand Paris
Roissy dans le Grand Paris
La vision de l'équipe de Portzamparc
«
Un territoire traversé par des tuyaux d’infrastructure
Comme nous l’avons vu, le constat de la dynamique fonctionnelle et économique se double d’un constat de fractures physiques de ce territoire. Autour des grandes métropoles, ce constat n’est pas unique, il est même l’héritage d’une pensée plus ancienne où d’autres enjeux de performance, de vitesse et d’efficacité étaient prédominants.
La dynamique fonctionnelle a submergé la dynamique spatiale. L’interaction de ces deux dynamiques est constante et ancienne. La logique technique des implantations des infrastructures a laissé pour compte l’espace physique. La métropole installe les fonctions qui lui sont nécessaires sur le grand territoire dont elle a besoin. Ces systèmes de connexion, la plupart du temps à grande vitesse, ne sont plus attachés à l’espace physique de proximité; soit ils le traversent et le coupent comme les réseaux ferroviaires et d’autoroute, soit ils le câblent, le survolent ou le maillent par des réseaux d’ondes.
Dans cette métropole le principe de la hiérarchie des proximités est éclaté. Ce nouvel espace, créé par et pour les réseaux est difficile à vivre. Ici, la métropole apparaît comme un labyrinthe de l’immensité in-appréhendable. Une difficulté à se retrouver, à appréhender l’espace physique. Réfugié derrière nos GPS, personne ne comprend plus l’ensemble et ne parvient à se représenter mentalement l’espace que l’on traverse.
Dans cette métropole fonctionnelle, la pratique de l’espace physique par le piéton n’est plus possible, inutile d’essayer de retrouver son chemin par des repères locaux. Cette organisation est le grand héritage du XXème siècle. Il marque la plus grande surface des villes et accueille en France plus de la moitié de la population.
Spatialement, le territoire est fortement marqué par la présence des tuyaux. Le réseau de voies rapides (trains, autoroutes) qui traverse, enjambe et le plus souvent sectionne, découpe et enferme les territoires en poches.
Des plaques monofonctionnelles/logique de la performance.
Ces réseaux ont créés des poches de territoires de plus en plus figées, spécialisées (zone d’activités, zone logistique, zone commerciale, zone pavillonnaire, …). Ces liens fonctionnels sont indispensables au bon fonctionnement de la métropole mais deviennent pénalisant et paralysant pour constituer la ville de demain. La métropole voit ses espaces bloqués au « libre jeu du temps ».
Nous avons dit que la métropole installe les fonctions qui lui sont nécessaires sur le grand territoire dont elle a besoin.
La métropole a besoin de périphéries beaucoup plus actives, complexes et spatialement éclatées. Les pôles fonctionnels de la métropole sont plus importants, plus différenciés ils communiquent directement entre eux et avec les gares et les aéroports dans des logiques de réseaux de communications dont la spatialisation échappe à la métropole elle-même.
L’implantation de ces pôles performants a répondu et répond au développement des fonctions d’ouverture au monde dont a besoin la métropole. Ce développement s’est fait au détriment de la cohésion et de la qualité urbaine locale. D’autre part les mutations du tissu urbain, sa densification notamment, tendent à repousser plus loin vers la périphérie les grandes fonctions métropolitaines. En ces lieux la contradiction structurelle entre le potentiel de développement d’emplois, de quartiers, de tertiaires, d’équipements et la conjonction de transport est à son comble.
»Pourtant ces pôles d’excellence sont indispensables à la vie métropolitaine comme à la vie locale qu’ils peuvent entraîner. Tout l’enjeu consiste donc à intervenir afin de rendre compatible le développement de la compétitivité mondiale et la qualité de la vie quotidienne : fabriquer de l’urbanité.
 Agences Elizabeth et Christian de Portzamparc
Agences Elizabeth et Christian de Portzamparc
 La carte interactive
La carte interactive
 Pour aller plus loin...
Pour aller plus loin...
- L'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, Hub logistique
 Le fret aérien, Hubstart Paris
Le fret aérien, Hubstart Paris L'implantation du projet CAREX Paris, EPA Plaine de France, 2012
L'implantation du projet CAREX Paris, EPA Plaine de France, 2012
- Le fret aérien
 Le fret aérien : une importance méconnue - DAST
Le fret aérien : une importance méconnue - DAST Les hubs de fret aérien express, Yves BOQUET, 2009
Les hubs de fret aérien express, Yves BOQUET, 2009 Programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres - Groupe opérationnel 4 : Logistique et transport de marchandises
Programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres - Groupe opérationnel 4 : Logistique et transport de marchandises Le site du Syndicat national des Agents et Groupeurs de Fret aérien (TLF OAC)
Le site du Syndicat national des Agents et Groupeurs de Fret aérien (TLF OAC)
- Le système aéroportuaire francilien
 Le groupe de travail de Paris Métropole « aéroports », 2010-2012
Le groupe de travail de Paris Métropole « aéroports », 2010-2012 Le système aéroportuaire francilien, IAUîdF, 2010
Le système aéroportuaire francilien, IAUîdF, 2010 Les impacts territoriaux des aéroports, IAUîdF, 2011
Les impacts territoriaux des aéroports, IAUîdF, 2011 Politiques aéroportuaires : Quelle gouvernance en IDF? Etat des lieux et références étrangères, IAUîdF, 2012
Politiques aéroportuaires : Quelle gouvernance en IDF? Etat des lieux et références étrangères, IAUîdF, 2012
- Le CDT Coeur économique Roissy Terres de France
 Présentation du Contrat de développement territorial Coeur Economique Roissy Terres de France, EPA Plaine de France, 2013
Présentation du Contrat de développement territorial Coeur Economique Roissy Terres de France, EPA Plaine de France, 2013 Portrait de territoire : Coeur économique Roissy Terres de France, DRIEA, 2013
Portrait de territoire : Coeur économique Roissy Terres de France, DRIEA, 2013 Fiche CDT, Coeur Economique Roissy Terres de France, IAU, 2013
Fiche CDT, Coeur Economique Roissy Terres de France, IAU, 2013
- Le Grand Roissy et la Plaine de France
 L’étude d’orientations et schéma d’aménagement durable du grand territoire de Roissy, pilotée par la DRIEA, 2012
L’étude d’orientations et schéma d’aménagement durable du grand territoire de Roissy, pilotée par la DRIEA, 2012 Plaine de France : Les moteurs de développement, n° spécial Traits urbains, hiver 2011-2012
Plaine de France : Les moteurs de développement, n° spécial Traits urbains, hiver 2011-2012



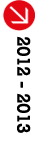
 Situation Métabolique
Situation Métabolique Mathis Güller, Architecte, Agence Güller Güller membre du Conseil scientifique de l’AIGP
Mathis Güller, Architecte, Agence Güller Güller membre du Conseil scientifique de l’AIGP  Nathalie Roseau, Ingénieure, architecte et docteur en urbanisme, Maître de conférences à l’École des Ponts ParisTech, membre du Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (Université Paris Est)
Nathalie Roseau, Ingénieure, architecte et docteur en urbanisme, Maître de conférences à l’École des Ponts ParisTech, membre du Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (Université Paris Est) Jacques J.P. Martin, Premier vice-président de Paris Métropole (2010-2011), Maire de Nogent-sur-Marne
Jacques J.P. Martin, Premier vice-président de Paris Métropole (2010-2011), Maire de Nogent-sur-Marne Damien Robert, Directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement - Plaine de France.
Damien Robert, Directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement - Plaine de France. Une zone logistique en expansion
Une zone logistique en expansion Organiser les lieux d'une “ville aéroportuaire”
Organiser les lieux d'une “ville aéroportuaire” Le corridor métropolitain : une mise en scène du développement économique
Le corridor métropolitain : une mise en scène du développement économique Étude pour l’aménagement durable du territoire aéroportuaire Grand Roissy - 2010-2012
Étude pour l’aménagement durable du territoire aéroportuaire Grand Roissy - 2010-2012 Le cluster des échanges internationaux…
Le cluster des échanges internationaux… … cœur économique du Grand Roissy
… cœur économique du Grand Roissy Une ville dont le centre serait l’aéroport ?
Une ville dont le centre serait l’aéroport ?

