Le grand marché: Rungis, ventre du Grand Paris / 6 décembre 2012
Le marché de Rungis est une véritable ville dans la ville dédiée à la distribution des produits frais. Il fait partie d’un ensemble logistique plus grand qui s’étend jusqu’à l’aéroport Orly. Dans ces territoires ultra-spécialisés, hier en périphérie de l’agglomération, vont se construire de nouvelles logiques urbaines.
Les intervenants
Christian de Portzamparc, Architecte, Agence Christian de Portzamparc, membre du Conseil scientifique de l’AIGP
Daniel Behar, Professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris, consultant à la coopérative Acadie, membre du conseil scientifique de l’AIGP.
Eliane Dutarte, Conseillère du Délégué pour la Région Capitale à la DATAR
Christian Hervy, Maire de Chevilly-Larue (2003-2014)
Jacques Touchefeu, Directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis – Seine Amont
Francis Lefevre, Secrétaire général de la SEMMARIS
Situation métabolique:
Le MIN de Rungis : Une machine métropolitaine
qui s'ouvre au local
Le Marché d'Intérêt National de Rungis c'est :
234
hectares ,
1200
entreprises , 11000
salariés ,
65%
des produits du marché sont distribués en Île-de-France ,
10 à 15%
partent vers l’étranger ,
50%
des produits proviennent de l’importation ,
2 à 3%
originaires de l’Île-de-France ,
1,6
millions de tonnes / an de produits alimentaires frais et fleurs à l’arrivage
Ventre du Grand Paris, marché international
« Les restaurants de Londres servent la salade du matin du producteur français à midi. Les producteurs du Nord de la France vendent le matin à Rungis qui vend à Londres. Rungis était un marché de dégagement, aujourd’hui nous sommes un marché de valorisation des produits. »
 Francis Lefèvre
Francis Lefèvre
L’activité du MIN de Rungis dépasse largement la fonction de marché de gros dédié aux restaurateurs et vendeurs au détail du bassin parisien. Sur les 4000 de tonnes de produits frais concentrés chaque jour à Rungis, 65 % est distribué en Île-de-France, 25% est vendu à l’échelle nationale et 10 % exporté à l’échelle européenne. Ainsi, plus de 40% des produits ne sont plus achetés directement sur place, mais livrés à des clients français ou des pays voisins. Certains produits de gastronomie sont même exportés dans le monde entier. Cette activité de gros (1,5M T/an), ainsi que la logistique de produits alimentaires (1M T/an), font du MIN un des points névralgiques du système de flux alimentaires européens. Le marché a accru son aire d’influence en misant sur des vitesses toujours plus grandes pour réduire les temps d’acheminement. 50 % des produits vendus à Rungis proviennent de l’étranger, une partie arrive à Roissy par avion, et la majorité par camion. Une ligne de fret ferré relie le MIN à Perpignan pour acheminer les fruits et légumes du Sud-ouest. Le nouveau terminal frigorifique va permettre d’augmenter ces arrivages par train ouvrant des perspectives pour le transport combiné rail-route et le train de fret à grande vitesse.
Les exploitations maraîchères d’Île-de-France nourrissent aujourd’hui 7% de la population régionale. Face à l’engouement croissant pour les produits de proximité, le MIN a ouvert une halle dédiée aux productions franciliennes représentant 2% des ventes. Cependant, son modèle reste principalement celui d’un marché centralisant et redistribuant les produits frais à grande échelle. Deux chantiers s’ouvrent pour cette machine industrielle engagée dans la réduction de son bilan environnemental : l’optimisation des flux longue distance dont l’empreinte écologique est déjà assez faible, et l’organisation d’un système de logistique urbaine pour réduire l’impact écologique des trajets entre le MIN et les lieux de vente et de consommation de l’agglomération parisienne.
Une cité de la gastronomie en 2020...
Le Min peut paraître un univers très industriel, il supporte cependant une valeur culturelle importante en France : l’alimentation. Le repas gastronomique des Français a été inscrit par l’UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2010. Le plan de sauvegarde de ce patrimoine prévoit la mise en place « d’actions en faveur de la transmission par l’éducation », « des travaux de documentation et de recherche », et « l’intégration dans les grandes manifestations culturelles nationales d’un volet dédié au repas gastronomique ». Le plan prévoit également la création d’un « équipement culturel pluridisciplinaire à dimension nationale et internationale ». C’est dans ce sens qu’est en train d’être mis en place le réseau des Cités de la gastronomie, officiellement lancé en 2013 par le ministère de l’agriculture. Le projet de Paris-Rungis a été retenu aux côté de ceux de Dijon, Lyon et Tours. Conçu en partenariat avec le MIN, il a “pour ambition de rendre accessible la diversité du patrimoine et des savoir-faire culinaires tant français que mondiaux, à travers les projets que sont la Halle des trésors gastronomiques, ou encore les ateliers de découverte des produits.” La future Cité sera composée d’un équipement culturel central de 20 000 m² comprenant un centre d’interprétation avec médiathèque et espaces d’exposition et un centre de ressources et d’innovation, un “labo gastronomique”, 510 places pour des ateliers de découverte des produits, un auditorium de 1 200 places et une halle d’exposition de 7000 m². Les 7,5 hectares du quartier de la Gastronomie accueilleront également une Halle des trésors gastronomiques, des restaurants (brasseries, bars du marché et 3 restaurants gastronomiques), des centres de formation et des espaces mutualisés, plus de 300 chambres en hôtel ou en résidences. Enfin plus de 35 000 m² seront consacrés à l’accueil d’activités économiques (entreprises, commerces). Les jardins et les espaces publics occuperont au moins 2 hectares de terrain.
La création de cette cité réunissant tous les acteurs qui gravitent autour de l’alimentation, tant sur des aspects techniques et scientifiques que culturels et artistiques, pourrait permettre d’ouvrir un espace public de discussion sur les enjeux liés à l’alimentation des métropoles dont le modèle actuel est remis en cause par les défis de la transition écologique.
Machine, enclave, barrière…
« L’ensemble du MIN et de l’échangeur de l’A6-A86 a séparé notre ville en deux ; une grande aile de papillon à l’est et une toute petite aile de papillon difforme à l’ouest, le quartier Larue. Pour ses habitants cette déchirure est insupportable depuis 50 ans. Le MIN agit toujours comme une frontière, comme un mur auquel la ville est adossée. »
 Christian Hervy
Christian Hervy
On donne souvent l’image du MIN comme une ville dans la ville. Chaque jour il y passe environ 25 000 véhicules et entre 3h et 5h du matin, les halles sont pleines de chalands. Pour Christian Hervy, c’est ce qui fait la réputation du lieu : “c’est un marché physique, avec son ambiance et le tissu de rapports sociaux qui vont autour”. Une île mystérieurse qu’on entre-aperçoit dans certains films, un monde à part.
En concentrant sur le même lieu tous les denrées alimentaires, le ministère de l’agriculture a mis en place tout un système qui accompagne la mosaïque de commerçants. L’espace multifonctionnel du MIN qui articule aux halles de marché et aux entrepôts, les fonctions d’administration, de sécurité alimentaire, les services vétérinaires et de traitement des déchets n’en reste pas moins un espace industriel, une résultante de la logique de flux de produits frais et des questions sanitaires et de sécurité inhérentes. Il constitue ainsi vu de l’extérieur une grande plaque hermétique branchée par cinq portes sur les infrastructures routières de l’échangeur A6-A86 et sur le réseau ferré national. Elle est venue « déchirer » un territoire et briser des habitudes de vie, des continuités qui permettaient sa pratique. Une image parlante de ce traumatisme évoquée par Christina Hervy, maire de Chevilly-Larue, est la disparition du « chemin des amoureux » qui reliait sa commune à celle de Rungis en passant par les espaces inhabités de l’aqueduc de la Vanne où venaient se retrouver les amoureux des deux villages.
La création de la cité de la gastronomie, la mise en service du tramway T7 et la future de la ligne 14 du Grand Paris express sont autant de levier qui peuvent permettre de repenser les rapports entre le MIN et son environnement.
Une ouverture en termes d’image et des projets d’urbanisation
« Le MIN est un peu comme une dynamo en dehors du vélo. Il pourrait être totalement autre part, il s’extériorise via ses grands câbles, ses grands tuyaux. Il faut re-territorialiser, réintroduire ce territoire dans la vie. Nous avons rencontré les maires et nous sommes allés voir le MIN, Belle-épine, qui étaient très contents d’ouvrir au local. »
 Christian De Portzamparc
Christian De Portzamparc
Rungis est, de par sa nature, voué à conserver une certaine fermeture, même s’il est aujourd’hui possible de découvrir le marché lors de visites organisées par la SEMMARIS à partir de 5h, après le gros rush du matin. Pour Christian de Portzamparc, il est important d’inscrire ce lieu fonctionnel dans la pratique et l’imaginaire métropolitain. Plusieurs restaurants situés sur le site du MIN attirent déjà de rares habitués qui viennent y déguster des produits fraîchement arrivés de la mer, mais la future cité de la gastronomie devrait attirer des visiteurs de toute l’agglomération.
Le marché a été sorti du centre de Paris car son activité le rendait incompatible avec celle de la ville. Il est aujourd’hui au cœur d’un tissu métropolitain habité. L’un des enjeux est donc bien de re-territorialiser un espace parfois vécu comme trop “offshore” Pour Christian de Portzamparc, il est nécessaire de travailler sur le franchissement des grandes infrastructures type échangeurs ou voies rapides qui entourent les “plaques” des zones logistiques et renforcent leur enclavement. L’arrivée du tramway T7 doit s’accompagner, du développement de la façade du MIN sur ce “tube à voitures” qui pourrait se transformer en boulevard urbain tout du long pour “remailler” le territoire. Les zones d’activité ou de logistique comme le MIN pourraient céder du terrain sur leurs bords s’ils ont une valeur foncière et permettre ainsi de créer des façades de ville, c’est-à-dire des adresses pour des commerces, des restaurants ou des équipements comme la cité de la gastronomie.
 Mission d'approfondissement du projet stratégique directeur de l'OIN ORSA sur le pôle Orly-Rungis - 2010-2014Mission : Elaboration d'un schéma d'urbanisme stratégique du pôle d'Orly-Rungis en coordination avec les acteurs économiques et politiques
Mission d'approfondissement du projet stratégique directeur de l'OIN ORSA sur le pôle Orly-Rungis - 2010-2014Mission : Elaboration d'un schéma d'urbanisme stratégique du pôle d'Orly-Rungis en coordination avec les acteurs économiques et politiques
Maîtrise d’ouvrage : EPA ORSA
Maîtrise d'oeuvre : Agence Elizabeth et Christian de Portzamparc
Territoires d'échanges :
Orly-Rungis : des plaques fonctionnelles aux continuités métropolitaines
Le Grand Orly c'est :
81 km²
,
68,3%
du territoire occupé par de l’urbain construit ,
14
communes de l’Essonne et du Val-de-Marne ,
128 000
emplois dont 20,4%
dans le secteur transport logistique ,
taux d’emploi de 1,07
 Du ventre au « Nutripôle »…
Du ventre au « Nutripôle »…
« Ce fut un vrai sujet d’étonnement de voir que le territoire du MIN et d’Orly, n’était pas un des pôles de développement du Grand Paris dans le schéma de Christian Blanc, alors que c’est un grand pôle métropolitain. »
 Eliane Dutarte
Eliane Dutarte
Plusieurs raisons peuvent expliquer le fait que les moteurs économiques que sont le MIN de Rungis et l’aéroport d’Orly n’aient pas été au coeur d’un des clusters du Grand Paris, définis en 2009 par le secrétaire d’Etat Christian Blanc. L’activité du MIN de Rungis est en croissance constante, mais la perte de vitesse d’un secteur comme celui du SENIA montre que l’image du « ventre », d’un organe unique dédié à l’alimentation de la grande ville, n’est plus forcément adéquate au métabolisme de la métropole contemporaine. Si à l’époque de sa conception, le marché de gros était un modèle économique établi, le développement d’autres modèles comme ceux de la grande distribution ou du cash and carry, avec leurs propres systèmes d’acheminement et de distribution, a créé un cadre concurrentiel plutôt qu’un écosystème intégré. Le périmètre de protection du MIN, mis en place pour sécuriser les commerçants qui hésitaient à partir de Paris est aujourd’hui beaucoup entamé par plusieurs dérogations notamment celles accordées à la chaîne Metro. La carte des lieux de distribution alimentaire actuels a ainsi plus l’aspect d’une constellation de « ventres » plus ou moins gros. L’essentiel des flux de logistique alimentaire transitent par camion et n’ont pas forcément besoin d’être traités à proximité de Rungis. De plus, presque tous les flux internationaux de fleurs ou de fruits et légumes arrivent par avion à Roissy et non pas à Orly. L’intégration des deux infrastructures en terme de logistique est pour l’instant difficilement envisageable tant que l’aéroport d’Orly reste réservé à des vols court-moyen-courrier. Cependant, la dynamique autour de la cité de la gastronomie et l’excellence sanitaire développé par le MIN sont deux atouts mis en avant pour la constitution d’un pôle d’excellence autour de la nutrition qui viserait à incorporer de plus en plus d’activités à forte valeur ajoutée dans et autour du Marché, par le développement des activités de transformation et des partenariats avec les acteurs publics et privés de la recherche et de la santé.
Un aggrégat de “fonctions support” plutôt qu’un pôle ?
« Un pôle, c’est plus fort que l’environnement et ça diffuse sur l’environnement. Au niveau de l’emploi, si on prend la part des fonctions métropolitaines au sens de l’Insee, sur l’ensemble du secteur Orly-Rungis on est en dessous de la moyenne régionale. Le vrai pôle métropolitain, le moteur métropolitain c’est Massy. »
 Daniel Behar
Daniel Behar
« J’avais lancé comme une provocation ce terme de « rhizome » plutôt que de pôle pour insister sur le fait que tout est en relation, tout est en flux de relations humaines, d’informations, de migrations, de marchandises, d’immatériel et de matériel dans la métropole. »
 Christian De Portzamparc
Christian De Portzamparc
Le territoire défini par les membres de l’Association pour le Développement économique du pôle Orly-Rungis (ADOR) représente actuellement un bassin de 63 000 emplois en perte de vitesse. Le MIN y cohabite avec un ensemble de fonctions juxtaposées, un agrégat de zones que l’image du rhizome évoquée par l’architecte Christian de Portzamparc illustre bien. Comme l’explique Jacques Touchefeu, l’aéroport d’Orly et le nœud autoroutier de l’A6 - A106 – A86 ont attiré au fil du temps de nombreuses entreprises qui couvrent des domaines bien plus larges que ceux de l’alimentation. Les différentes activités logistiques des « plaques » du MIN, du SENIA ou de la SOGARIS sont peu intégrées entre elles et avec l’aéroport qui traite seulement 100 000 tonnes de fret contre 2,4M à Roissy. De plus l’encombrement actuel des réseaux routiers limite les perspectives de développement quantitatif. Il s’agit aujourd’hui, pour toutes ces zones autour d’Orly et Rungis, d’amorcer une montée en gamme en termes de services et de valeur ajoutée. Des opérations comme la densification actuelle du parc d’activités de la SILIC ou la nouvelle entrée de la plateforme logistique SOGARIS, conçue par l’architecte Franck Hammoutène font figure de pionnières de cette dynamique de tertiarisation et d‘intégration à l’environnement. Elles pourraient permettre au territoire de trouver une nouvelle dynamique au sein du « pôle d’Orly », dont le territoire s’étend de Massy à Villeneuve Saint-Georges et qui définit la véritable échelle de l’attractivité économique.
 D’un territoire servant hors de la ville à un maillon du système métropolitain
D’un territoire servant hors de la ville à un maillon du système métropolitain
« Notre grande ville s’est accrue grâce aux rues, puis aux routes et autoroutes. Il y a eu un divorce entre Hestia [la déesse du foyer chez les grecs] et Hermès [le dieu de la mobilité], un saut quantitatif brut, dans le lien entre séjourner et bouger. On gagne de la rapidité mais on perd la fonction d’une voie qui était de distribuer et d’organiser la vie. […]. La première question qui nous était posée, comme une sorte de pré-étude, c’était comment rendre ce territoire habitable. Réfléchir à un modèle économique possible, pour qu’industriels et municipalités puissent dialoguer. »
 Christian de Portzamparc
Christian de Portzamparc
Les concepts proposés par Christian de Portzamparc pour la re-territorialisation du MIN valent pour l’ensemble des « plaques » fonctionnelles qui constituent ce grand territoire, et notamment l’aéroport d’Orly. Il y a un peu plus d’un demi-siècle, « l’implantation de cette ville industrielle s’est faite au cœur d’un territoire dont elle est venue modifier en profondeur la pratique ». L’importante infrastructuration routière a fait gagner de la rapidité mais « on a perdu la fonction des voies qui était de distribuer et d’organiser la vie. » Le territoire d’Orly-Rungis est aujourd’hui entièrement pris dans la zone dense de l’agglomération francilienne et dans son système de mobilités publique avec l’inauguration prochaine du tramway et le prolongement de la ligne 14 jusqu’à Orly prévu dans le schéma du Grand Paris express. L’enjeu majeur est donc de retrouver dans ce territoire un maillage de grandes rues, de « chaînes agrégatives », une « charpente » qui puisse l’inscrire dans l’espace métropolitain et l’ouvrir à la complexité de ses pratiques. Le schéma de principe d’aménagement de l’EPA ORSA repose ainsi sur la grande «croisée urbaine» que forment la RN7 (nord-sud) et l’axe reliant la Plaine de Montjean à la zone d’activité du SENIA (ouest-est).
 Mission d'approfondissement du projet stratégique directeur de l'OIN ORSA sur le pôle Orly-Rungis - 2010-2014Mission : Elaboration d'un schéma d'urbanisme stratégique du pôle d'Orly-Rungis en coordination avec les acteurs économiques et politiques
Mission d'approfondissement du projet stratégique directeur de l'OIN ORSA sur le pôle Orly-Rungis - 2010-2014Mission : Elaboration d'un schéma d'urbanisme stratégique du pôle d'Orly-Rungis en coordination avec les acteurs économiques et politiques
Maîtrise d’ouvrage : EPA ORSA
Maîtrise d'oeuvre : Agence Elizabeth et Christian de Portzamparc
D’un aménagement subi à un développement dans le respect…
« Les installations du marché ont été posées là, sans égards. Il faut que tout soit fait en respectant l’histoire, les lieux et les gens. Il ne s’agit pas que de régler les problèmes logistiques d’une métropole, mais aussi de fabriquer de la ville. Réfléchir sur le territoire, c’est jouer sur la matière humaine, sur le symbolique, et sur cette myriade de fils invisibles des rapports humains qui font la société. Aujourd’hui le MIN est une grande fierté pour mes habitants. Les hommes savent domestiquer et symboliser ce qui leur a été imposé. »
 Christian Hervy
Christian Hervy
« L’enjeu pour nous c’est de considérer que dans la zone dense le terrain est une ressource rare et qu’il nous faut intensifier la ville, avec des transports lourds qui viennent s’ajouter. Nous avons ainsi identifié deux grands lieux de régénération urbaine que sont les Ardoines et Orly-Rungis. »
 Jacques Touchefeu
Jacques Touchefeu
La “violence” des politiques d’aménagement de l’après-guerre qui ont implanté l’aéroport, le MIN, et fait passer l’autoroute dans le territoire, est encore présente dans la mémoire des habitants. À l’époque le Préfet décidait et les maires n’avaient aucun pouvoirs. Ces infrastructures héritées sont aujourd’hui des atouts majeurs pour l’attractivité du territoire, où un mode d’organisation locale est apparu depuis 2005 avec les “Assises du pôle d'Orly” qui réunissent l’ensemble des acteurs économiques et sociaux à l'initiative des Conseils généraux de l’Essonne et du Val-de-Marne. Une gouvernance territoriale qui a été pérennisé par la création de la “Conférence de développement durable du pôle d'Orly” en 2009. L’État “aménageur" est toujours présent au travers des opérations d’intérêt national menées par l’Établissement public d’aménagement ORSA, mais celui-ci associe aujourd’hui les communes, les intercommunalités et les départements dans le financement et la mise en œuvre des projets. Après la définition de son projet stratégique directeur, l'EPA ORSA a conduit des études d'aménagement plus poussées notamment dans le cadre de l'élaboration du CDIT Grand Orly. À partir de 2011, l'agence AECDP mandatée par l'EPA a ainsi réalisé un travail de terrain très fin auprès des membres de l'ADOR détenteurs du foncier du pôle Orly-Rungis. Cela a permis aux élus et aux opérateurs économiques de comprendre que pour réussir la transformation de ce grand territoire, ils devaient travailler ensemble.
Rungis dans le Grand Paris :
la vision de l'équipe de Portzamparc
«
Le rhizome: une figure pour agir
L’image du rhizome nous servira de métaphore pour désigner un système en réseau non centré, non arborescent même s’il y a un centre plus fort. Pour décrire non pas un territoire, mais un organisme pluriel avec des membres distincts, différents mais liés. Comparé au système en arborescence qui est la racine botanique la plus courante, le rhizome est la forme de croissance de certaines plantes, le gingembre, ou le bambou, dont les racines sont des cheminements linéaires souterrains non liés à un centre et non pas des arborescences séparées à partir d’une graine. Dans les rhizomes tout est lié et tout est indépendant pourrait-on dire.
Utilisé par G. Deleuze et F. Guattari comme principe d’une figure topologique de développement non arborescent, le Rhizome nous servira à désigner la vitalité de ces « organes » en réseaux de la métropole, qui n’existeraient pas sans le centre, n’en sont pas une extension, ont une autonomie relative, sont en relation entre eux et avec ceux d’autres métropoles. Image du caractère irrégulier et dynamique d’un mode de croissance repérable sur le territoire.
[…] Ce schéma nous sert à constituer une alternative à une représentation dominante de la métropole, notamment pour le Grand Paris, qui reste structurée par la seule logique centre/périphérie, la zone dense vs la zone non dense, ou une illusion de polycentrisme attachée aux villes nouvelles. Avec le rhizome nous regardons une formation qui a un ou plusieurs centres, et où des pôles, des prolongations, des fonctions autres, sont en relations multiples entre eux et avec le centre. Ces pôles ont des fonctions propres. Ce ne sont pas des répliques « villages » du centre mère avec « panachage » équilibré de toutes les fonctions du centre. Toutes les expériences, mais aussi les nécessités d’optimiser les mobilités emploi-habitat, montrent qu’il faut penser en pôle avec dominante fonctionnelle pour l’emploi et mixité, mais non en pseudo centres latéraux qui prétendaient diffuser de l’emploi et du logement.
[…] La figure du rhizome, grille de lecture analytique et descriptive de la métropolisation, ouvre en même temps vers un programme, celui de l’accompagnement du vivant permettant de maîtriser ce développement rhizomatique.
Le rhizome propose un mode de conciliation entre performance et bien-vivre. Organiser le développement de grands rhizomes est favorable au renforcement de la performance et de la compétitivité métropolitaines. Au sein de chacun de ces rhizomes, on rend possible les interactions et les synergies entre grandes fonctions métropolitaines (le productif, la recherche/innovation, le « récréatif », la connectivité…). Autrement dit, on facilite la densification de pôles d’emploi majeurs. Simultanément,la conception de chacun de ces rhizomes comme un élément du système métropolitain, fortement interdépendant des autres, au travers la mise en place de liens et de connexions puissants va dans le sens de la fluidité et de l’intégration d’un seul marché de l’emploi, d’échelle métropolitaine.
Dans le même temps, le développement de ces rhizomes propose les conditions spatiales pour répondre à la crise du « bien-vivre » en métropole. La conception de chacun de ces rhizomes, non comme un « pôle urbain » mais comme un ensemble diversifié, alternant hautes et basses densités, structuré autour de grands « parcs urbains » est en mesure de répondre à une aspiration constante et unanime des populations : le besoin d’espace. Simultanément, cette conception est une condition nécessaire – mais pas suffisante – pour ouvrir l’éventail des choix résidentiels et permettre la mobilité résidentielle qui constitue aujourd’hui un des enjeux majeurs face au déficit d’attractivité des métropoles. Enfin, le développement de ces rhizomes comme des ensembles diversifiés fonctionnellement - sans pour autant être complets et autonomes – et bien reliés les uns aux autres, constitue une des conditions pour réduire les inégalités d’accès aux aménités urbaines aujourd’hui constatées dans les métropoles.
La perspective ouverte par l’après-Kyoto est d’abord celle d’une incertitude grandissante de notre futur. C’est une invitation à penser le projet métropolitain en intégrant cette incertitude et donc à laisser la place à « l’inconnu ». »En ce sens, la figure du développement en rhizome offre une alternative crédible au paradigme de la « ville compacte » qui apparaît aujourd’hui comme le mode de réponse idéale à l’exigence d’économie de la ressource, mais qui, par sa conception uniformément dense, offre peu de place à la flexibilité , à l’inconnu. C’est à l’inverse tout l’intérêt de la figure du rhizome qui en quelque sorte préserve l’avenir, en ce qu’elle préserve des vides dans le développement métropolitain... ”
 Christian de Portzamparc / Laboratoire C.R.E.T.E.I.L
Christian de Portzamparc / Laboratoire C.R.E.T.E.I.L
Les photos prises sur le territoire


























Pour aller plus loin...
- Le MIN de Rungis
 Le site de la Fédération Française des Marchés d’Intérêt National
Le site de la Fédération Française des Marchés d’Intérêt National Toutes les enquêtes de Rungis Actualités sur le site du Marché International de Rungis
Toutes les enquêtes de Rungis Actualités sur le site du Marché International de Rungis Article de recherche : Le marché d'intérêt national de Paris-Rungis, Guy Chemla, In: Annales de Géographie. 1980
Article de recherche : Le marché d'intérêt national de Paris-Rungis, Guy Chemla, In: Annales de Géographie. 1980 Quelles perspectives d’évolution pour le marché de Rungis ? Carole Delaporte, IAU, note rapide n°605, 2012
Quelles perspectives d’évolution pour le marché de Rungis ? Carole Delaporte, IAU, note rapide n°605, 2012
- Alimentation des Métropoles
 Pôles logistiques alimentaires : un nouveau concept pour l’approvisionnement des villes, Eleonora Morganti
Pôles logistiques alimentaires : un nouveau concept pour l’approvisionnement des villes, Eleonora Morganti Circuits de proximité et gouvernance alimentaire des agglomérations, Terres en Ville
Circuits de proximité et gouvernance alimentaire des agglomérations, Terres en Ville CGDD - Consommer local, les avantages ne sont pas toujours ceux que l’on croit - n° 158 Mars 2013
CGDD - Consommer local, les avantages ne sont pas toujours ceux que l’on croit - n° 158 Mars 2013 Service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements, Synthèse des connaissances, La logistique de la grande distribution, 2008
Service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements, Synthèse des connaissances, La logistique de la grande distribution, 2008 La logistique de la grande distribution, note de 4 pages à propos du rapport ci-dessus Direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer, 2010
La logistique de la grande distribution, note de 4 pages à propos du rapport ci-dessus Direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer, 2010 Le réseau des cités de la gastronomie
Le réseau des cités de la gastronomie
- Le pôle Orly-Rungis
 EPA ORSA - Le pôle d’Orly
EPA ORSA - Le pôle d’Orly Recueil de fiches projets sur le territoire autour d’Orly - Rungis - Seine Amont | APUR 2011
Recueil de fiches projets sur le territoire autour d’Orly - Rungis - Seine Amont | APUR 2011 Synthèse : Le développement du pole Orly Rungis dans la dynamique régionale ; propositions de la CCIP, 2006
Synthèse : Le développement du pole Orly Rungis dans la dynamique régionale ; propositions de la CCIP, 2006 Le site de l’Association pour le Développement Economique du pôle Orly-Rungis
Le site de l’Association pour le Développement Economique du pôle Orly-Rungis Pacte Pour l’emploi, la formation et le développement économique d’Orly Paris ®
Pacte Pour l’emploi, la formation et le développement économique d’Orly Paris ® Portrait de territoire : Grand Orly, DRIEA, 2013
Portrait de territoire : Grand Orly, DRIEA, 2013 Fiche CDT Grand Orly, IAU, 2013
Fiche CDT Grand Orly, IAU, 2013



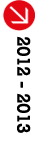
 Christian de Portzamparc, Architecte, Agence Christian de Portzamparc, membre du Conseil scientifique de l’AIGP
Christian de Portzamparc, Architecte, Agence Christian de Portzamparc, membre du Conseil scientifique de l’AIGP Eliane Dutarte, Conseillère du Délégué pour la Région Capitale à la DATAR
Eliane Dutarte, Conseillère du Délégué pour la Région Capitale à la DATAR Christian Hervy, Maire de Chevilly-Larue (2003-2014)
Christian Hervy, Maire de Chevilly-Larue (2003-2014) Jacques Touchefeu, Directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis – Seine Amont
Jacques Touchefeu, Directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis – Seine Amont Francis Lefevre, Secrétaire général de la SEMMARIS
Francis Lefevre, Secrétaire général de la SEMMARIS Mission d'approfondissement du projet stratégique directeur de l'OIN ORSA sur le pôle Orly-Rungis - 2010-2014
Mission d'approfondissement du projet stratégique directeur de l'OIN ORSA sur le pôle Orly-Rungis - 2010-2014 Du ventre au « Nutripôle »…
Du ventre au « Nutripôle »… D’un territoire servant hors de la ville à un maillon du système métropolitain
D’un territoire servant hors de la ville à un maillon du système métropolitain 



























