Création: Plaine Commune, la fabrique de l'image / 24 avril 2013
Avec comme emblème la Cité du Cinéma, un cluster de création, de culture et d’industries créatives est en train de se structurer sur le territoire de Plaine Commune. Un projet qui concrétise une politique engagée, face à un héritage socio-économique et urbain difficile. En synergie avec les filières plus matérielles de la mode et du design, des millions d’images porteuses de fictions, d’émotions, supports de jeux ou de services, sont déjà produites dans les studios et ateliers de la plaine.
Les intervenants
Djamel Klouche et François Decoster, architectes urbanistes, Agence AUC Architectures,
membres du Conseil scientifique de l’AIGP (2010-2011)
Jean-Louis Subileau Urbaniste-aménageur, gérant de “Une fabrique de la ville”
Patrick Braouezec, Président de la Communauté d’agglomération de Plaine Commune
Eric Garandeau, Président du centre national du Cinéma et de l’image animée
Julien Beller, architecte, président du 6B

 Situation métabolique:
Situation métabolique:
Le carrefour Pleyel, future interconnexion métropolitaine
Le secteur « Seine-Révolte » autour de Pleyel c'est :
2
communes concernées : Saint-Denis et Saint-Ouen ,
Le projet : Potentiel de construction de 2 500 000 m²
,
104 000 m²
de locaux mixtes ,
soit 15%
des constructions sont prévus pour les activités culturelles et créatives
 Les “altérités” du tissu créatif du sud de Plaine Commune
Les “altérités” du tissu créatif du sud de Plaine Commune
Avec l’évolution des technologies, du cinéma au numérique en passant par la télévision, la production d’images et sa diffusion a été massifiée. La frontière aujourd’hui ténue entre communication, divertissement et art amène à parler d’industries créatives. Ce secteur d’activité a profité des grands espaces industriels en friche libérés par la désindustrialisation pour y installer de nombreux lieux de production durant les deux dernières décennies. Depuis la création des studios d’enregistrement E.M.G.P dans les anciens magasins généraux de Paris en 1987, de nombreux plateaux de cinéma, des studios de télévision, des entreprises de post-productions, des écoles de formation aux métiers de l’image et plus récemment des créateurs de jeux-vidéos ou d’environnements numériques se sont implantés. La Cité du cinéma y joue désormais un rôle de vitrine, pour positionner Paris dans la compétition internationale face à Londres ou à la Cinecittà de Rome. Ce projet, porté par Luc Besson, lancé en 2004 et inauguré en 2012, regroupe plateaux de tournage, écoles de formation, espaces événementiels, et le siège d’Europacorp au sein d’une ancienne centrale EDF réhabilitée.
Cependant, les friches du sud de la Plaine ont vu se développer d’autres hauts-lieux de la création artistique et de la diffusion comme l’académie Fratellini autour des arts du cirque, ou le 6B par exemple. C’est ainsi que le territoire constitue aujourd’hui un environnement créatif où l’altérité règne, où les grands groupes comme Europacorp cohabitent avec les petites associations et les ateliers d’artistes.
 Pleyel, “tête de réseau” pour un cluster atypique
Pleyel, “tête de réseau” pour un cluster atypique
« Pour que ça reste un territoire créatif, il faut mélanger les expertises, prendre les meilleurs professionnels et les mettre autour d’une table. C’est ce mariage des expertises qui permet la créativité, la rupture, l’innovation. J’aime beaucoup cette phrase de Rem Koolhaas qui dit que "la ville est une somme de mystères plus qu’une accumulation de certitudes." Il faut travailler dans cette mixité. »
 Éric Garandeau
Éric Garandeau
Dans le cadre du projet du Grand Paris, le carrefour Pleyel est destiné à devenir un puissant lieu d’interconnexion de la Métropole où se croiseront les lignes 14, 15, 16 et 17, et où une gare TGV pourrait également voir le jour. Ce grand pôle de correspondance sera connecté à la gare Stade de France-Saint-Denis du RER D par un franchissement du triage du Landy. C’est ainsi un hub majeur comme celui de la Défense qui devrait voir le jour et renforcer considérablement l’accessibilité de tout le sud de la Plaine.
Le premier schéma du Grand Paris élaboré par le secrétaire d’Etat Christian Blanc en 2009 en faisait également le centre d’une politique de développement économique visant à y structurer un cluster d’industries créatives de l’image. Les études réalisées par la suite en 2010 – 2011 par L’AUC et par IDATE-CIRCE ont mis en évidence la caractéristique hybride des activités créatives, et la difficulté de limiter les mécanismes d’innovation au secteur de l’image. Cela a conduit à dépasser l’image du cluster comme une zone d’activité délimitée pour imaginer une structure aux limites floues, dépassant les frontières disciplinaires pour mettre en synergie tout le domaine créatif. Le futur hub de Pleyel y joue le rôle d’une “aire de connectivité maximum” qui va permettre d’irriguer tout le secteur environnant appelé “Seine Révolte” où 104 000 m² de locaux mixtes, soit 15% des constructions sont prévus pour les activités créatives. Mais, c’est plus largement tout le territoire de Plaine Commune et ses très nombreux lieux de création, qui vont bénéficier du développement de cette “tête de réseau”
 Coupures et gentrification
Coupures et gentrification
« Il y a trois ans nous étions dans un lieu délaissé qui ne demandait qu’à être réactivé, et qui était en train de l’être par les promoteurs et les urbanistes. Mais la gare restait la plus grosse plateforme de krack de l’Europe avec les prostituées qui faisaient des passes le long du canal. ça a déjà beaucoup changé, c’est ce qui est passionnant. Ce truc est en mutation. Je suis un acteur mais surtout un habitant de ce territoire. Ce que j’attends c’est que tout ça se développe, en laissant une place à ces altérités qui soient génératrices d’une ville productive, informelle avec du tout petit et du tout gros. »
 Julien Beller
Julien Beller
Le territoire de Seine Révolte est traversé par de nombreuses coupures, dues à la présence des infrastructures routières, ferroviaires ou du canal Saint-Denis. Les projets d’urbanisation antérieurs ont privilégié les relations Nord-Sud reliant la Plaine à Paris et très peu les liens de banlieue à banlieue. Les franchissements du faisceau ferré prévus dans le plan Hippodamos n’ont pas tous été réalisés ce qui rend difficile aujourd’hui les trajets transversaux et le rattachement du pôle de Pleyel à celui constitué autour du stade de France.
Mais le projet de métro du Grand Paris entraîne une autre problématique en améliorant l’accessibilité du territoire. Le territoire est de plus en plus attractif et la pression foncière augmente. Il doit faire face à des phénomènes de tertiarisation et de gentrification auxquels sont confrontés tous les “tissus créatifs” des grandes métropoles mondiales. Comment dans ce contexte réussir à conserver un tissu hybride où activités créatives cohabitent avec logements et bureaux ? Comment ne pas refaire la tabula rasa du quartier autour du Stade de France ? Il est nécessaire de penser finement une offre immobilière adaptée au milieux créatifs, avec par exemple 30% des locaux à des prix raisonnables comme le propose l’architecte François Decoster. L’étude de l’AUC a ainsi permis de mettre en lumière l’opportunité qu’offrent les grandes friches industrielles du territoire, comme la halle Alstom ou les Cathédrales SNCF, pour y développer, moyennant une réhabilitation légère, des « bureaux nomades » conçus pour répondre à moindre coût aux besoins des jeunes entreprises créatives.
 Le “climat” d’un “cluster hybride”
Le “climat” d’un “cluster hybride”
« Un cluster, ça a tendance à être mono-fonctionnel, très spécialisé. Pour nous, ce n’était pas la meilleure solution, nous préférions avoir quelque chose d’hybride. Nous avons travaillé par situations, des sortes de fictions, en en proposant une multitude à l’intérieur du Grand Paris.»
 François Decoster
François Decoster
« Nous n’avons jamais voulu parler de phasage, mais plutôt d’états, car la ville n’est jamais finie. »
 Djamel Klouche
Djamel Klouche
Lors de la consultation internationale de 2008, l’équipe constituée autour de l’AUC avait essayé de déconstruire l’image du cluster comme une zone spécialisée et monofonctionnelle en développant le concept de “cluster hybride” qui leur semblait plus adéquat à une lecture contemporaine de l’innovation comme un processus ouvert. L’étude sur le projet urbain du cœur de cluster de Pleyel, qui a ensuite été confiée à l’agence, a permis d’approfondir cette idée. Djamel Klouche et François Decoster ont travaillé à partir de l’ambiance d’altérité qui existait sur le territoire, avec l’objectif d’y conserver une diversité d’activités et d’en faire un « quartier clusterisé mixte ». Plutôt qu’une urbanisation homogène produite après une tabula rasa, ils proposent une intervention hybride, « une négociation entre intensité et délicatesse.» La future interconnexion est ainsi imaginée comme une « aire de connectivité maximale », une pièce métropolitaine qui nécessite une grosse intervention infrastructurelle et architecturale qui puisse diffuser sur l’ensemble du territoire. C’est le sens de leur proposition de gare-pont, pensée comme un espace public augmenté pouvant être directement branché à un équipement métropolitain. A l’inverse, les quartiers environnants pourront être développés avec beaucoup plus de finesse, en préservant certains bâtiments industriels et en travaillant des typologies de bureaux variées.
Cette méthodologie propose une alternative à la planification. Plutôt qu’une vision figée et arrêtée dans le temps à laquelle il faudrait aboutir, il s’agit d’aller vers la constitution d’un “climat” pouvant se développer dans le temps, et évoluer d’état en état comme un phénomène atmosphérique.
 Étude de stratégie d'implantation du cluster de la création sur Plaine Commune et Saint-Ouen, et sa déclinaison urbaine sur Pleyel-Saint Ouen - 2010-2011Maîtrise d’ouvrage : Plaine Commune
Étude de stratégie d'implantation du cluster de la création sur Plaine Commune et Saint-Ouen, et sa déclinaison urbaine sur Pleyel-Saint Ouen - 2010-2011Maîtrise d’ouvrage : Plaine Commune
Maîtrise d'oeuvre : L'AUC (mandataire) + AUC as + Pascal Cribier + Patrick Ecoutin + MSC + PRO développement + Nodesign + CITEC + EGIS Aménagement
 Territoires d'échanges :
Territoires d'échanges :
Une stratégie basée sur la “culture et la création” pour faire territoire
Le territoire de la culture et de la création c'est :
47 km²
,
9
communes , 396 600 habitants ,
175 500
emplois , Taux d’emploi de 0,93
,
+2,17% / an
de croissance de l’emploi depuis 1999 ,
20,1%
taux de chômage en 2008 ,
4ème
polarité tertiaire de l’agglomération parisienne ,
40 %
du territoire en mutation dans les prochaines années
 Du cluster d'industries créatives au territoire de la culture et de la création
Du cluster d'industries créatives au territoire de la culture et de la création
« Lorsque Christian Blanc, m’a parlé de cluster, nous avons récusé cette idée selon laquelle cela partirait de Pleyel pour irriguer le territoire. Il fallait réinterroger le regard porté au territoire au jour du foisonnement d’industries créatives présentes sur le territoire. On ne voulait pas se limiter à l’industrie de l’image. »
 Patrick Braouezec
Patrick Braouezec
Le projet initial du secrétaire d’Etat Christian Blanc était de constituer à Pleyel un pôle des industries de l’image. Cette volonté de cibler ainsi l’identité économique du territoire venait accompagner la structuration de ce secteur initiée par des acteurs comme le pôle de compétitivité Cap Digital et le « Pôle Audiovisuel multimédia cinéma du Nord Parisien ». Au regard de la diversité des pratiques culturelles et créatives et de leur dispersion bien au-delà de Pleyel, cette vision semblait trop réductrice. La discussion entre les acteurs du territoire de Plaine Commune et l’État a conduit à l’élargir.
Le cluster s’est donc étendu au domaine plus général de la culture et de la création et à tout le territoire de la communauté d’agglomération. Il est question de renforcer les liens entre les lieux de production et de diffusion de la création comme la Cité du cinéma ou le 6B, les lieux de formation et de recherche tels que les Universités Paris 8 et Paris 13 de Saint-Denis et Villetaneuse et les nombreuses écoles spécialisées du territoire, et lieux institutionnels de la culture comme les médiathèques ou le grand équipement des archives nationales de Pierrefitte. L’Atelier du Territoire de la Culture et de la Création sera le fer de lance de ces rapprochements et des synergies futures entre les différents acteurs.
Cependant, il est nécessaire de replacer le foisonnement d’activités culturelles et créatives qui caractérise Plaine-Commune dans le contexte métropolitain qui compte d’autres lieux structurants dans ce domaine. Que ce soit, par exemple, la cartographie des membres du pôle de compétitivité Cap Digital, celle du réseau de centres de production et de diffusion de l’art contemporain TRAM, ou celle de lieux moins institutionnels qu’on retrouve dans les friches de Nanterre, Montreuil ou d’Ivry, toutes montrent que les dynamiques d’innovation culturelle et artistique doivent être appréhendées à l’échelle de l’agglomération francilienne.
 La création artistique, vecteur de l’affirmation d’une polarité mixte
La création artistique, vecteur de l’affirmation d’une polarité mixte
« On a 30% de jeunes de moins de 20 ans sur le territoire, près de 30% d’étrangers et un taux de chômage proche de 20%. Il y a un potentiel de jeunesse et de diversité mais des difficultés à prendre en compte. Plus de 40% de notre territoire est en mutation avec des secteurs ANRU et PNRQAD. »
 Jean-Louis Subileau
Jean-Louis Subileau
Au-delà du domaine de la culture et de la création, Plaine Commune est un territoire qui connaît une grande croissance démographique et économique depuis une vingtaine d’années. D’importantes mutations ont lieu sur ce territoire de près de 400 000 habitants fortement marqué par la désindustrialisation, et dont le taux de chômage qui atteignait 20,1% en 2008 est l’un des plus élevés de l’agglomération parisienne. L’artisanat, l’industrie et la logistique restent des composantes importantes de l’économie du territoire, mais beaucoup de ces activités sont menacées : les grandes emprises peu denses qui occupent encore 20 % du territoire étant soumises à une pression foncière de plus en plus accrue. Si certaines activités sont progressivement remplacées par des installations à plus forte valeur ajoutée comme des datas-centers ou des centres de messagerie, les emplois dans ces secteurs sont globalement en baisse. A l’inverse, depuis la fin des années 90, les activités tertiaires à haute valeur ajoutée se sont fortement développées dans le sud du territoire desservi par les transports en commun, avec notamment les quartiers d’affaires du Landy/Stade de France et de Pleyel. Plaine Commune abrite ainsi la 4ème polarité tertiaire de l’agglomération, mais ce dynamisme profite peu pour l’instant à la population active du territoire qui manque de qualification.
La culture et la création sont vus par les élus de Plaine Commune comme des vecteurs d’identité et le moyen de donner une empreinte culturelle aux grands travaux d’aménagement et d’urbanisme en cours et à venir. Plus de 40 % du territoire est en mutation, les tissus économiques mais aussi les nombreux secteurs d’habitat social qui font l’objet d’interventions dans le cadre de la politique de la ville et des projets ANRU.
 Une stratégie territoriale issue d'un foisonnement de projets urbains
Une stratégie territoriale issue d'un foisonnement de projets urbains
« Peut-on accueillir entre 80 000 et 100 000 habitants supplémentaires ? C’est un effort extraordinaire. La ville naturelle se développe à deux vitesses avec une répartition très inégalitaire : plus on est à coté de Paris plus ça se développe. Nous avons beaucoup parlé de la qualité urbaine et d’un développement soutenable organisé autour d’un réseau de centralités. Il faut donner corps à l’ensemble via une politique d’espaces publics et une politique foncière. »
 Jean Louis Subileau
Jean Louis Subileau
En 2012, le groupement piloté par Jean-Louis Subileau, gérant de « Une Fabrique de la Ville », associé à Nathan Starkman et Michel Desvignes, a été chargé par la communauté d’agglomération de Plaine Commune, d’une étude dite de “synthèse” en vue de l’élaboration du contrat de développement territorial et de la révision du SCOT. Un gros travail de terrain a été mené auprès des élus et des services d’urbanisme des différentes villes, afin de mettre en cohérence les très nombreux projets, et de constituer une vision globale et transversale du développement du territoire d’ici 2030.
La nécessité de mener une stratégie urbaine a été mise en évidence, afin de réguler le développement économique et urbain très fort au sud et de l’initier et le soutenir dans la partie nord du territoire. En s’appuyant sur le futur maillage de transports en commun considérablement renforcé par la mise en service de la tangentielle nord et les 7 futures gares des lignes 14,15,16, il est possible d’imaginer un développement plus polycentrique qui renforce la mixité fonctionnelle et la diversité du territoire.
L’ampleur des terrains qui pourraient muter dans les vingt prochaines années, permet de dépasser les échelles des opérations prises isolément pour repenser en profondeur l’habitabilité du territoire. Le réseau de rues et d’espaces publics comporte pour l’heure de nombreuses coupures causées par les infrastructures routières et ferroviaires. Un important travail sur les trames urbaines et paysagères existantes a donc été proposé. La Seine et le canal Saint-Denis, le parc Georges Valbon et la butte Pinson pourraient constituer la base d’un grand parc urbain prenant appui sur l’ancien système hydrographique en grande partie enterré.
 Étude de synthèse des études urbaines du CDT du Territoire de la Culture et de la Création - 2012Maîtrise d’ouvrage : Plaine Commune / Saint-Ouen
Étude de synthèse des études urbaines du CDT du Territoire de la Culture et de la Création - 2012Maîtrise d’ouvrage : Plaine Commune / Saint-Ouen
Maîtrise d'oeuvre : Jean-Louis Subileau, Une fabrique de la ville (mandataire) + Michel Desvignes, paysage + Nathan Starckman + Une autre Ville + MRS Partner + Algoé)
 Une intercommunalité, pilote d'un processus
participatif expérimental
Une intercommunalité, pilote d'un processus
participatif expérimental
« On a réuni les dix villes de Plaine-Commune pour créer un plan-projet. L’important était que toutes les communes participent. J’ai aussi dit non à la proposition de Christian Blanc d’organiser le cluster avec un établissement public. On voulait un vrai co-pilotage, avec un contrat d’objectif, avec une discussion à égal avec l’État. On écrit un récit ensemble.»
 Patrick Braouezec
Patrick Braouezec
Au milieu des années 1980, les maires de Saint-Denis, Marcelin Berthelot et d’Aubervilliers, Jack Ralite, la ville de Saint-Ouen et le Conseil Général de Seine-Saint-Denis ont créé le Syndicat intercommunal « Plaine Renaissance » qui a permis de mettre en route le plan d’urbanisation Hippodamos. C’est le début d’un processus de coopération intercommunale qui n’a cessé de se renforcer et de s’élargir. En 1998, les villes d’Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, La Courneuve, L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse et Pantin lancent une charte intercommunale autour d’objectifs communs de développement. En 2000, cinq des communes se saisissent du dispositif d’intercommunalité mis en place par la loi Chevènement pour créer la communauté de communes “Plaine Commune” qui, un an plus tard, devient une communauté d’agglomération. Elles seront rejointes progressivement par les communes de Stains, de L’Île-Saint-Denis, de La Courneuve et de Saint-Ouen en 2013.
Quand le projet du Grand Paris a été lancé, ce cadre de coopération solide a permis de mettre en place rapidement un dispositif partenarial participatif. Un espace de discussion s’est ouvert entre les acteurs du territoire et l’Etat. Il a permis d’élargir la focale très resserrée des projets de clusters pour aller vers un projet de territoire polycentrique, et dépasser « l’idée fausse que des points concentrés autour des gares, allait tirer le développement de l’ensemble du territoire ». Ces négociations impliquant élus locaux, mais aussi habitants et acteurs du territoire ont ainsi beaucoup contribué à la mise en place de la méthodologie des Contrats de Développement Territorial (CDT). Un dispositif de gouvernance original, “l’Atelier”, devrait voir le jour au 6B pour ancrer cette fabrique partenariale et participative du projet dans la durée.
 Plaine commune dans le Grand Paris
Plaine commune dans le Grand Paris
La vision de l'AUC
«
Pour une nouvelle climatologie métropolitaine parisienne
Si la climatologie s’intéresse à l’étude et à la classification des climats existants sur terre, une partie de la discipline traite aussi de l’interaction entre climat et société ; que ce soit l’influence du climat sur l’homme ou de l’homme sur le climat.
Le micro-climat désigne généralement des conditions climatiques limitées à une région géographique très restreinte, significativement distinctes du climat général de la zone où se situe cette région.
C’est aussi le climat d’une étendue limitée résultant de la modification du climat général sous l’effet de différences locales.
Faut-il pour la Métropole parisienne, identifier des lieux stratégiques, dire très exactement ce qu’il faut y mettre, et, ne surtout pas se tromper, comme c’est « la dernière chance ». La réflexion sur le Grand Paris se résumerait alors à une cartographie des lieux stratégiques et au dessin des objets métropolitains venant habiter ces espaces.
Il nous semble que le premier enjeu n’est pas tant celui-ci, puisque ces lieux stratégiques, pour la plupart sont déjà connus et que, sur la majorité d’entre eux, des projets sont déjà tracés. L’enjeu du Grand Paris, n’est pas seulement d’activer la machine à produire des projets labellisés « Paris Métropole » mais avant tout d’en construire les finalités, les outils qui les rendront possibles et la culture métropolitaine à laquelle ils doivent concourir.
Le danger du Grand Paris serait d’aligner sur un fond de carte des grands projets donnant la part belle à quelques sites choisis et de faire l’impasse sur des questions semblant moins fondamentales. Le concept de « climatologie métropolitaine » offre la capacité de révéler autant le commun et le continuum du climat métropolitain parisien mais aussi la multitude des micro-climats sans quoi la Métropole ne serait qu’une abstraction dessinée par le Plan et détachée de réalités souvent plus paradoxales.
La mutation qui doit s’opérer doit savoir être intégratrice de l’ensemble des territoires pour dessiner un Climat Métropolitain Parisien partagé par tous. Climat, ici qui pourrait sous-tendre l’identité métropolitaine parisienne.
Notre carte d’identité parisienne – la Matrice des 19 territoires - montre à quel point les cultures politiques, les cultures géographiques, les cultures liées aux faits topologiques, nous disent des choses extrêmement différentes sur une même métropole.
Il n’y a pas d’harmonie à chercher. Le concept de l’harmonie est périmé.
Le contraire de l’harmonie n’est pas nécessairement la cacophonie ou le chaos. C’est un système dynamique, fondé sur le contraste, la tension, la discontinuité, l’assemblage et le happening, rien à voir avec aucun système esthétique précédent. En effet, lorsqu’on réfléchit sur la culture dans laquelle on vit – la culture au sens anthropologique du terme – la plus grande difficulté psychologique est de se rendre compte de ce qui se passe sans recourir aux schémas qui précisément, sont remis en cause par ce qui se passe. Ou, si l’on préfère, d’observer et de décrire les phénomènes sans les qualifier d’avance, en d’autres termes sans les juger d’avance.
L’exemplarité de situations métropolitaines singulières, qui, prises les unes avec les autres dans leur contiguïté dessinent la métropole. L’interaction entre une stratégie ascendante et une stratégie descendante favorise l’émergence d’attitudes (surtout et nécessairement institutionnelles) d’innovations porteuses de projets-saillies ayant valeur d’expérimentation.
Cette proposition ne se fonde pas sur un principe abstrait de flexibilité, mais ouvre la possibilité de singulariser des devenirs, pour que chaque situation locale, puisse, compte tenu des contraintes collectives, composer et recomposer dans l’espace et dans le temps sa trajectoire particulière.
»La climatologie métropolitaine, c’est ce qui permet au même moment de prendre en compte la très petite échelle de la situation, et le potentiel ouvert par sa métropolisation. La métropole devient ainsi, pour chaque situation, la possibilité de trouver sa capacité d’innovation dans le ressort de la grande échelle, en tant que vecteur de porosité, d’intégrité, de liens et de partage d’une vaste étendue.
 l'AUC
l'AUC
 La carte interactive
La carte interactive
 Pour aller plus loin...
Pour aller plus loin...
- Le quartier de Pleyel
 Le projet de Pleyel sur le site de Plaine Commune
Le projet de Pleyel sur le site de Plaine Commune Le franchissement urbain Landy-Pleyel pour relier deux quartiers de Saint-Denis, EPA Plaine de France, 2014
Le franchissement urbain Landy-Pleyel pour relier deux quartiers de Saint-Denis, EPA Plaine de France, 2014 La cité du cinéma de Luc Besson
La cité du cinéma de Luc Besson
- Les industries créatives
 Les industries créatives en Île-de-France - Un nouveau regard sur la métropole, IAU, 2010
Les industries créatives en Île-de-France - Un nouveau regard sur la métropole, IAU, 2010 Le programme pluriannuel de recherche « Culture et territoires en Île de France », Ministère de la Culture et de la Communication & Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables, 2004-2008
Le programme pluriannuel de recherche « Culture et territoires en Île de France », Ministère de la Culture et de la Communication & Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables, 2004-2008 La dimension culturelle du Grand Paris, Rapport au Président de la République, DANIEL JANICOT, 2013
La dimension culturelle du Grand Paris, Rapport au Président de la République, DANIEL JANICOT, 2013
- Le CDT du territoire de la culture et de la création
 Le Contrat de Développement Territorial du Territoire de la culture et de la création, 2014
Le Contrat de Développement Territorial du Territoire de la culture et de la création, 2014 Le projet de territoire - synthèse, Plaine Commune, 2014
Le projet de territoire - synthèse, Plaine Commune, 2014 Portrait de territoire : Territoire de la Culture et de la Création, DRIEA, 2013
Portrait de territoire : Territoire de la Culture et de la Création, DRIEA, 2013 Fiche CDT Territoire de la Culture et de la Création, IAU, 2014
Fiche CDT Territoire de la Culture et de la Création, IAU, 2014
- Points de vue
-
 La reconversion de la Plaine Saint-Denis : le paysage à l'épreuve du territoire, Sylvie Salles, in Cahiers thématiques n°9 : Paysage, territoire et reconversion, Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, 2010
La reconversion de la Plaine Saint-Denis : le paysage à l'épreuve du territoire, Sylvie Salles, in Cahiers thématiques n°9 : Paysage, territoire et reconversion, Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, 2010
 « Une "banlieue créative" dans le Grand Paris ? », Boris Lebeau, EchoGéo 27, 2014
« Une "banlieue créative" dans le Grand Paris ? », Boris Lebeau, EchoGéo 27, 2014 Les moteurs de développement, n° spécial Traits urbains, hiver 2011-2012
Les moteurs de développement, n° spécial Traits urbains, hiver 2011-2012



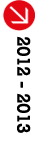
 Situation Métabolique
Situation Métabolique Djamel Klouche et François Decoster, architectes urbanistes, Agence AUC Architectures,
Djamel Klouche et François Decoster, architectes urbanistes, Agence AUC Architectures,  Patrick Braouezec, Président de la Communauté d’agglomération de Plaine Commune
Patrick Braouezec, Président de la Communauté d’agglomération de Plaine Commune Eric Garandeau, Président du centre national du Cinéma et de l’image animée
Eric Garandeau, Président du centre national du Cinéma et de l’image animée
 Les “altérités” du tissu créatif du sud de Plaine Commune
Les “altérités” du tissu créatif du sud de Plaine Commune Pleyel, “tête de réseau” pour un cluster atypique
Pleyel, “tête de réseau” pour un cluster atypique Coupures et gentrification
Coupures et gentrification Le “climat” d’un “cluster hybride”
Le “climat” d’un “cluster hybride” Étude de stratégie d'implantation du cluster de la création sur Plaine Commune et Saint-Ouen, et sa déclinaison urbaine sur Pleyel-Saint Ouen - 2010-2011
Étude de stratégie d'implantation du cluster de la création sur Plaine Commune et Saint-Ouen, et sa déclinaison urbaine sur Pleyel-Saint Ouen - 2010-2011 Du cluster d'industries créatives au territoire de la culture et de la création
Du cluster d'industries créatives au territoire de la culture et de la création La création artistique, vecteur de l’affirmation d’une polarité mixte
La création artistique, vecteur de l’affirmation d’une polarité mixte Une stratégie territoriale issue d'un foisonnement de projets urbains
Une stratégie territoriale issue d'un foisonnement de projets urbains Une intercommunalité, pilote d'un processus
participatif expérimental
Une intercommunalité, pilote d'un processus
participatif expérimental

