Assemblage aéronautique et espace: le Bourget / 11 juillet 2013
En 2014, Eurocopter ouvrira sa nouvelle usine de fabrication de pales d’hélicoptères à Dugny afin de se rapprocher du pôle aéronautique du Bourget. Ce dernier constitue la base du projet de développement d’un territoire dont l’ambition est de devenir une porte d’entrée du Grand Paris.
Avec en son sein, le premier aéroport d’affaires en Europe, le troisième Parc des Expositions francilien, le Musée de l’Air et de l’Espace, le Salon International de l’Air et de l’Espace et le Parc de la Courneuve, le pôle du Bourget dispose d’infrastructures et d’équipements importants.
Cette dynamique est sensée aussi panser les cicatrices d’un paysage cisaillé par des infrastructures lourdes, réussir à créer de l’urbanité autour de l’industrie.
Quels projets urbains vont être impulsés par cette nouvelle installation industrielle? Comment construire une ville/de l’urbanité autour de l’aéroport ? Quelles interactions créer avec les pôles de développement voisins ?
Les intervenants
Roland Castro, Architecte, Atelier Roland Castro Sophie Denissof et Associés, membre du Conseil scientifique de l’AIGP
Damien Robert, Directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement - Plaine de France
Vincent Bourjaillat, Directeur de la Société Publique Locale Le Bourget Grand Paris
Vincent Capo-Canellas, Sénateur de la Seine-Saint-Denis, Président de la Communauté d’agglomération de l’Aéroport du Bourget (2006-2014), maire du Bourget
Jean-Luc Besse, Chef de projet Eurocopter

Situation métabolique:
Un aéroport d’affaires dans la ville
L’aéroport du Bourget
553 ha
3 000
emplois75
entreprises1 milliard €
de chiffre d’affaire- plus de
800
destinations dans le monde entier
Industrie et trafic d’affaire
«La caractéristique première du territoire, c’est ce qu’on voit de loin, c’est sa marque. Dans le domaine de l’aéronautique c’est l’excellence qui nous met en scène au niveau mondial.»
 Vincent Capo-Canellas
Vincent Capo-Canellas
La société Aéroports de Paris, gérant de la plateforme aéroportuaire du Bourget, a lancé en 2003 un programme de modernisation et de diversification sur vingt ans afin de renforcer son attractivité dans la compétition internationale. La plateforme du Bourget se distingue déjà par sa capacité à agréger différents moments de l’industrie aéronautique et aérospatiale civile et militaire, un des secteurs les plus prospères de l’Île-de-France. Tout un réseau d’entreprises est présent sur le site, des équipementiers comme Safran, aux activités de maintenance des leaders mondiaux comme Air France Industries, Dassault Falcon Services, Cessna aviation ou Embraer, en passant par la fabrication de pièces détachées ou la R&D.; Au total, la plateforme regroupe ainsi 75 entreprises, dont de nombreux leaders européens en leur domaine, soit près de 3 000 emplois. Les vols y sont aujourd’hui exclusivement réservés au trafic d’affaire, en augmentation constante. Avec plus de 800 destinations dans le monde entier, l’aéroport est le premier d’Europe en termes de volume. Il ouvre ses portes au grand public, tous les deux ans en juin, lors du célèbre salon international de l’aéronautique et de l’espace Le Bourget. Cet événement ainsi que la présence du Musée de l’air et de l’espace font de l’aéroport du Bourget une des principales vitrines de ce secteur industriel qui emploie environ 230 000 salariés dans la Région Île-de-France.
Le cœur d’un cluster aéronautique- aéroportuaire
«Le site a failli partir à l’étranger. Mais avec les opportunités foncières, et les acteurs locaux qui se sont fédérés, aujourd’hui nous construisons une usine en France. Nous avons travaillé avec des architectes et des ergonomes ce qui nous a permis de dégager des gains de productivité de l’ordre de 13%, et de rendre l’usine économiquement viable.»
 Jean Luc Besse
Jean Luc Besse
Le potentiel de développement industriel du site du Bourget n’a pas été identifié dans le premier schéma du Grand Paris qui l’incluait dans la même logique de développement que Roissy, comme une pièce du corridor aéroportuaire. Mais les acteurs économiques et politiques locaux ont saisi l’occasion pour faire de l’aéroport le porte-étendard de la filière aéronautique et spatiale de la région. Depuis 2009, deux projets phares ont été mis en route dans ce sens sur la façade ouest de l’aéroport. Le premier consiste en la relocalisation sur l’ancienne base aéronavale de Dugny, de l’usine de fabrication de pâles d’hélicoptères de la société Eurocopter implantée à La Courneuve. Le chantier a commencé en 2012 sur les terrains rachetés en 2011 par la société rebaptisée Airbus Helicopters. La création de 1000 emplois est prévue.
D’autre part, le projet Aigle adopté en 2011, porté par le pôle de compétitivité ASTech vise à créer un « techno-campus », autour des implantations d’Airbus Helicopters et du centre de recherche Innovation Works d’EADS. Le projet prévoit l’implantation d’écoles, de centres de recherche et de PME du secteur industriel sur la plateforme du Bourget. L’idée étant de promouvoir des synergies entre enseignement, industrie et recherche & développement.
Cependant, le développement économique ne se limite pas au secteur industriel. Toute la façade Est est dédiée au développement des opérateurs commerciaux de l’aviation d’affaires et aux services aux voyageurs. Elle devrait accueillir le long de l’ex RN2 des locaux destinés aux PME, du tertiaire et de l’immobilier hôtelier ainsi que quelques programmes résidentiels. La partie Sud, où se situe le parc des expositions, doit voir ses fonctions événementielles et culturelles renforcées et diversifiées, notamment par l’accueil d’immobilier commercial.
Une opportunité d’ouverture de l'aéroport sur le local
À l’évocation du Bourget, on se réfère indéniablement au Salon de l’Aéronautique et de l’Espace. Le lieu est donc intégré dans l’imaginaire collectif métropolitain comme un moment délimité dans le temps, un événement festif qui ouvre la plateforme pendant quelques jours pour mettre en scène de manière spectaculaire ses fonctions industrielles. Cependant, au quotidien, cette grande infrastructure aéroportuaire de 553 hectares est peu intégrée dans son territoire et plutôt considérée comme une source de nuisance. La croissance de l’aéroport a longtemps été centrée sur son intérieur, offrant à voir sur son pourtour un long linéaire de grillages et de façades arrières de hangars ou de bâtiments industriels. La présence de ce lieu extraordinaire créateur d’une grande richesse est très peu signifiée et ne profite pas à la qualité urbaine des quartiers environnants. L’ex RN2, large coupure entre l’aéroport et la ville du Blanc-Mesnil, est sans doute l’endroit où le contraste et le manque d’intégration est le plus saisissant. L’équipement métropolitain du Musée de l’air et de l’espace faisant face aux fast-foods bon marché.
Le développement d’activités économiques sur tout le pourtour Ouest, Sud et Est de la plateforme est pensé en lien avec les futures gares de Dugny-La Courneuve, sur la tangentielle Nord et du Bourget-aéroport sur la ligne 17 du métro du Grand Paris, face à l’entrée du Musée de l’Air et de l’Espace. Ce contexte futur offre l’opportunité de repenser profondément l’intégration de la plateforme pour en faire un « aéroport dans la ville ».
Des mutualisations d'emprises foncières pour créer de l'urbanité
«On avait pointé deux choses formidables, deux attractivités potentielles : le parc de la Courneuve à l’Ouest, qui devient Central Park, et la grande avenue du Bourget à l’Est, qui devient les Champs Elysées du Nord. C’est l’idée d’une mutualisation avec le territoire de l’aéroport pour fabriquer les deux côtés d’une très belle avenue. On voulait créer de grands évènements majeurs urbain pour qu’on trouve des bonheurs singuliers comme on en trouve dans Paris centre.»
 Roland Castro
Roland Castro
Dans le cadre de l’étude stratégique commandée par la communauté d’agglomération de l’aéroport du Bourget ( CAAB), à laquelle les villes du Blanc-Mesnil et de Bonneuil-en-France se sont associées, Christian de Portzamparc, Jean-Marie Duthilleul et Roland Castro ont travaillé notamment sur l’intégration de l’aéroport dans son territoire proche. Le développement des activités du cluster aéronautique nécessite l’aménagement d’espaces pour accueillir de nouveaux locaux à proximité des pistes, à la fois sur l’emprise actuelle de l’aéroport mais également sur le foncier limitrophe possédé par les communes. Pour les architectes-urbanistes, l’extension en U autour de l’emprise actuelle de l’aéroport ne doit pas être un simple déplacement de la limite entre la zone économique et la ville. C’est plutôt l’occasion de développer des transitions entre ces deux univers. L’équipe de Roland Castro a ainsi dessiné des zones poreuses, traversées par de grands axes et des continuités naturelles pour relier la ville avec l’aéroport mais aussi le parc de la Courneuve.
La qualité urbaine proposée par les architectes-urbanistes nécessite de travailler à des mutualisations d'emprises foncières. La promenade imaginée entre Le Bourget et Bonneuil, longeant la façade ouest de l’aéroport, la requalification de l’entrée du Bourget au niveau du carrefour Lindbergh, ou celle de la RN 2 en avenue métropolitaine, ne pourront se faire sans un travail d’aménagement « à cheval » sur les limites entre les terrains d’ADP, du Parc des expositions et des communes.
 Etude stratégique pour le pôle métropolitain du Bourget, 2009-2010Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes de l’aéroport du Bourget – Le Bourget, Drancy, Dugny
Etude stratégique pour le pôle métropolitain du Bourget, 2009-2010Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes de l’aéroport du Bourget – Le Bourget, Drancy, Dugny
Mission : Elaboration d’un plan stratégique de développement territorial et d’aménagement pour le pôle métropolitain du Bourget (727ha)
Maîtrise d'oeuvre : Atelier Roland Castro Sophie Denissof et Associés + Silvia Casi (mandataire) / Berim, BET - Mandragore, paysagiste
Territoires d'échanges :
Un territoire réactivé par des coopérations métropolitaines
Le territoire du pôle métropolitain du Bourget
34 km²
6
communes - 180 000
habitants50 000
emplois dont 6 000
emplois liés à l’aéroport du Bourget5,5%
de l’emploi francilien du secteur aéronautique- taux d’emploi de
0,57
- près de
14 000
emplois perdus en 30
ans
- taux de chômage de
18%
en 2008
 Le Bourget, un “spot” dans la constellation aéronautique et spatiale nationale
Le Bourget, un “spot” dans la constellation aéronautique et spatiale nationale
Le fonctionnement actuel des différents secteurs d’activités de la plateforme du Bourget s’inscrit dans une perspective qui dépasse son périmètre. Il s’appuie sur environ 70 entreprises situées à proximité de l’aéroport dans plusieurs zones d’activités économiques (ZAE) qui génèrent près de 6000 emplois. L’élaboration du volet économique du contrat de développement territorial du pôle métropolitain du Bourget a mis en évidence la possibilité de renforcer ces liens entre le cœur de cluster et les ZAE environnantes. La chaîne d’innovation qui va se structurer dans et autour de la plateforme pourrait également diffuser sur le territoire environnant. Les ZAE Mermoz, La Molette et Le Coudray pourraient notamment accueillir des activités supports du cluster et constituer des secteurs relais indispensables à son attractivité.
Néanmoins, la concentration d’activités du secteur aéronautique et spatial et leur mise en synergie sur le territoire de l’aéroport du Bourget doit être comprise comme un des éléments d’un système économique fonctionnant à l’échelle régionale voire nationale ou européenne. Par exemple, les pales qui seront produites dans la nouvelle usine d’Airbus helicopters à Dugny seront assemblée à Marignane près de Marseille. L’Association ASTech a été créée pour promouvoir et développer l’industrie aéronautique et spatiale française comme acteur de rang mondial dans les domaines de l’aviation d’affaires, du transport spatial, de la propulsion et des équipements. Elle mène des actions de dynamisation de l’innovation en Région Île-de-France. Labellisé pôle de compétitivité par l’Etat en 2007, ASTech réunit aujourd’hui près de 250 membres répartis dans le grand bassin parisien, soit près de 230 000 emplois.
Un pôle métropolitain en devenir
«La Plaine de France va de Paris à au-delà de Roissy avec un dynamisme économique moteur en Île-de-France. Et en même temps, c’est le territoire où les populations sont le plus en difficulté. Le Bourget y occupe une place de rotule entre les pôles économiques de Plaine Commune et de Roissy.»
 Damien Robert
Damien Robert
La croissance économique de l’aéroport du Bourget et des activités liées ne suffit pas pour l’instant à équilibrer le phénomène de désindustrialisation que connaît le territoire. Celui-ci a perdu près de 14 000 emplois en 30 ans, le taux de chômage y atteint 18% et le taux d’emploi est tombé à 0,57 en 2008. La population, qui s’était beaucoup accrue avec la construction d’un grand parc de logements sociaux quand l’industrie était florissante, subit aujourd’hui de plein fouet ces importants bouleversements et connaît de grandes difficultés sociales.
Les nombreuses zones d’activité et industrielles accueillent toutefois, selon la DRIEA, cinq secteurs d’activités qui restent dynamiques : les transports et la logistique dont le parc d’entrepôts est en progression, le BTP, l’entretien-réparation, la fabrication et l’éducation-formation. Depuis quelques années une partie des friches industrielles a été reconvertie pour accueillir des opérations d’immobilier d’entreprise pour PME-PMI. Le développement tertiaire reste très faible malgré la situation du territoire dans la zone d’influence de l’aéroport Charles-de-Gaulle. Le dynamisme du "corridor aéroportuaire" profitant plus aux polarités de Plaine Commune et de Roissy.
La volonté de faire du territoire du Bourget un pôle métropolitain et de diversifier ses activités économiques s’appuie sur la nette amélioration de sa desserte en transports en commun, grâce notamment aux cinq futures gares prévues sur les lignes 15, 16 et 17 qui se croiseront au niveau de l’actuelle gare du Bourget sur le RER B. Cependant le développement de cette nouvelle identité du territoire ne peut reposer uniquement sur l’amélioration de son accessibilité et nécessite des gestes forts attendus par les élus.
Des “hauts-lieux” pour écrire le récit métropolitain du territoire
«Dans le Grand Paris, on est dans un territoire 25 fois plus grand que Paris, qui devient multipolaire. Des lieux deviennent aussi importants que le centre de Paris. À cette échelle, et avec la volonté de faire des projets extraordinaires, peut-être que plus tard Paris-centre ne sera plus aussi attractif par rapport à ces territoires qui sont des espaces de centralités potentielles. À partir de deux ou trois exceptionnelles opportunités foncières mises en réseau vous avez une occasion urbaine absolument formidable.»
 Roland Castro
Roland Castro
Le travail mené sur le projet stratégique du pôle métropolitain du Bourget, a été l’occasion pour Roland Castro et son équipe d’approfondir la vision ébauchée en 2009 lors de la consultation internationale « Le Grand Pari de l’agglomération parisienne ». Pour lui, la construction de la métropole nécessite de changer la perception des banlieues et cela passe par la construction de « hauts-lieux métropolitains » capables de générer des images fortes et des récits à mêmes de structurer un nouvel imaginaire métropolitain où Paris ne serait plus la seule polarité. C’est dans cette idée que l’équipe avait produit, sous forme de collage, les images provocantes qui faisaient du parc de La Courneuve un « Central Park » parisien, et de l’ex RN2 les « Champs Elysées du Nord ». Au-delà des possibilités économiques, c’est la qualité des lieux et leur beauté qui font l’attractivité des territoires et peuvent permettre de leur donner une identité dans la grande échelle métropolitaine. Jean-Marie Duthilleul et Christian de Portzamparc, l’un en concevant une couverture spectaculaire au-dessus du futur pôle multimodal, ou l’autre en mettant en scène les fusées du musée de l’air et de l’espace dans un carrefour Lindbergh réaménagé participent également à leur manière de cette ambition.
Cependant, cette idée de créer des lieux extraordinaires dans le territoire du Bourget n’est pas la seule clé pour amorcer sa transformation. L'important travail sur les continuités urbaines et paysagères a également été mis en valeur par l’APUR chargée de synthétiser les travaux des trois équipes d’architectes.
 Etude stratégique pour le pôle métropolitain du Bourget, 2009-2010
Etude stratégique pour le pôle métropolitain du Bourget, 2009-2010
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes de l’aéroport du Bourget – Le Bourget, Drancy, Dugny
Mission : Elaboration d’un plan stratégique de développement territorial et d’aménagement pour le pôle métropolitain du Bourget (727ha)
Maîtrise d'oeuvre : Atelier Roland Castro Sophie Denissof et Associés + Silvia Casi (mandataire) / Berim, BET - Mandragore, paysagiste
 Des coopérations pour “faire atterrir” les visions
Des coopérations pour “faire atterrir” les visions
«Le territoire a besoin d’un outil d’Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), et non d’un outil opérationnel, car il y a déjà l’EPA Plaine de France. Nous avons conduit un gros travail avec l’APUR depuis deux ans en repartant du territoire, pour faire se rencontrer la vision métropolitaine portée par les équipes d’architectes du Grand Paris et la vision des acteurs locaux.»
 Vincent Bourjaillat
Vincent Bourjaillat
«Nous avons fait travailler un certain nombre d’architectes parce que les élus avaient des ambitions, et qu’ils pensaient qu’en se fédérant autour de fonctions métropolitaines, ils allaient arriver à construire un projet de territoire.»
 Vincent Capo-Canellas
Vincent Capo-Canellas
Avant le lancement du projet du Grand Paris, les communes du territoire du Bourget étaient relativement isolées, seules les communes du Bourget et de Drancy avaient décidé de s’unir dans une communauté de communes en 2006. Les oppositions politiques rendaient difficile le dialogue avec l’EPA Plaine de France et la mise en place d’un véritable projet de territoire. L’annonce du projet du Grand Paris a fait l’effet d’un déclencheur. Les élus locaux, notamment le maire du Bourget Vincent Capo-Canellas, ont été parmi les premiers à se saisir du projet de l’État et à engager le dialogue avec celui-ci, afin de faire du territoire un pôle métropolitain. Une ambition qui fut par la suite confortée dans le SDRIF. Un processus de coopération territoriale s’est mis en route et a mené à la création de la Communauté d’agglomération de l’Aéroport du Bourget (CAAB) regroupant Le Bourget, Drancy et Dugny. Celle-ci a mené avec les villes du Blanc-Mesnil et de Bonneuil-en-France une étude stratégique. Les architectes Christian de Portzamparc, Roland Castro et Jean-Marie Duthilleul y ont oeuvré, ainsi que l'APUR, participant notamment à plusieurs ateliers territoriaux.
Fin 2012 la CAAB et la ville du Blanc-Mesnil se sont associées pour créer un outil commun, la Société Publique Locale Le Bourget-Grand Paris. Celle-ci, en partenariat avec l’APUR, a accompagné, les élus des 5 communes dans l’élaboration d’un schéma de référence du pôle afin de stabiliser les différentes visions du territoire. Il constitue le socle du Contrat de Développement Territorial signé avec l’Etat en 2014.
Le Bourget dans le Grand Paris
La vision de l'atelier Castro Denissof Casi
«
Les lieux symboliques
Notre Grand Paris se veut solidaire et naturellement poétique car nul n’habite un schéma directeur et que « c’est poétiquement que l’homme habite cette terre ». C’est pourquoi notre plan général est comme un tableau de Pollock où figure une égalité de traitement sur la toile, comme un Poliakoff où les pièces du patchwork sont variées et les coutures unifient l’ensemble, comme un Vieira da Silva éclatant de lumières diverses. C’est donc un Grand Paris des poètes, de la dérive, de la flânerie, de la nonchalance… un Grand Paris du voyage. L’espace métropolitain, que nous imaginons multipolaire, devient un lieu qui recèle d’inépuisables surprises.
La seconde partie du XXe siècle a vu la ville se construire sur un mode technique, transformant l’Homme en un objet à classer, abriter, à faire circuler et travailler. Sur ce mode de pensée, une technostructure a prospéré, sa puissance n’a fait que croître. D’où un process d’aménagement par zones, et l’encouragement pervers aux architectes de fabriquer des objets célibataires, décontextualisés. Selon nous, le premier levier sur lequel s’appuyer réside dans la priorité à donner à la poésie. La mise en valeur de l’art urbain concourt à la fabrication de la ville du promeneur. L’invention de lieux et de singularités que nous appelons le Grand Paris des 1001 lieux, des 1001 visages, des 1001 villages, est guidée par un seul mot d’ordre : le contexte.
En admettant que le symbolique ordinaire en urbanisme est relatif aux institutions politiques et aux activités publiques, on peut parler d’un symbolique extraordinaire, relatif aux activités valorisantes de la société civile. C’est bien ce symbolique extraordinaire qui est à l’oeuvre dans le projet. La question du rapport au temps, et particulièrement l’inscription dans la modernité, est fondamentale pour les métropoles. Aujourd’hui, les processus de mondialisation économique imposent une nouvelle division internationale des fonctions des villes, ce qui implique que la défi nition de la position d’une métropole se fait en rapport à la planète et non plus seulement à l’espace régional ou national. Une fonctionnalité capable de fixer l’imaginaire mondial est nécessaire afin d’inscrire la métropole dans sa modernité et d’en faire une ville monde. Trois éléments sont susceptibles de jouer un rôle dans cette conquête de modernité : les leviers événementiels (la capacité à accueillir des événements mondiaux est fondamentale) ; les leviers culturels (un lieu du patrimoine universel tel le musée Guggenheim à Bilbao ou l’opéra de Sydney) ; les leviers universitaires.
“Il faut des monuments aux cités de l’homme, autrement, où serait la différence entre la ville et la fourmilière ?"Victor Hugo Choses vues (1887)
Entre histoire et modernité, les lieux symboliques ont vocation à incarner et à refonder l’identité républicaine d’aujourd’hui. Les nouveaux monuments que nous proposons pour le Grand Paris sont susceptibles d’être portés à l’incandescence à l’instar de la tour Eiffel, de Notre-Dame de Paris ou de la Grande Arche. »Ils ont pour ambition de renforcer la cohésion nationale, de mettre en liaison Paris – capitale pour le monde – avec le monde multipolaire d’aujourd’hui, de symboliser les deux défis majeurs de notre temps – la connaissance et la sauvegarde de la planète – et enfin d’inscrire l’espace des fédérations de communes du Grand Paris dans un lieu fondateur.
 Atelier Castro Denissof Casi / Laboratoire AMP / Nexity, villes et projets / Berim
Atelier Castro Denissof Casi / Laboratoire AMP / Nexity, villes et projets / Berim
Les photos prises sur le territoire



















Pour aller plus loin...
- L'aéroport du Bourget
-
 Histoire de l’aéroport, Musée de l’Air et de l’Espace
Histoire de l’aéroport, Musée de l’Air et de l’Espace
 L'aviation d'affaires et l'aéroport du Bourget : une activité stratégique pour l'attractivité de la région capitale, CCIP, 2005
L'aviation d'affaires et l'aéroport du Bourget : une activité stratégique pour l'attractivité de la région capitale, CCIP, 2005
- L'industrie aéronautique
-
 La filière aéronautique et spatiale, un domaine d’excellence francilien, CESER Île-de-France, 2012
La filière aéronautique et spatiale, un domaine d’excellence francilien, CESER Île-de-France, 2012
 Le rapport annuel du Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS)
Le rapport annuel du Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) Le pôle de compétitivité Astech Paris Région
Le pôle de compétitivité Astech Paris Région
- Le cluster aéronautique du Bourget
-
 Le Bourget : Structuration de l’excellence aéronautique, CCI Seine-Saint-Denis, 2013
Le Bourget : Structuration de l’excellence aéronautique, CCI Seine-Saint-Denis, 2013
 Les usines remplacent les casernes, L'Usine Nouvelle n° 3371, 2014
Les usines remplacent les casernes, L'Usine Nouvelle n° 3371, 2014
- Le CDT Pôle Métropolitain du Bourget
-
 Présentation du Contrat de développement territorial du Pôle métropolitain du Bourget, EPA Plaine de France
Présentation du Contrat de développement territorial du Pôle métropolitain du Bourget, EPA Plaine de France
 Pôle métropolitain du Bourget - Le schéma de référence du projet de territoire, APUR, 2014
Pôle métropolitain du Bourget - Le schéma de référence du projet de territoire, APUR, 2014 Présentation du Contrat de développement territorial Coeur Economique Roissy Terres de France, EPA Plaine de France, 2012
Présentation du Contrat de développement territorial Coeur Economique Roissy Terres de France, EPA Plaine de France, 2012 Portrait de territoire : Le Bourget, DRIEA, 2013
Portrait de territoire : Le Bourget, DRIEA, 2013 Fiche CDT Pôle d’excellence aéronautique, IAU, 2013
Fiche CDT Pôle d’excellence aéronautique, IAU, 2013
- Points de vue
-
 Plaine de France : Les moteurs de développement, n° spécial Traits urbains, hiver 2011-2012
Plaine de France : Les moteurs de développement, n° spécial Traits urbains, hiver 2011-2012



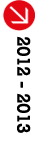
 Roland Castro, Architecte, Atelier Roland Castro Sophie Denissof et Associés, membre du Conseil scientifique de l’AIGP
Roland Castro, Architecte, Atelier Roland Castro Sophie Denissof et Associés, membre du Conseil scientifique de l’AIGP Damien Robert, Directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement - Plaine de France
Damien Robert, Directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement - Plaine de France Vincent Capo-Canellas, Sénateur de la Seine-Saint-Denis, Président de la Communauté d’agglomération de l’Aéroport du Bourget (2006-2014), maire du Bourget
Vincent Capo-Canellas, Sénateur de la Seine-Saint-Denis, Président de la Communauté d’agglomération de l’Aéroport du Bourget (2006-2014), maire du Bourget Jean-Luc Besse, Chef de projet Eurocopter
Jean-Luc Besse, Chef de projet Eurocopter
 Etude stratégique pour le pôle métropolitain du Bourget, 2009-2010
Etude stratégique pour le pôle métropolitain du Bourget, 2009-2010 Le Bourget, un “spot” dans la constellation aéronautique et spatiale nationale
Le Bourget, un “spot” dans la constellation aéronautique et spatiale nationale Des coopérations pour “faire atterrir” les visions
Des coopérations pour “faire atterrir” les visions




















