Centre d'affaire : la Défense, place d'échange / 14 février 2013
La Défense, premier quartier d’affaires en Europe en termes de surface, constitue l’un des points nodaux du système de flux financiers mondiaux. Soutenus par les investissements immobiliers nationaux et étrangers, les tours de bureaux s’agrègent autour des salles de marchés et des donneurs d’ordres internationaux. Dans cette boucle de la Seine, sous un skyline qui ne cesse de se transformer, tout un territoire est en chantier.
Les intervenants
François Leclercq, Architecte, urbaniste, Agence François Leclercq, membre du Conseil scientifique de l’AIGP
Yamina Tadjeddine, Maître de conférences en Sciences Économique, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, ÉconomiX
Patrick Jarry, Maire de Nanterre
Pierre Bordeaux, Adjoint délégué aux prospectives et développement stratégique, mairie de Courbevoie (2007-2014)
Philippe Chaix, Directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA) (2008-2013)
Katayoune Panahi, Directrice Générale de Defacto (jusqu’en janvier 2014), Etablissement Public de Gestion du quartier d’affaires de La Défense

 Situation métabolique:
Situation métabolique:
La dalle de bureaux comme potentiel d’intensité urbaine
Le quartier d’affaires de la Défense c'est :
160 ha
dont 31 ha
sur dalle ,
4 millions
de m² de bureaux ,
200 000
emplois dont 1/3
en finance ,
3 600
sociétés dont 1500
sièges sociaux ,
2 à 3
millions de transactions par jour ,
1/4
du PIB de la région IDF
 Cadre matériel d’économies immatérielles
Cadre matériel d’économies immatérielles
«Un titre financier, finalement, ce n’est qu’un contrat. Derrière il y a toujours une promesse de revenus futurs ce qui pose la question de la confiance. Le service financier nécessite des dispositifs autres que contractuels : réputation, réseaux, encadrements et énormément de services connexes... Il repose aussi sur la rencontre réelle des personnes. La confiance avec le client se fait également par l’installation dans les beaux quartiers synonymes de richesse. L’intérieur doit-être cosy. La Défense donne aussi ce symbole de prestige.»
 Yamina Tadjeddine
Yamina Tadjeddine
Le quartier d’affaires de La Défense représente à lui seul 1/4 du PIB de la Région Île-de-France et 200 000 emplois dont 1/3 dans la finance, le tout dans 4 millions de m2 de bureaux. C’est avant tout un centre de décideurs industriels des grands groupes internationaux où sont représentés 3 600 sociétés, dont 1500 sièges sociaux et 15 entreprises parmi les 50 premières mondiales. Plus qu’une cité financière comme la City de Londres, c’est un lieu d’interactions économiques qui repose sur un écosystème complexe de services financiers, juridiques, d’assurances, de conseil, où l’accès aux informations et leur circulation est primordiale. Comme l’a rappelé Yamina Tadjeddine, les activités présentes sur la dalle et particulièrement la finance, par leur nature même de services intellectuels immatériels, appellent un grand nombre de flux et d’échanges d’informations. Elles reposent sur la circulation et le traitement de données numériques, s’appuyant sur une infrastructure informatique et de télécommunication quasiment invisible. Si les tours des banques abritent bureaux et salles de trading, leurs sous-sols sont aujourd’hui remplis de baies de serveurs, continuant la logique de séparation des flux voulue par le modèle de la dalle. Dans cet écosystème reposant sur l’immatériel, la question de la confiance qui passe par le contact réel est cruciale. Elle est fortement liée à l’accessibilité des lieux et à leur image. La Défense véhicule une atmosphère luxueuse nécessaire au monde des affaires. Elle attire également les habitants de la métropole et des touristes du monde entier, notamment grâce au centre commercial des Quatre temps et ses 45 millions de visiteurs annuels.
 Une nouvelle vague d’aménagements pour relancer la machine
Une nouvelle vague d’aménagements pour relancer la machine
«La Défense n’est pas une ville normale : elle fonctionne par à-coups, par relance économique. On est dans les cycles de Kondratieff : il faut toujours des investissements immobiliers pour relancer la machine.»
 François Leclercq
François Leclercq
«Toute La Défense est irriguée par des réseaux techniques, un atout important pour son développement durable. C’est le côté très positif des concepts urbains qui sont à l’origine de La Défense. Un de nos défis est de continuer dans cette ligne.»
 Philippe Chaix
Philippe Chaix
Le modèle de développement de La Défense s’est fait par vagues successives d’investissements lourds nécessaires pour entretenir son aménagement spectaculaire. Le Plan de Renouveau engagé par l’EPADESA en 2006, correspond à une de ces phases. Il s’attache à la rénovation de l’infrastructure, des espaces publics et d’une partie des tours, afin que La Défense reste concurrentielle dans la lutte que se livrent les quartiers d’affaire. Pour tendre vers l’équilibre financier, il est nécessaire de réaliser de nouvelles tours haut-de-gamme, répondant aux “canons du développement durable”. Du fait de la rareté de la ressource foncière, les nouvelles constructions voient le jour en bordure de dalle, dans des sites complexes, ou bien en dehors, sur le sol réel de l’autre côté du boulevard circulaire.
Dans la continuité du Plan de Renouveau, la Défense a éte définie en 2009 comme le cœur d’un des clusters du Grand Paris avec l’idée de le positionner comme une cité financière à l’image de la City de Londres. Cela passe par une meilleure intégration des institutions économiques et financières franciliennes, l’installation des services financiers et à haute valeur ajoutée à destination des centres décisionnels des grands groupes, et enfin le renforcement des liens entre ces derniers et les structures d’enseignement supérieur et de recherche déjà présentes au sein du pôle Léonard de Vinci. L’amélioration de son accessibilité et des liaisons avec les autres pôles métropolitains et les aéroports est également nécessaire. La mise en service du RER Eole, les lignes 15 et 18 du métro du Grand Paris et une possible gare TGV devraient y contribuer.
 Entre les tours, une urbanité à définir
Entre les tours, une urbanité à définir
«À La Défense ce qui manque c’est ce petit plaisir du quotidien. La Défense ne doit pas tomber dans son travers d’être belle et ennuyeuse. Il faut faire une économie qui se repaît dans le petit. Jane Jacobs dit “quand les lieux deviennent embêtants, même les riches se cassent”.»
 François Leclercq
François Leclercq
La construction d'une tour de bureaux à la Défense est avant tout un investissement financier et le moyen pour l'économie française et les grands groupes d'affirmer leur image. La question urbaine et la prise en compte des usagers arrive ensuite. C'est ce qui explique en partie l'absence de l'échelle du banal, celle de l’“activité présentielle” qui permettrait d’animer le quartier après les horaires de bureaux. Une qualité urbaine de plus en plus nécessaire à l’émulsion inter-professionnelle de l’afterwork, moment plus détendu mais néanmoins indispensable au fonctionnement des affaires et à la circulation d’informations. Des efforts ont été entrepris depuis plusieurs années notamment sous l’impulsion de Defacto, établissement public de gestion du quartier d’affaires de la Défense créé en 2007 et en charge des espaces publics. Mais les actions entreprises restent superficielles (mobilier urbain, événementiel) et un travail plus profond sur la structure de l’espace public est nécessaire. Le peu de lien entre la dalle et son extériorité ainsi que l’“autisme” des tours conçues comme des univers artificiels clos, bref le modèle architectural de séparation des fonctions et des flux est un frein majeur au développement de la convivialité du quartier. Un bâtiment comme la tour Carpe Diem, qui intègre dans son pied un large escalier public reliant le sol artificiel au sol naturel et le travail de transparence de son rez-de-chaussée, ouvre des pistes pour repenser l’urbanité de la dalle. Et faire en sorte que le gigantesque parvis ne soit pas qu’une jolie antichambre, un lieu de passage agrémenté de belles sculptures.
 La Défense Seine Arche - 2008-2012Maîtrise d’ouvrage : EPADESA
La Défense Seine Arche - 2008-2012Maîtrise d’ouvrage : EPADESA
Mission : AMO + conception urbaine
Maîtrise d'oeuvre : François Leclercq, architectes urbanistes (mandataire) + Agence TER paysagistes + Semaphores + CITEC
 Les “mythologies de demain”… “continuer l’onirisme moderne”
Les “mythologies de demain”… “continuer l’onirisme moderne”
«La Défense n’est pas figée comme Paris qui se fossilise : quelqu’un veut élever sa tour, il peut le faire sans trop de problèmes. C’est un lieu qui peut tourner sur 24 heures, y compris la nuit car on ne dérange personne. La Défense doit rester dans l’exceptionnel mais aussi se replacer au quotidien. Après avoir travaillé sur le sky skripping il faut travailler sur le ground scraping. Il faut continuer ces mythologies de demain.»
 François Leclercq
François Leclercq
Pour François Leclercq, La Défense est le lieu de l’onirisme moderne, où l'on a pu construire ce qui était impensable dans le centre historique de Paris. La puissance symbolique et économique de cet objet en fait un bon support de controverses mais il ne laisse personne dans l’indifférence. C’est un lieu de prestige, du show-off, l’un des derniers lieux de la course à la hauteur en France. Ce phénomène, qui peut-être jugé comme enfantin, est pour l’architecte synonyme de liberté architecturale, contrairement à Paris qui « se fossilise ». La phase de relance de La Défense que constitue le projet du Grand Paris offre la possibilité de reprojeter une image forte pour ce lieu exceptionnel.
Le problème du manque d’urbanité décrit précédemment pourrait trouver une issue si l’on considère l’espace public de la dalle non plus comme un plan, mais comme une épaisseur, une strate complexe qui irait du sol naturel au rez-de-chaussée des tours. C’est l’idée du “ground scraping” succédant au “sky scraping” évoqué par F. Leclercq et étudiée plus précisément par l’agence AWP pour le compte de Defacto. La conquête des cathédrales de béton du sous-sol de la dalle, où l’on trouve beaucoup d’espaces résiduels, offre des opportunités pour à la fois implanter les programmes du quotidien qui manquent et améliorer l’intégration de la dalle dans son environnement, créer des façades sur la ville.
 La Défense Seine Arche - 2008-2012Maîtrise d’ouvrage : EPADESA
La Défense Seine Arche - 2008-2012Maîtrise d’ouvrage : EPADESA
Mission : AMO + conception urbaine
Maîtrise d'oeuvre : François Leclercq, architectes urbanistes (mandataire) + Agence TER paysagistes + Semaphores + CITEC
 Territoires d'échanges :
Territoires d'échanges :
Territorialiser la Défense
De la Seine à la Seine : c'est un territoire de
40 km² / 6
communes et 2
CDT ,
370 000
habitants / 346 000
emplois ,
5 000 000 m²
de SHON de bureaux ,
2
CDT (Les deux-Seine et Seine Défense) ,
avec respectivement 38,1% et 52,5%
d’emplois cadres ,
des taux d’emploi de 1,38 et 2,4
,
+1,42% et + 2,16% par an
de croissance de l’emploi
 Cadre matériel d’économies immatérielles
Cadre matériel d’économies immatérielles
«Un titre financier, finalement, ce n’est qu’un contrat. Derrière il y a toujours une promesse de revenus futurs ce qui pose la question de la confiance. Le service financier nécessite des dispositifs autres que contractuels : réputation, réseaux, encadrements et énormément de services connexes... Il repose aussi sur la rencontre réelle des personnes. La confiance avec le client se fait également par l’installation dans les beaux quartiers synonymes de richesse. L’intérieur doit-être cosy. La Défense donne aussi ce symbole de prestige.»
 Yamina Tadjeddine
Yamina Tadjeddine
Le quartier d’affaires de La Défense représente à lui seul 1/4 du PIB de la Région Île-de-France et 200 000 emplois dont 1/3 dans la finance, le tout dans 4 millions de m2 de bureaux. C’est avant tout un centre de décideurs industriels des grands groupes internationaux où sont représentés 3 600 sociétés, dont 1500 sièges sociaux et 15 entreprises parmi les 50 premières mondiales. Plus qu’une cité financière comme la City de Londres, c’est un lieu d’interactions économiques qui repose sur un écosystème complexe de services financiers, juridiques, d’assurances, de conseil, où l’accès aux informations et leur circulation est primordiale. Comme l’a rappelé Yamina Tadjeddine, les activités présentes sur la dalle et particulièrement la finance, par leur nature même de services intellectuels immatériels, appellent un grand nombre de flux et d’échanges d’informations. Elles reposent sur la circulation et le traitement de données numériques, s’appuyant sur une infrastructure informatique et de télécommunication quasiment invisible. Si les tours des banques abritent bureaux et salles de trading, leurs sous-sols sont aujourd’hui remplis de baies de serveurs, continuant la logique de séparation des flux voulue par le modèle de la dalle. Dans cet écosystème reposant sur l’immatériel, la question de la confiance qui passe par le contact réel est cruciale. Elle est fortement liée à l’accessibilité des lieux et à leur image. La Défense véhicule une atmosphère luxueuse nécessaire au monde des affaires. Elle attire également les habitants de la métropole et des touristes du monde entier, notamment grâce au centre commercial des Quatre temps et ses 45 millions de visiteurs annuels.
 Une nouvelle vague d’aménagements pour relancer la machine
Une nouvelle vague d’aménagements pour relancer la machine
«La Défense n’est pas une ville normale : elle fonctionne par à-coups, par relance économique. On est dans les cycles de Kondratieff : il faut toujours des investissements immobiliers pour relancer la machine.»
 François Leclercq
François Leclercq
«Toute La Défense est irriguée par des réseaux techniques, un atout important pour son développement durable. C’est le côté très positif des concepts urbains qui sont à l’origine de La Défense. Un de nos défis est de continuer dans cette ligne.»
 Philippe Chaix
Philippe Chaix
Le modèle de développement de La Défense s’est fait par vagues successives d’investissements lourds nécessaires pour entretenir son aménagement spectaculaire. Le Plan de Renouveau engagé par l’EPADESA en 2006, correspond à une de ces phases. Il s’attache à la rénovation de l’infrastructure, des espaces publics et d’une partie des tours, afin que La Défense reste concurrentielle dans la lutte que se livrent les quartiers d’affaire. Pour tendre vers l’équilibre financier, il est nécessaire de réaliser de nouvelles tours haut-de-gamme, répondant aux “canons du développement durable”. Du fait de la rareté de la ressource foncière, les nouvelles constructions voient le jour en bordure de dalle, dans des sites complexes, ou bien en dehors, sur le sol réel de l’autre côté du boulevard circulaire.
Dans la continuité du Plan de Renouveau, la Défense a éte définie en 2009 comme le cœur d’un des clusters du Grand Paris avec l’idée de le positionner comme une cité financière à l’image de la City de Londres. Cela passe par une meilleure intégration des institutions économiques et financières franciliennes, l’installation des services financiers et à haute valeur ajoutée à destination des centres décisionnels des grands groupes, et enfin le renforcement des liens entre ces derniers et les structures d’enseignement supérieur et de recherche déjà présentes au sein du pôle Léonard de Vinci. L’amélioration de son accessibilité et des liaisons avec les autres pôles métropolitains et les aéroports est également nécessaire. La mise en service du RER Eole, les lignes 15 et 18 du métro du Grand Paris et une possible gare TGV devraient y contribuer.
 Entre les tours, une urbanité à définir
Entre les tours, une urbanité à définir
«À La Défense ce qui manque c’est ce petit plaisir du quotidien. La Défense ne doit pas tomber dans son travers d’être belle et ennuyeuse. Il faut faire une économie qui se repaît dans le petit. Jane Jacobs dit “quand les lieux deviennent embêtants, même les riches se cassent”.»
 François Leclercq
François Leclercq
La construction d'une tour de bureaux à la Défense est avant tout un investissement financier et le moyen pour l'économie française et les grands groupes d'affirmer leur image. La question urbaine et la prise en compte des usagers arrive ensuite. C'est ce qui explique en partie l'absence de l'échelle du banal, celle de l’“activité présentielle” qui permettrait d’animer le quartier après les horaires de bureaux. Une qualité urbaine de plus en plus nécessaire à l’émulsion inter-professionnelle de l’afterwork, moment plus détendu mais néanmoins indispensable au fonctionnement des affaires et à la circulation d’informations. Des efforts ont été entrepris depuis plusieurs années notamment sous l’impulsion de Defacto, établissement public de gestion du quartier d’affaires de la Défense créé en 2007 et en charge des espaces publics. Mais les actions entreprises restent superficielles (mobilier urbain, événementiel) et un travail plus profond sur la structure de l’espace public est nécessaire. Le peu de lien entre la dalle et son extériorité ainsi que l’“autisme” des tours conçues comme des univers artificiels clos, bref le modèle architectural de séparation des fonctions et des flux est un frein majeur au développement de la convivialité du quartier. Un bâtiment comme la tour Carpe Diem, qui intègre dans son pied un large escalier public reliant le sol artificiel au sol naturel et le travail de transparence de son rez-de-chaussée, ouvre des pistes pour repenser l’urbanité de la dalle. Et faire en sorte que le gigantesque parvis ne soit pas qu’une jolie antichambre, un lieu de passage agrémenté de belles sculptures.
 Les “mythologies de demain”… “continuer l’onirisme moderne”
Les “mythologies de demain”… “continuer l’onirisme moderne”
«La Défense n’est pas figée comme Paris qui se fossilise : quelqu’un veut élever sa tour, il peut le faire sans trop de problèmes. C’est un lieu qui peut tourner sur 24 heures, y compris la nuit car on ne dérange personne. La Défense doit rester dans l’exceptionnel mais aussi se replacer au quotidien. Après avoir travaillé sur le sky skripping il faut travailler sur le ground scraping. Il faut continuer ces mythologies de demain.»
 François Leclercq
François Leclercq
Pour François Leclercq, La Défense est le lieu de l’onirisme moderne, où l'on a pu construire ce qui était impensable dans le centre historique de Paris. La puissance symbolique et économique de cet objet en fait un bon support de controverses mais il ne laisse personne dans l’indifférence. C’est un lieu de prestige, du show-off, l’un des derniers lieux de la course à la hauteur en France. Ce phénomène, qui peut-être jugé comme enfantin, est pour l’architecte synonyme de liberté architecturale, contrairement à Paris qui « se fossilise ». La phase de relance de La Défense que constitue le projet du Grand Paris offre la possibilité de reprojeter une image forte pour ce lieu exceptionnel.
Le problème du manque d’urbanité décrit précédemment pourrait trouver une issue si l’on considère l’espace public de la dalle non plus comme un plan, mais comme une épaisseur, une strate complexe qui irait du sol naturel au rez-de-chaussée des tours. C’est l’idée du “ground scraping” succédant au “sky scraping” évoqué par F. Leclercq et étudiée plus précisément par l’agence AWP pour le compte de Defacto. La conquête des cathédrales de béton du sous-sol de la dalle, où l’on trouve beaucoup d’espaces résiduels, offre des opportunités pour à la fois implanter les programmes du quotidien qui manquent et améliorer l’intégration de la dalle dans son environnement, créer des façades sur la ville.
 La Défense Seine Arche - 2008-2012Maîtrise d’ouvrage : EPADESA
La Défense Seine Arche - 2008-2012Maîtrise d’ouvrage : EPADESA
Mission : AMO + conception urbaine
Maîtrise d'oeuvre : François Leclercq, architectes urbanistes (mandataire) + Agence TER paysagistes + Semaphores + CITEC
 La Défense dans le Grand Paris
La Défense dans le Grand Paris
La vision du groupe Descartes
«
Développer des pôles d’emplois diversifiés
Si l’organisation urbaine ne crée pas de richesse par elle-même, elle peut la favoriser. Elle ne doit donc pas nuire aux intérêts des entreprises, tout en contrôlant le risque de leur disparition spatiale, qui engendrerait des inégalités sociales supplémentaires dans la compétition sur le sol, ou provoquerait des nuisances environnementales. La localisation des entreprises participe de la façon dont se nouent les contradictions métropolitaines. Il convient d’éviter leur concentration excessive : celle-ci alimente le plus souvent la discorde localisée entre type d’emplois et parc d’habitat.
En dehors des plates-formes logistiques, il est urgent de moduler les implantations d’emplois pour éviter les hyperspécialisations. Il faut rompre avec l’unicité du marché de l’emploi : Paris ne saurait être considéré comme l’unique bassin de ce marché. Les vingt projets de territoire que nous proposons sont à considérer comme autant de bassins d’emploi/logements.
La cohérence emplois/habitat exige peut-être des collectivités une intervention accrue et des ressources nouvelles. Une taxe sur les localisations pourrait pénaliser les entreprises situées sur les bassins d’emplois saturés ou discordant avec les parcs d’habitat. Redistribuée à l’échelle métropolitaine, elle permettrait des acquisitions foncières et une péréquation du coût du logement. La procédure d’affectation de ces produits fiscaux nouveaux reste à imaginer, et devra sans doute être cogérée par l’Etat et les collectivités. Le leadership pourrait en être régional, selon une nouvelle logique de planification « au projet » plutôt qu’ « au règlement ». La planification ne devra alors plus être strictement descendante, comme actuellement, mais plutôt coproduite par les différents niveaux institutionnels au travers un système d’interactions continu.
L’inégalité territoriale s’exprime avant tout dans l’existence et le renforcement des disparités en termes de ressources financière entre les territoires de l’agglomération. Aux communes riches s’opposent des communes présentant, pour certaines, un niveau de surendettement inquiétant. Cet écart de ressources pose plusieurs problèmes évidents. En premier lieu, il impacte directement la capacité d’une commune à fournir des services quotidiens de qualité à ses habitants. Est-il normal qu’il existe une disparité si importante entre les services reçus par deux citoyens franciliens pour la seule raison que l’un habite Neuilly et l’autre Sevran ?
Les ressources financières n’affectent pas seulement la capacité d’une commune à fournir des services quotidiens à ces habitants : elles influent aussi lourdement sur sa capacité à aménager le territoire. En la privant de cette capacité, l’absence de revenus l’empêche d’accomplir une des premières missions de l’action publique territoriale : la nécessité de se substituer au marché afin de renverser des tendances économiques qui, faute de cette intervention, se renforcent et s’entretiennent.
Au-delà même de la question de l’inégalité territoriale, c’est surtout l’inefficacité du système fiscal actuel qui peut être pointée. En liant les recettes d’une commune à sa prospérité et à son attractivité, le système fiscal agit à l’inverse de ce qu’il devrait : il génère des ressources supplémentaires dans les territoires déjà plébiscités par le marché et prive les autres des moyens d’inverser cette tendance. En termes d’allocation de ressources, le système est inopérant et ne parvient pas à créer de leviers d’investissements à où ils sont nécessaires. Il aboutit à une situation paradoxale dans laquelle une métropole produisant des ressources généreuses, se révèle incapable de les investir de manière pertinente. En somme, le Grand Paris produit de l’argent impuissant, au travers d’un système fiscal qui conforte l’existant et démunit l’avenir.
Il s’agira d’essaimer les fonctions métropolitaines sur des réseaux de déplacement différents de ceux qui relient domicile et services de proximité, ou domiciles et emplois. Les fonctions métropolitaines seront judicieusement disséminées pour rééquilibrer sociologiquement la périphérie, en évitant une concentration excessive à Paris et à la Défense, et en garantissant leur bonne accessibilité depuis l’extérieur de la métropole (aéroport et TGV). Outre cette bonne répartition des fonctions métropolitaines, les avantages économiques attendus de l’organisation urbaine concernent la sauvegarde de la spécificité de la métropole parisienne qui a su, dans les siècles passés, imbriquer les espaces résidentiels, de travail ou de distraction sans qu’aucune de ces informations ne domine les autres. En cela, Paris est unique au monde. En revanche, elle risquerait fort de se banaliser si le primat donné aux grandes infrastructures la transformait en une mosaïque d’espaces spécialisés, comme les autres métropoles mondiales.» Le réseau des autoroutes urbaines aura du mal à jouer ce rôle métropolitain tant qu’il ne sera pas payant, et le reste du réseau radial de RER devra sans doute être complété, à terme, par un réseau inter périphérique qui reliera entre-elles les fonctions métropolitaines.
 Groupe Descartes
Groupe Descartes
 La carte interactive
La carte interactive
Les photos prises sur le territoire




































 Pour aller plus loin...
Pour aller plus loin...
- Le quartier d'affaires
 Les quartiers centraux d’affaire, in Géographie de l’emploi 2006 en Ile-de-France - Edition 2009, INSEE
Les quartiers centraux d’affaire, in Géographie de l’emploi 2006 en Ile-de-France - Edition 2009, INSEE Le guide architecture, Musée de la Défense, Defacto
Le guide architecture, Musée de la Défense, Defacto Le plan guide des espaces publics du quartier d’affaires de La Défense, Defacto, 2013
Le plan guide des espaces publics du quartier d’affaires de La Défense, Defacto, 2013 «La Défense, dictionnaire et atlas Architecture / Politique, Histoire / Territoire», Pierre Chabard, Virginie Picon-Lefebvre, Parenthèses, 2012
«La Défense, dictionnaire et atlas Architecture / Politique, Histoire / Territoire», Pierre Chabard, Virginie Picon-Lefebvre, Parenthèses, 2012
- La Défense dans son territoire
 L’étude de François Leclercq commandée par l’EPADESA, 2009
L’étude de François Leclercq commandée par l’EPADESA, 2009 Une Histoire de La Défense Seine Arche par François Leclercq
Une Histoire de La Défense Seine Arche par François Leclercq Le groupe de travail « métropolisons La Défense » de Paris Métropole, 2010
Le groupe de travail « métropolisons La Défense » de Paris Métropole, 2010 La Défense dans son territoire, IAUîdF, 2010
La Défense dans son territoire, IAUîdF, 2010 La Défense 2050 - Au-delà de la forme, 29ème session des ateliers internationaux de maîtrise d’oeuvre urbaine de Cergy-Pontoise, Île De France, 2011
La Défense 2050 - Au-delà de la forme, 29ème session des ateliers internationaux de maîtrise d’oeuvre urbaine de Cergy-Pontoise, Île De France, 2011 Paris-La Défense, moteur d'attractivité internationale de l'Ile-de-France : un quartier d'affaires privilégié pour les centres de décision, CCIP, 2007
Paris-La Défense, moteur d'attractivité internationale de l'Ile-de-France : un quartier d'affaires privilégié pour les centres de décision, CCIP, 2007
- Les Contrats de Développement Territorial Seine-Défense et la Défense Seine-Ouest
 Portrait de territoire : La Défense DRIEA, 2011
Portrait de territoire : La Défense DRIEA, 2011 Portrait de territoire : Seine Défense, DRIEA, 2013
Portrait de territoire : Seine Défense, DRIEA, 2013 Portrait de territoire : Les deux Seine, DRIEA, 2013
Portrait de territoire : Les deux Seine, DRIEA, 2013 Fiche CDT Seine Défense, IAU, 2012
Fiche CDT Seine Défense, IAU, 2012 Fiche CDT La Défense Ouest - SIEP, IAU, 2012
Fiche CDT La Défense Ouest - SIEP, IAU, 2012


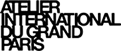

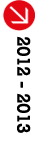
 Situation Métabolique
Situation Métabolique François Leclercq, Architecte, urbaniste, Agence François Leclercq, membre du Conseil scientifique de l’AIGP
François Leclercq, Architecte, urbaniste, Agence François Leclercq, membre du Conseil scientifique de l’AIGP Yamina Tadjeddine, Maître de conférences en Sciences Économique, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, ÉconomiX
Yamina Tadjeddine, Maître de conférences en Sciences Économique, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, ÉconomiX Patrick Jarry, Maire de Nanterre
Patrick Jarry, Maire de Nanterre Philippe Chaix, Directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA) (2008-2013)
Philippe Chaix, Directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA) (2008-2013)
 Cadre matériel d’économies immatérielles
Cadre matériel d’économies immatérielles Une nouvelle vague d’aménagements pour relancer la machine
Une nouvelle vague d’aménagements pour relancer la machine Entre les tours, une urbanité à définir
Entre les tours, une urbanité à définir La Défense Seine Arche - 2008-2012
La Défense Seine Arche - 2008-2012 Les “mythologies de demain”… “continuer l’onirisme moderne”
Les “mythologies de demain”… “continuer l’onirisme moderne” Cadre matériel d’économies immatérielles
Cadre matériel d’économies immatérielles Une nouvelle vague d’aménagements pour relancer la machine
Une nouvelle vague d’aménagements pour relancer la machine Entre les tours, une urbanité à définir
Entre les tours, une urbanité à définir Les “mythologies de demain”… “continuer l’onirisme moderne”
Les “mythologies de demain”… “continuer l’onirisme moderne”





































