Cycle 2 : Territoires d'industrie
Le savoir: Saclay, laboratoire de connaissances / 21 mars 2013
Une ville campus à vocation mondiale, comment ça marche ?
Sur le sud du plateau agricole de Saclay, une université de rayonnement international est en chantier. Le futur campus Paris Saclay est conçu pour être le socle d’une mutualisation des savoirs mais aussi des équipements. Ce nouveau modèle vise à favoriser, multiplier les échanges et innovations interdisciplinaires, et créer de nouvelles filières universités / entreprises grâce à des applications directes à proximité.
D’une superficie d’1,6 millions de km², le plateau de Saclay accueillera bientôt 50 000 nouveaux arrivants, un enjeu important pour les 49 communes concernées. Cette nouvelle ville devra correspondre aux exigences mondiales de la compétitivité scientifique, tout en respectant les qualités et fonctions paysagères du site et en s’intégrant à l’échelle locale et métropolitaine.
Quel nouvel équilibre engendrera l’émergence de ce pôle dans le réseau universitaire du Grand Paris, dans une dimension nationale et internationale ? Ce projet anticipe-t-il l'évolution de la recherche et des entreprises innovantes ?
Quelles dynamiques vont se former aux différents échelons de territoire ?
Quelles formes urbaines et quelles aménités accueilleront les habitants et utilisateurs du site, étudiants-chercheurs-travailleurs ?
Les intervenants
Michel Desvigne, Paysagiste, mandataire du groupement en charge de définir l’aménagement du Plateau de Saclay, membre du Conseil scientifique de l’AIGP (2010-2011)
Michel Lussault, Géographe, Directeur de l’Institut Français d’Education, Professeur à l'ENS de Lyon
Pierre Veltz, Président Directeur Général de l’Etablissement Public Paris-Saclay
David Bodet, Président de la Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay, 1er Maire-adjoint de Palaiseau (2007-2014)
Dominique Vernay, Président de la Fondation de Coopération Scientifique Paris-Saclay
Christophe Blondel, Directeur de recherche au C.N.R.S., laboratoire Aimé-Cotton (Orsay), Trésorier national du Syndicat National des Chercheurs Scientifiques (SNCS-FSU)
Cécile Schmollgruber, Présidente et fondatrice de Stéréolabs
 Situation métabolique:
Situation métabolique:
Vers une ville campus
Le campus sud du plateau de Saclay c'est :
L’existant :
90 000m²
de logements étudiants, 380 000m²
d’établissements d’enseignement supérieur et recherche
Le projet : 562ha
sur les Zac du Moulon et du quartier de l’école Polytechnique. 7km
de long, 2,4 milliards €
investis par l’Etat
En 2020 : 38 000
étudiants, 9000
doctorants et 12 000
enseignants chercheurs
 Un haut lieu de production de connaissances
Un haut lieu de production de connaissances
« On a souvent dit sur Saclay que c’était une création ex-nihilo et qu’on a obligé les écoles à y venir, c’est faux. Elles ont saisi qu’il y avait un intérêt important à être ensembles. »
 Pierre Veltz
Pierre Veltz
« La liste de succès de la faculté d’Orsay montre que ça marche comme c’est ! La visibilité, n’est pas une question de taille, elle s’obtient par les résultats de recherche. Autre idée reçue : la proximité crée la communication. »
 Christophe Blondel
Christophe Blondel
Le plateau de Saclay compte aujourd’hui de nombreux sites d’excellence de renommée mondiale dans le domaine scientifiques académique et industriel. Ils représentent 13 % de la recherche française. Des centres de recherche publics comme ceux de l’INRA, du CNRS ou du CEA, l’université d’Orsay, des grandes écoles comme Polytechnique, Supélec, l’Institut d’Optique, HEC et des centres de R&D; privée (Danone, Renault…) y sont implantés de manière dispersée principalement au sud du plateau et dans la vallée de l’Yvette attenante.
Comme l’a expliqué Christophe Blondel, dans les domaines de la recherche académique, l’isolement des établissements liés à cette dispersion, n’est pas forcément un frein aux performances et à la visibilité. Les nombreux prix obtenus en sont la preuve. La mise en réseau et les synergies dans ce domaine ne sont en effet que peu en lien avec le territoire, beaucoup se fait par des échanges mondialisés d’informations (publications, colloques, échanges de bases de données...).
En revanche, la question de la proximité spatiale a beaucoup plus de sens si l'on se place dans l’optique plus générale de l’innovation qui nécessite des croisements entre disciplines, des liens humains et des contacts physiques entre chercheurs, enseignants et développeurs industriels. Ces synergies demeurent faibles, malgré les dynamiques partenariales engagées dans la logique des PRES et des pôles de compétitivité qui ont permis de créer notamment les fondations de mathématiques Jacques Hadamard et Digitéo-Triangle de la Physique.
 De la connaissance à l’innovation, le campus Paris-Saclay
De la connaissance à l’innovation, le campus Paris-Saclay
« Dans l’université il y aura un équilibre des forces en termes de recherche, d’enseignement universitaire et de grandes écoles. Cette multiplicité est une illustration remarquable du système français, mais il faut réussir à réunir ces trois entités. Il y a des disciplines aux meilleurs niveaux, elles doivent se mélanger afin de créer de nouveaux savoirs. »
 Dominique Vernay
Dominique Vernay
L’impulsion récente que connaît le projet de Saclay fait suite à un investissement lourd de l’Etat de 2,4 milliards d’euros, dans le cadre de l’Idex Paris-Saclay et du Plan campus 2009. Dans ce cadre, l’objectif affiché par la fondation de coopération scientifique Paris-Saclay, créée dès 2008, est de stimuler les croisements et interactions pour favoriser le passage de la connaissance à l’innovation .Cette fondation regroupe 23 acteurs de la recherche dont deux universités, une école normale supérieure, six organismes de recherche, dix grandes écoles d’ingénieurs ou de commerce, un pôle de compétitivité, deux PRES, et la fondation Digiteo-Triangle de la Physique, qui ont décidé de s’unir pour créer un campus commun sur le sud du plateau. Le but est de renforcer l’excellence de la recherche et de l’enseignement tout en favorisant le développement technologique industriel à l’échelle nationale comme le font les grands campus comme Cambridge ou Harvard.
Le campus Paris-Saclay se développera autour d’un pôle majeur : l’Université Paris-Saclay, qui va mêler des établissements de recherche, d’enseignement universitaire et des grandes écoles. Elle devrait entrer en fonction en 2014 pour une première rentrée universitaire en septembre 2015. Ce pôle est enrichit par de nouvelles implantations de grands groupes industriels comme EDF ou Horiba qui s’ajoutent aux 20000 chercheurs et ingénieurs du secteur privé existant. Ces arrivées devraient constituer la masse critique nécessaire pour la mise en place des chaînes d’innovation dans tous les secteurs technologiques de pointe avec la création d’incubateurs, de pépinières, de start-ups…
 Un archipel d'autarcies
Un archipel d'autarcies
« C’est un endroit agréable à vivre, où il y a énormément d’espace. La grande question est de savoir si on peut animer ces quartiers, car aujourd’hui à 22h il n’y a plus rien. »
 Cécile Schmollgruber
Cécile Schmollgruber
« L’option fondamentale qui a été prise c’est de créer de la ville, de faire des quartiers vivants avec des logements étudiants mais aussi des logements pour des familles, des commerces, de la vie. Pour nous c’est le seul moyen de faire quelque chose d’attractif. Cela suppose bien sur une certaine irrigation par les transports. Il y aura trois stations sur le campus, à l’horizon 2023. »
 Pierre Veltz
Pierre Veltz
La volonté d’urbanisation massive du plateau de Saclay prévue dès les années 60 dans les politiques de planification régionales a rencontré des blocages successifs. Cela n’a pourtant pas empêché l’implantation d’établissements qui est intervenue sans véritable logique territoriale, au gré des opportunités foncières. Il en découle un paysage d’enclaves renfermées sur elles-mêmes, perdues au milieu du plateau agricole et reliées par des voies rapides. Le manque d’urbanité qui règne aujourd’hui sur le plateau reflète l’absence de politiques publiques territoriales concertées. Aujourd’hui l’hyper dépendance automobile, le lien à Paris peu efficient, mais surtout le manque de centralités et de lisibilité dus à la dispersion géographique des campus sont problématiques. Les différentes aménités urbaines sont peu présentes car les services principaux tels que la restauration, sont internalisés dans les différents établissements. On trouve des cafétérias, mais aucune brasserie ou restaurant pour rencontrer des clients ou des partenaires.
Malgré ces difficultés, ce retard d’urbanisation est peut-être une chance puisqu’il constitue une opportunité d’inventer un nouveau modèle très différent de celui du campus scientifique monofonctionnel et consommateur de terres agricoles prévu à l’origine. Les mots d’ordre sont ceux de la compacité, de la mixité fonctionnelle et sociale et d’un rapport à la nature retrouvé.
 Une urbanité par transitions paysagères
Une urbanité par transitions paysagères
« Pour donner la cohérence, il faut un grand système de parc. Il s’agit d’installer un espace mi-espace public, mi-campagnard, mi-urbain, mi-campus. Ce n'est pas un rempart vert, mais une sorte de lisière, complexe, riche entre la campagne ouverte et la ville. C’est un problème clef pour le grand Paris. à Saclay, nous arrivons à avancer sur cette idée d’expérimentation sur les franges. »
 Michel Desvigne
Michel Desvigne
L’échelle de la frange sud du plateau de Saclay, longue de 7 kilomètres, et la dispersion des différentes entités en son sein rendent complexe la conception urbaine, et particulièrement celle des espaces publics. Les premiers concours architecturaux comme ceux organisés pour le design du campus de l’école Centrale remporté par OMA ou bien le « Lieu de vie » remporté par Muoto témoignent d’une inventivité programmatique et architecturale. Ces projets cherchent à ouvrir les bâtiments et mutualiser des fonctions.
Cependant, ces évolutions à l’échelle du bâti ne suffisent pas pour concevoir un ensemble cohérent capable d’assurer une identité propre et faire lien au sein du territoire. Avant le lancement des concours d’architecture, une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et paysagère a été sélectionnée en 2009 pour 6 ans. Le paysagiste Michel Desvignes, entouré de Xaveer De Geyter, Floris Alkemade, Jean-Marie Duthilleul et Isabelle Menu, a réalisé un travail sur les transitions du centre du campus vers la campagne ouverte, avec la conception d’une chaîne d’espaces publics à différentes échelles. De l’espace central constitué de « chambres urbaines en enfilade », où se retrouvent les transports prévus par le Grand Paris Express et l’urbanité maximale, jusqu’aux grands parcs qui font la transition avec les grands espaces agricoles du plateau. Ce qui fait lien n’est pas une avenue, mais un système de parc, une lisière. C’est l’occasion d’expérimenter ce concept développé par le paysagiste avec l’équipe de Jean Nouvel, Michel Cantal-Dupart et Jean-Marie Duthilleul lors de la consultation de 2008.
 Mission de maîtrise d'oeuvre urbaine et paysagère - OIN Paris Saclay - 2009-2015Maîtrise d’ouvrage : Etablissement public Paris Saclay
Mission de maîtrise d'oeuvre urbaine et paysagère - OIN Paris Saclay - 2009-2015Maîtrise d’ouvrage : Etablissement public Paris Saclay
Maîtrise d'oeuvre : Michel Desvigne Paysagiste (MDP) avec Xaveer de Geyter (XGDA) / Floris Alkemade, architectes urbanistes
(FAA) + AREP et Tritel (mobilité), ALTO (environnement), Sogreah (développement durable...) et Setec (VRD)
 Territoires d'échanges :
Territoires d'échanges :
Le campus-ville et sa lisière
Le territoire de l’OIN Paris-Saclay c'est :
350km²
dont près de 25 km²
de terres agricoles préservées sur le plateau de Saclay ,
49
communes et 2
CDT ,
660 000
habitants ,
380 000
emplois , taux d’emploi de 1,13
,
30 000
étudiants et 20 000
enseignants et chercheurs ,
13 %
de la recherche française ,
11,5 %
d’emplois dans le secteur conception-recherche
 Cluster de l’innovation technologique
Cluster de l’innovation technologique
« Nous, élus locaux, avons le sentiment que le territoire de Saclay est un des leviers pour essayer de sortir de la nasse et positionner la France dans la compétition mondiale qui a tendance à nous laisser sur le bas-côté. Il y a un intérêt national et européen important et il ne faut jamais l’oublier. »
 David Bodet
David Bodet
Le cluster de Saclay a été pensé dès 2009 par l’Etat comme « le » cluster de l’innovation du Grand Paris. Le campus du plateau offrira un système articulant les disciplines élémentaires avec un pôle de sciences de l’ingénieur sans équivalent en France. Les applications en termes de marchés ou d’usages potentiels couvrent pratiquement tous les champs de recherche scientifique, de la santé à l’alimentation, de la mobilité à l’énergie, de l’informatique et des télécommunications à l’environnement et au cadre de vie. Il s’agit avant tout de créer les conditions du développement économique à partir de ce cœur en mettant en place des outils de transfert de technologies, en favorisant la création de PME technologiques et leur montée en puissance. Cette dynamique est déjà soutenue par des acteurs tels que le pôle de compétitivité System@tic. Il existe dans le territoire autour du plateau de Saclay de nombreux pôles tertiaires et productifs déjà pourvus d’entreprises technologiques et qui pourront accueillir les entreprises innovantes. Le périmètre de l’OIN Paris-Saclay a ainsi été pensé de manière très large pour inclure notamment la zone de Courtaboeuf qui compte déjà 1200 entreprises et 24 000 emplois, mais aussi Massy, Vélizy, la zone de Buc/Toussus/Les Loges, ou encore le plateau de Satory et Saint-Quentin-en-Yvelines.
La portée du projet de Saclay va bien au-delà du seul territoire de l’OIN. Il constitue un enjeu majeur pour l’agglomération francilienne qui regroupe 40% de la recherche française. Au sud de Paris se sont établis la majorité des activités scientifiques d’Île-de-France, dans ce qui est appelé le « cône sud de l’innovation ». Les synergies qui vont être mise en place à Saclay doivent être pensées à cette échelle qui comprend le Quartier latin, la vallée scientifique de la Bièvre ou le Génopôle d’Evry.
 Une polarité à fabriquer / un plateau à préserver
Une polarité à fabriquer / un plateau à préserver
« Il y aurait un contresens à penser Saclay uniquement dans une sorte de réactualisation du dialogue Paris-Périphérie. Et si finalement les échelles de référence pour Saclay, c’était celle des autre villes du monde et celle de l’hyper-localité qui permettra de le faire exister. Alors c’est plutôt le hub d’Orly qui devient le point d’intérêt. On pourrait dire que Saclay n’a pas besoin de se positionner par rapport à Paris. Quand Paris se « saclay-isera » on pourra dire que Saclay aura réussi. C’est une provocation mais c’est ce qui permettra de ne pas faire des villes nouvelles.»
 Michel Lussault
Michel Lussault
Le plateau de Saclay reste un grand espace naturel et agricole, peu construit et protégé à hauteur de 2469 hectares par décret d’application de la loi de 2010. Dans le périmètre de l’OIN Paris-Saclay, le plateau apparaît comme une île préservée du fort développement urbain et économique des 50 dernières années. Les 49 communes de l’EPPS, constituent aujourd’hui un grand ensemble industriel avec 10,6 % des emplois franciliens dans ce secteur. Deux faisceaux de développement structurent le territoire mais communiquent mal. L’un à l’ouest, autour des industries automobiles et de la défense, et l’autre au sud, le long du RER B à dominante de recherche publique. Depuis les années 2000, avec l’arrivée à maturité de l’ancienne ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, le territoire de Paris-Saclay accuse un ralentissement de son activité économique et de son attractivité résidentielle. Sur la période 1999-2006, la progression de l’emploi dans les 49 communes de Paris-Saclay a été de 8,9%, contre 9,4% dans l’ensemble de l’Île-de-France et le solde migratoire passe à - 4%.
La future ligne 18 du métro du Grand Paris qui reliera Orly et Massy à Versailles avec trois gares sur le territoire sud du plateau de Saclay, va mettre en place un maillage transversal du territoire qui fonctionne aujourd’hui principalement dans une logique radiale de dépendance à Paris. Comme l’a souligné Michel Lussault, ceci devrait relancer les dynamiques locales et permettre d’envisager ce grand territoire hétérogène de 657 000 habitants avec plus d’autonomie en y renforçant des complémentarités aujourd’hui peu développées.
 Le "vide" des espaces agricoles et naturels comme charpente de projet
Le "vide" des espaces agricoles et naturels comme charpente de projet
« Sur le plateau il y a le leurre de créer un tout. En réalité il s’agit plutôt d’une sorte d’archipel. Il faut résister à l’illusion d’un tout, mais faire le lien entre ces lieux. C’est possible grâce à la « géographie amplifiée », un paysage qui organise l’ensemble des circulations, l’eau bien sûr mais aussi les voiries dans une charpente paysagère qui ne fait qu’amplifier une géographie pré-existante. Pour nous, c’est un modèle extraordinaire pour gérer des territoires de cette taille. »
 Michel Desvignes
Michel Desvignes
Les travaux de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et paysagère choisie par l’EPPS pour accompagner la mise en place de l’OIN Paris Saclay ont permis l’élaboration avec l’Etat et les collectivités d’un schéma de développement territorial adopté en 2012. La condition principale pour mettre en place le projet est l’accessibilité en transports en commun via le développement du Grand Paris Express, qui favorisera un meilleur lien à Paris mais aussi entre les polarités du territoire telles que Massy TGV, le pôle multimodal de Versailles Chantiers, Saint-Quentin, ou encore Orly. Néanmoins ces liens nouveaux ne suffisent pas pour faire ville. Le concept de Michel Desvignes, qui s’inscrit dans la lignée des travaux du paysagiste américain Olmsted, consiste à définir les conditions de l’urbanité à partir des espaces naturels qui étaient considérés dans la logique des villes nouvelles comme un vide à remplir. Il propose un modèle urbain compact avec une intensification des implantations urbaines existantes en bordure du plateau et donc une limitation de leur croissance autour du vide historiquement préservé. La structure paysagère du plateau avec les vallons et les coteaux boisés doit-être renforcée et même amplifiée. Une nouvelle qualité est ainsi conférée à tous les éléments qui forment le paysage en intégrant l’ensemble des infrastructures nécessaires au projet. Une attention particulière a été accordée au système hydraulique de rigoles et d’étangs mis en place au XVIIème siècle, et endommagé au cours des dernières décennies d’urbanisation. La restauration de ce paysage humide est un des enjeux principaux du projet, tant du point de vue de son intérêt pour la biodiversité que de celui pour la prévention des risques d’inondation des vallées.
 Mission de maîtrise d'oeuvre urbaine et paysagère - OIN Paris Saclay - 2009-2015Maîtrise d’ouvrage : Etablissement public Paris Saclay
Mission de maîtrise d'oeuvre urbaine et paysagère - OIN Paris Saclay - 2009-2015Maîtrise d’ouvrage : Etablissement public Paris Saclay
Maîtrise d'oeuvre : Michel Desvigne Paysagiste (MDP) avec Xaveer de Geyter (XGDA) / Floris Alkemade, architectes urbanistes
(FAA) + AREP et Tritel (mobilité), ALTO (environnement), Sogreah (développement durable...) et Setec (VRD)
 Gouvernance d’une polarité mondiale composite
Gouvernance d’une polarité mondiale composite
« Il faut que nous ayons la compréhension du schéma stratégique qui est en jeu et qui est nécessaire dans la compétition mondiale pour positionner la France et l’Europe. Mais nous sommes aussi là pour défendre les habitants qui nous ont élus. Si nous n’arrivons pas à rendre acceptable ce projet, à l’intégrer au profit des habitants, on va avoir une résistance qui pourrait l’enrayer. »
 David Bodet
David Bodet
L’histoire récente du plateau de Saclay témoigne de la complexité à accorder enjeux locaux et globaux. Des oppositions locales aux différents projets d’urbanisation du territoire se sont structurées autour des enjeux de préservation de la nature et de la qualité de vie. Cette résistance a permis la mise en place d’une structure de coopération intercommunale dans les années 1990 à l’échelle du plateau. Les 15 communes composant le District du plateau de Saclay (DIPS) se sont alors accordées avec l’Etat sur un schéma directeur prévoyant la préservation de 2000 ha agricoles. La loi Chevènement de 1999 a ensuite redécoupé le plateau en 4 intercommunalités, détruisant les logiques de coopération naissantes. C’est seulement depuis la création de l’Etablissement public Paris-Saclay, chargé de mener à bien l’opération d’intérêt national qu’un espace de dialogue a été ouvert de nouveau à l’échelle interdépartementale du plateau et des vallées attenantes. Un schéma de développement territorial adopté en 2012 a ainsi été élaboré entre l’Etat et les 49 communes et sert de base à la définition des CDT « Territoire Sud Saclay » et « Versailles Saint-Quentin».
Dans la contractualisation avec l’Etat, c’est l’échelle de la communauté d’agglomération comme celle de Paris Saclay (CAPS) qui permet de faire avancer les projets, et de mettre en synergie les acteurs pour dépasser les premières réactions d’opposition. La CAPS a organisé des réunions régulières pour faire évoluer le projet, coordonner les actions de chacun et réussir à « rythmer dans le temps un développement régulier.» Cependant, il paraît nécessaire d’inventer des modes de gouvernance à plus grande échelle. La question va se retrouver au cœur des débats qui s’ouvrent dans le cadre de la nouvelle carte des intercommunalités franciliennes.
 Saclay dans le Grand Paris
Saclay dans le Grand Paris
La vision de Michel Desvigne
«
Epaissir les lisières
Il existe une lisière physique où se côtoient deux mondes qui s’ignorent. L’un est le monde rural, que l’on aurait tort de qualifier de naturel. En Île-de-France, il correspond le plus souvent à des terres agricoles, remembrées pour autoriser une exploitation mécanisée à grande échelle : ce sont des déserts humains, fréquentés quatre fois l’an, appauvris par la disparition des haies, des fossés, des bosquets et des chemins que le remembrement a gommés.
L’autre correspond à la périphérie de la périphérie. Elle est instable, mouvante. Ce sont des zones pavillonnaires, des zones commerciales, des zones d’activité, qui toutes tournent le dos au monde agricole, qui toutes sont dans l’éloignement du monde urbain et dans l’absence d’espaces publics partagés et pratiqués.
Cette rive assemble deux marges de peu de qualité. Elle a l’allure d’une catastrophe ordinaire. Ces deux mondes ne se confrontent pas plus qu’ils ne se rencontrent : ils se tournent le dos. Cette lisière est le plus souvent matérialisée par de simples grillages, de part et d’autre desquels ne se trouvent ni lien, ni échange : elles ne partagent que leur état de frange.
Seul un artifice peut traiter cette situation, somme toute inacceptable. Seule l’invention d’un espace spécifique peut la renverser. Il ne peut prendre modèle ni d’un monde ni de l’autre. Vouloir y rétablir des paysages agricoles préexistants au remembrement serait spécieux. Vouloir là des squares serait reconduire l’indifférence à la situation. Laisser se déplacer cette lisière, poursuivre le grignotement de la ville sur la campagne conduit à l’extension de la marge, à tous les gaspillages qu’il induit, à l’empêchement de profiter d’une situation à bien des égards exceptionnelle.
Il s’agit au contraire de la fixer, aussi bien pour préserver les terres agricoles et maintenir avec elle la proximité de ces mondes de production et de consommation, que pour endiguer une expansion génératrice de pertes de valeur et de sens.
Ces deux mondes, il faut les articuler par l’entremise d’un milieu singulier, qui les concilie, qui les fasse profiter l’un de l’autre, qui les mutualiste. Cette ligne mince et fragile qui les sépare, il faut la dilater, lui donner une épaisseur et une existence qui leur profite à l’un comme à l’autre, emprunte ses qualités à l’un comme à l’autre, les enrichisse l’un comme l’autre. Ce sont des liens ouverts qu’il faut créer, une porosité qu’il faut établir, et non une ceinture de contention qui, fût-elle verte, ne correspondrait qu’à la dilatation d’un grillage. [...]
Ce milieu doit à la fois faire appel aux pratiques et aux techniques empruntées au monde de l’agriculture, et pallier aux déficits de la périphérie urbaine. Le premier suggère vergers, potagers, hortillonnage, maraîchage... Le second appelle chemins et pratiques publiques. Il s’agit bien moins d’offrir une « jolie campagne», utopique et mièvre, que de concilier là des pratiques et des usages qui font défaut dans chacun des deux mondes.
Leur répertoire devient ainsi très ouvert. Que l’on évoque les pratiques des citadins qui profitent de la campagne pour se promener et s’aérer, avec des chemins et des sentiers, des promenades et des plages, ou leur désir de jouir d’un lopin de terre, ou même de l’exploiter de leurs mains, ou encore d’étancher leur curiosité botanique. Ou que l’on pense aux besoins de jeunes ruraux de trouver des ressources supplémentaires ou complémentaires, voire d’expérimenter de nouvelles formes d’exploitation à forte valeur. A quoi il faut ajouter la possibilité de traiter et d’exploiter l’eau, les déchets, la production d’énergie, la fertilisation des sols, le recyclage, le compostage…
L’entretien de ce paysage d’un nouveau type, au croisement entre expérimentation, loisir et exploitation diffère autant de l’agriculture productive que des services de voirie ou des parcs et jardins. Il est partagé entre municipalités et exploitants, concessionnaires privés et propriétaires publics. […]
L’interférence créée entre les deux mondes fixe ainsi une des caractéristiques majeure de l’agglomération capitale, qui les conjugue jusque très près de son centre. Elle lui donne aussi un abord. Surtout, elle y réconcilie ces deux mondes, aux forces inégales, en leur permettant des formes de développements et d’échanges économiques de proximité, en en brassant les cultures. »Elle répare des situations défavorisées ou délaissées, dont les handicaps sont renversés en atouts. Elle ne se contente pas de préserver les ressources naturelles, mais les anime et les amplifie. Conjugués, ces trois bénéfices correspondent à l’esprit du développement durable, loin des incantations ou des culpabilisations dont il est trop souvent entouré.
 Michel Desvigne
Michel Desvigne
 La carte interactive
La carte interactive
 Pour aller plus loin...
Pour aller plus loin...
- Les campus
 Histoire du campus du Commissariat à l’Energie Atomique de Saclay
Histoire du campus du Commissariat à l’Energie Atomique de Saclay Présentation du futur campus urbain, EPPS
Présentation du futur campus urbain, EPPS Le site de la Fondation de coopération scientifique Campus Paris-Saclay
Le site de la Fondation de coopération scientifique Campus Paris-Saclay
- L'innovation technologique - Campus et Clusters
 Les clés du succès des grands clusters mondiaux de recherche et d’innovation, Deloitte, 2012
Les clés du succès des grands clusters mondiaux de recherche et d’innovation, Deloitte, 2012 Pour un écosystème de la croissance : rapport au Premier ministre, Christian Blanc, 2004
Pour un écosystème de la croissance : rapport au Premier ministre, Christian Blanc, 2004 Campus scientifiques et clusters, études comparatives internationales, IAUîdF, 2007-2014
Campus scientifiques et clusters, études comparatives internationales, IAUîdF, 2007-2014 Cartographies de synthèse des activités de Recherche et Développement et d’Innovation en Île-de-France, IAUîdF, 2009
Cartographies de synthèse des activités de Recherche et Développement et d’Innovation en Île-de-France, IAUîdF, 2009
- Le contrat de développement territorial Paris Saclay Territoire Sud
 Le Contrat de Développement Territorial « Paris-Saclay Territoire Sud », 2013
Le Contrat de Développement Territorial « Paris-Saclay Territoire Sud », 2013 Portrait de territoire : Paris Saclay Territoire Sud, DRIEA, 2013
Portrait de territoire : Paris Saclay Territoire Sud, DRIEA, 2013
- L'Opération d'Intérêt National Paris-Saclay
 La médiathèque de l’Etablissement Public Paris-Saclay (EPPS)
La médiathèque de l’Etablissement Public Paris-Saclay (EPPS) Le Schéma de Développement Territorial Paris-Saclay, 2012
Le Schéma de Développement Territorial Paris-Saclay, 2012 Fiche SDT Paris Saclay, IAU, 2012
Fiche SDT Paris Saclay, IAU, 2012 Portrait de territoire : Paris Saclay, DRIEA, 2011
Portrait de territoire : Paris Saclay, DRIEA, 2011
- Points de vue
 « Quel projet d'intérêt national pour le plateau de Saclay ? », Brédif Hervé, L’Espace géographique 3/ 2009
« Quel projet d'intérêt national pour le plateau de Saclay ? », Brédif Hervé, L’Espace géographique 3/ 2009 L'invention paysagiste du plateau de Saclay, De la création des rigoles au plan d'actions paysagères, Mouez Bouraoui, Courrier de l'environnement de l'INRA n°36, mars 1999
L'invention paysagiste du plateau de Saclay, De la création des rigoles au plan d'actions paysagères, Mouez Bouraoui, Courrier de l'environnement de l'INRA n°36, mars 1999



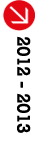
 Situation Métabolique
Situation Métabolique Michel Desvigne, Paysagiste, mandataire du groupement en charge de définir l’aménagement du Plateau de Saclay, membre du Conseil scientifique de l’AIGP (2010-2011)
Michel Desvigne, Paysagiste, mandataire du groupement en charge de définir l’aménagement du Plateau de Saclay, membre du Conseil scientifique de l’AIGP (2010-2011) Michel Lussault, Géographe, Directeur de l’Institut Français d’Education, Professeur à l'ENS de Lyon
Michel Lussault, Géographe, Directeur de l’Institut Français d’Education, Professeur à l'ENS de Lyon Pierre Veltz, Président Directeur Général de l’Etablissement Public Paris-Saclay
Pierre Veltz, Président Directeur Général de l’Etablissement Public Paris-Saclay David Bodet, Président de la Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay, 1er Maire-adjoint de Palaiseau (2007-2014)
David Bodet, Président de la Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay, 1er Maire-adjoint de Palaiseau (2007-2014) Dominique Vernay, Président de la Fondation de Coopération Scientifique Paris-Saclay
Dominique Vernay, Président de la Fondation de Coopération Scientifique Paris-Saclay Un haut lieu de production de connaissances
Un haut lieu de production de connaissances De la connaissance à l’innovation, le campus Paris-Saclay
De la connaissance à l’innovation, le campus Paris-Saclay Un archipel d'autarcies
Un archipel d'autarcies Une urbanité par transitions paysagères
Une urbanité par transitions paysagères Mission de maîtrise d'oeuvre urbaine et paysagère - OIN Paris Saclay - 2009-2015
Mission de maîtrise d'oeuvre urbaine et paysagère - OIN Paris Saclay - 2009-2015 Cluster de l’innovation technologique
Cluster de l’innovation technologique Une polarité à fabriquer / un plateau à préserver
Une polarité à fabriquer / un plateau à préserver Le "vide" des espaces agricoles et naturels comme charpente de projet
Le "vide" des espaces agricoles et naturels comme charpente de projet Gouvernance d’une polarité mondiale composite
Gouvernance d’une polarité mondiale composite

